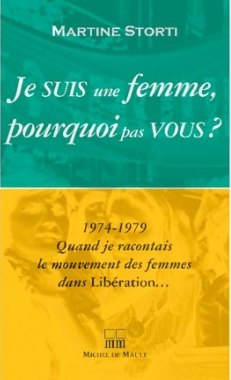Les femmes syriennes et palestiniennes réfugiées au Liban, victimes et actrices, enfermées dans la tradition et en rupture forcée avec elle.
Au Liban, on les appelle plutôt les « déplacé-es »
Toute de noir vêtue, seul son visage est visible, visage fin, fatigué, traits tirés, mais je vois bien qu’elle est jeune, très jeune même, 17 ans, peut-être 18, et dans ses bras un enfant auquel je ne donne pas plus de quelques jours, elle mendie avec son nouveau né dans une rue de Beyrouth, une mendiante parmi d’autres mendiants, c’est l’une des premières choses que l’on vous dit à propos des réfugiés syriens lorsque vous arrivez à Beyrouth, « maintenant il y a de la mendicité » (mais je verrai moins de mendiants dans les rues de la capitale libanaise que dans celles de Paris).
Je ne saurai jamais comment cette jeune femme est arrivée à Beyrouth ni comment elle y vit, juste savoir qu’elle est l’une parmi plus d’un million d’autres. Un million, (peut-être même est-ce davantage), tel est le chiffre avancé en ce mois de novembre 2013 pour dire le nombre de Syriens réfugiés au Liban : aux 800 000 enregistrés par le HCR (Haut commissariat aux réfugiés) il faut ajouter les Palestiniens de Syrie – 90 000, comptabilisés eux par l’UNRWA (Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine) et probablement quelques milliers de personnes qui ne figurent sur aucun listing. Ce chiffre est d’ailleurs en constant changement puisque chaque jour des femmes, des hommes, des enfants franchissent la frontière, dans des voitures, des cars, sur des motos, à pied, ainsi par exemple à la mi-novembre, ces milliers de réfugiés fuyant les combats de Qara et arrivant à Ersal, dans le nord de la Békaa, une ville plutôt pauvre et qui hébergeait déjà de très nombreux Syriens.
Il y a un an, au Liban, ils étaient 100 000, aujourd’hui ils sont plus d’un million, soit un quart de la population d’un pays qui compte 4,2 millions d’habitants (l’équivalent de 15 millions de réfugiés si un tel scénario se déroulait en France !)
Laissez vos frontières ouvertes, dit l’Europe qui ferme les siennes, gardez les réfugiés, ajoute-t-elle, (l’Europe, ce n’est pas seulement les institutions, les gouvernements, c’est vous, c’est moi) et traitez-les aussi bien que possible, langage que nous tenons au Liban ainsi qu’aux autres pays frontaliers de la Syrie, en particulier la Jordanie et la Turquie.
Alors en effet, des réfugiés syriens, au Liban, il y en a partout, surtout au Nord et à l’Est, le long de la frontière syrienne, mais aussi à Beyrouth et au Sud. « Pas de camps officiels et organisés », a dit le Liban, « expert » en la matière avec les Palestiniens présents depuis 1948. D’où des formes multiples d’hébergement, souvent privés du minimum en matière d’accès à l’eau potable, aux sanitaires, aux soins de base : groupements de quelques tentes, hangars, carcasses d’immeubles, parkings, baraques, garages, édifices publics abandonnés, constructions précaires faites de parpaings et de tôle ondulée, installation chez des amis, syriens ou libanais, location de chambres et d’appartements.
Ce ne sont pas dans les luxueux immeubles et hôtels du centre de Beyrouth, dans les rues et boulevards qui s’appellent toujours Clémenceau, Weygand ou Foch tandis que le pays est de moins en moins francophone, que se trouvent beaucoup de réfugiés. Pourtant la place ne manque pas dans ces somptueux immeubles largement inoccupés, voisins des boutiques Chanel, Dior et autre Bulgari, où les clients se font de plus en plus rares, plus rares en tout cas que les policiers, militaires ou agents de sécurité privés qui les protègent jour et nuit. La plupart des Syriens vivent dans des quartiers plus populaires tandis que les Palestiniens de Syrie sont allés, du moins certains d’entre eux, retrouver leurs compatriotes installés à Sabra ou à Chatila, camp de sinistre mémoire, mais toujours là, ghetto surpeuplé dont les immeubles misérables augmentent de hauteur chaque année.
Avec cet afflux de réfugiés, tout devient enjeu de location, le terrain où sont plantées les tentes, le garage qui abrite des familles, l’appartement dont le loyer a doublé en quelques mois. Les Libanais qui aident coexistent avec ceux qui profitent de l’aubaine, c’est ainsi, c’est toujours ainsi, quel que soit le pays !
La dispersion des réfugiés, l’insuffisance des moyens mis en œuvre, le manque de coordination des différents acteurs (mais elle commence à s’améliorer) et l’augmentation continue des personnes concernées font que la situation est pour la plupart des réfugiés très difficile ainsi que le montre un très récent rapport de l’ONG OXFAM qui souligne leur appauvrissement constant. De quoi vivent-ils ? De l’aide (en diminution) apportée par les agences onusiennes et les ONGS internationales ou locales, de leurs économies, de l’argent que font passer et ceux restés en Syrie et la diaspora syrienne, de l’endettement, du travail s’ils en trouvent. Et comme ils acceptent des salaires plus bas que les autochtones, par exemple dans le bâtiment ou les travaux des champs, une colère monte du côté libanais, dans une rivalité des pauvres entre eux, les ouvriers libanais s’en prenant plus aux Syriens qu’aux patrons ravis de verser des salaires moins élevés.
Et puis il y a ce qui se murmure, puis se dit, puis s’écrit, ainsi un article mis en ligne par le Spiegel affirmant qu’un « nombre croissant de réfugiés survivent en vendant leurs organes », les Syriens ayant en quelque sorte remplacé les Palestiniens dans ce pays où existe en effet un commerce illégal d’organes. Coup médiatique du Spiegel ou véritable réseau ? On espère des enquêtes d’autres journalistes, des autorités locales, des instances internationales.
Quand le mot réfugiée se conjugue au féminin
Femmes et filles représentent plus de la moitié des réfugiés, et elles sont pour la plupart au premier rang pour tout ce qui relève de la survie quotidienne, c’est-à-dire la nourriture, les soins aux nombreux enfants, le ménage, l’organisation de la vie quotidienne, ce qui n’est pas forcément aisé en temps normal mais encore moins dans des conditions matérielles difficiles. Dans un camp informel, malgré les aides, la tâche devient même insurmontable. Des enquêtes conduites par plusieurs associations montrent que les femmes font passer les besoins de leur mari et de leurs enfants avant les leurs. Certaines sont seules, jouant alors un rôle inhabituel de chef de famille, parce qu’elles sont veuves ou parce que les hommes (maris, pères, jeunes adultes) sont restés en Syrie, pour combattre ou pour continuer à travailler, garder la maison ou le champ. Seules aussi parfois des femmes enceintes, arrivant après des kilomètres en voiture, en camion ou à pied, et comme le souligne une sage-femme de MSF, « sans avoir pu consulter un médecin, sans savoir si leur bébé se porte bien et sans même savoir où elles vont accoucher ». Nombreuses aussi sont celles qui croyaient quitter leur maison, leur ville ou village pour quelques jours ou quelques semaines et qui sont au Liban depuis plusieurs mois sans savoir quand elles rentreront chez elles. Même en estimant juste la lutte contre le régime de Bachar el Assad, au regard de leur actuelle situation, la vie d’avant est évoquée comme heureuse, tandis que l’incertitude de l’avenir devient insupportable.
Ce qui est vécu au Liban bouleverse habitudes et rôles traditionnels. Un bouleversement qui peut être stressant, déstabilisant. Le constat de ne plus pouvoir correspondre au modèle féminin dominant en Syrie – ne pas se déplacer seule, ne pas prendre de décision sans l’aval d’un homme -, génère anxiété et culpabilité. Sentiment aussi de perdre sa dignité en perdant toute intimité dans des conditions de vie où domine la promiscuité tandis que la traditionnelle séparation entre univers féminin et masculin est battue en brèche dans les abris de fortune ou les appartements surpeuplés.
Mais les nouvelles conditions de vie et les nouvelles responsabilités assumées conduisent aussi des femmes à devenir plus autonomes, et du coup à remettre en question le modèle traditionnel. Le plus souvent en effet ce sont les femmes qui se rendent aux distributions de nourriture, elles qui insistent auprès des directeurs pour que leurs enfants soient acceptés dans les écoles libanaises, elles qui se rendent dans les centres récemment créés où se distribuent kits d’hygiène, matelas, vêtements, elles qui vont chercher le formulaire pour avoir des aides, tandis que pas mal d’hommes trouvent trop humiliants de réclamer une assistance.
Dans certains centres sont organisés des groupes de discussion, des initiations et formations à l’hygiène, ou à l’anglais, ou à l’informatique, sont fournis des appuis psychologiques. Peut alors commencer à s’opérer un retour sur soi, une manière de ne plus seulement faire partie d’une masse indifférenciée – les réfugié-es – mais de redevenir un individu. Peut aussi commencer à dire ce qui a été subi, le stress de la guerre, les violences, les viols. « Cela prend du temps, me dit Jimmi, une jeune libanaise qui dirige le centre de Caritas à Dekwaneh. En mai dernier le centre s’occupait de 500 familles réfugiées soit environ 4000 personnes, 6 mois plus tard ce sont 1300 familles qui bénéficient d’une prise en charge partielle. « Au début les femmes ne parlent jamais d’elles, mais peu à peu elles se sentent en confiance et osent dire ce qui leur est arrivé en Syrie mais ce qui leur arrive aussi au Liban ». Franchir une frontière ne signifie pas nécessairement pour les femmes être en sécurité, des violences sexuelles et sexistes (SGBV selon la terminologie onusienne – violence sexuelle et basée sur le genre) pouvant encore être subies.
L’augmentation des violences sexuelles au sein des familles est relevée par plusieurs enquêtes, ainsi que les violences sexuelles dans les camps informels, les abris de fortune, les hébergements précaires. Les veuves, les femmes seules craignent le harcèlement, l’agression si bien que certaines dissimulent la mort de leur mari ou font semblant de recevoir des appels téléphoniques d’un époux pour qu’on les laisse tranquilles. On constate aussi l’augmentation des mariages précoces, souvent avec de bonnes intentions, pour sauver les jeunes filles de la précarité et de la pauvreté. Dans le beau documentaire réalisé par Carole Mansour, Not who we are (Ce n’est pas ce que nous sommes) qui pour le moment n a été diffusé qu’au Liban et qui est consacré à 5 réfugiées, l’une d’entre elles raconte la décision prise – et qu’elle regrette – de marier deux de ses filles (16 ans et 14 ans) avec des hommes qu’elles ne connaissaient pas, « juste pour qu’ elles puissent manger à leur faim », ne sachant pas si elles « tomberaient bien ou mal »
Les deux filles ne sont pas trop mal tombées, alors que parfois ces mariages contractés au Liban ne sont que l’entrée dans un réseau prostitutionnel. Leïla, de l’association palestinienne Najdeh, est formelle : « les réseaux de prostitution existent à la frontière avec la complicité de certains qui appartiennent aux forces de l’ordre ». A ces réseaux s’ajoute le développement d’une prostitution occasionnelle, dite de survie (survival sex), qui s’exerce y compris avec certains personnels humanitaires : faveurs sexuelles contre nourriture ou biens matériels ou argent pour payer un loyer…
Comme pour la vente d’organes, de nombreuses rumeurs circulent. Une enquête précise, officielle s’impose afin de connaître l’ampleur du phénomène, d’identifier les réseaux, les lieux, les responsables, d’autant qu’au Liban, la prostitution, bien qu’interdite, n’est pas une nouveauté !
Des mesures de protection sont aussi à prendre en urgence. Des associations internationales tel l’IRC (International rescue committee) ou libanaises commencent à s’y employer, par exemple ABAAD (Centre de ressources pour l’égalité des sexes) qui depuis juin 2013 a ouvert 3 centres d’hébergement temporaire (au Sud, au Nord et dans la Bekaa) pour des filles et femmes (qui peuvent venir avec leurs enfants) victimes de violences et en danger immédiat. D’autres offrent services juridiques, diffusent des informations et mènent des campagnes de sensibilisation à l’égalité femmes/hommes. Au cours de la campagne internationale « 16 jours contre les violences à l’égard des femmes » qui se déroule cette année du 25 novembre (journée internationale contres les violences faites aux femmes) au 10 décembre ( journée intertationale des droits de l’homme), la task force contre les violences de genre du HCR organise une série d’actions en partenariat avec plusieurs associations (notamment ABAAD, LECORVAW, Caritas) dans différentes villes et zones du pays autour de l’égalité entre les sexes, des droits des femmes, de la lutte contre le viol… Est-ce suffisant ? Sûrement pas, la dispersion des réfugiées, l’éloignement des lieux de rencontres, le poids terrible des urgences quotidiennes limitent le nombre de femmes qui accèdent aux centres et aux informations.
Au-delà de la nécessaire sensibilisation, la question des violences, du viol, des mariages forcés, de la prostitution en situation de guerre et de crise doit être encore davantage prise en compte et les actes sanctionnés. L’enjeu, on le sait, ne concerne pas que les réfugiées du Moyen-Orient. Il est mondial, doit relever des Etats concernés mais aussi de la Cour pénale internationale, du Conseil de sécurité de l’ONU, la lutte contre la violation des droits des femmes et des filles n’étant pas moins importante que la lutte contre les armes chimiques.
Samar, 14 ans : « Je veux rentrer en Syrie pour aller à l’école »
Les jeunes syrien-nes viennent d’un pays où la scolarisation était avant la guerre importante (plus de 90%).
Au Liban, un quart seulement des enfants en âge de l’être sont scolarisés, soit dans des écoles informelles, soit dans des écoles publiques libanaises. Fréquentées par les plus défavorisés, ceux qui ne peuvent pas aller dans l’enseignement privé, largement majoritaire au Liban, déjà estimées comme étant de mauvaise qualité, certaines d’entre elles accueillent plus d’enfants syriens que libanais, ce qui ne manque pas de poser des problèmes tandis que d’autres se ferment aux Syriens, à la demande de parents libanais. Pourtant cet enjeu est crucial : aller à l’école, même sans être au niveau, même en ayant des difficultés de langue ou de contenus scolaires, c’est à la fois retrouver quelque chose d’une vie normale et ne pas trop hypothéquer son avenir.
Samar, 14 ans, voudrait bien aller à l’école. Mais elle n’y va pas. Le paradoxe est que depuis plus d’un an, elle vit dans ce qui était encore quelques mois auparavant une école, située à Chhime, dans le Mont Liban, école transformée par son propriétaire en centre pour réfugiés et louée à une association locale. 200 personnes s’y entassent, chaque petite salle de classe devenue salon et chambre à coucher (matelas) pour chaque famille, tandis que cuisine et sanitaires sont communs. Samar vit là avec ses parents, ses deux sœurs et ses deux frères. En Syrie, elle fréquentait une école secondaire et avait décidé de devenir professeur. Depuis qu’elle est au Liban, comme les 90 enfants en âge d’être scolarisés qui vivent dans ce centre, elle ne va pas à l’école, faute de pouvoir payer le car qui pourrait l’emmener dans l’école publique, située à trois heures de marche, qui a accepté de les prendre. Coût de l’opération : 100 dollars par enfant deux fois par an. Mais l’argent manque aux familles ainsi qu’à la petite association qui les soutient et qui déjà a cessé de payer le loyer, au grand dam du propriétaire inquiet.
Que font ces 90 enfants toute la journée ? « Quand ils ne jouent pas dans la cour ou n’aident pas leurs parents à certaines tâches, ils lisent le Coran pour ne pas perdre l’habitude de la lecture ». Samar, voile sur la tête (comme sa sœur qui n’a que 12 ans), yeux pétillants, le dit avec fermeté : « je préfèrerais rentrer en Syrie, même sous les bombes, et aller à l’école plutôt que de rester ici à ne rien faire ». Sa mère approuve, elle aussi voudrait rentrer en Syrie, elle partage aussi l’envie de sa fille de continuer des études. La marier à 16 ans, comme elle l’a été ? « Non, c’est trop tôt, c’est fréquent en Syrie, mais je ne veux pas cela pour ma fille ». Il y a là comme un espoir : car cette femme de 30 ans, mère de 5 enfants âgés de 14 à 3 ans, robe et foulard noirs, qui respectueuse de la tradition pour elle vit recluse pour ne pas affronter la rue, les autres, les regards paraît vouloir pour sa fille ainée une autre vie, une autre manière de vivre.
Cet enjeu de l’école, on pourrait même dire ce désir d’école, est toujours central dans les situations de crise (guerres, conflits, catastrophes). S’il est davantage pris en compte depuis quelques années, si la rescolarisaton est désormais partie prenante des situations de crise et d’immédiat post crise, les actions conduites demeurent insuffisantes, tandis que l’Unicef peine à obtenir les fonds demandés. S’agissant de la situation au Liban, pourquoi ne pas mobiliser les enseignants syriens qui existent sûrement parmi les refugiés afin d’organiser des sessions scolaires ? Dans l’exemple que je viens de prendre, il y a en effet, parmi les deux cents personnes présentes, une professeure syrienne. Elle serait d’accord pour enseigner à condition d’être payée, ce qui se comprend.
Sans conclure
Flux continu des réfugiés, moyens de tous ordres complètements insuffisants malgré le dévouement de beaucoup, effets politiques, économiques, sociaux sur le pays d’accueil, montée d’une intolérance, parfois d’une peur et d’une exaspération à l’égard des réfugiés… La question lancinante est : combien de temps une telle situation peut-elle durer, dans un pays surendetté dont le gouvernement est démissionnaire depuis mars 2013, où l’Etat est quasi inexistant, la corruption endémique et l’unité toujours incertaine ?
Que faut-il faire, sachant que le retour de la paix en Syrie, quelle qu’elle soit, n’est probablement pas de l’ordre du court terme ? Créer des zones sécurisées sous contrôle international en Syrie ? Des couloirs humanitaires ? Déployer des moyens plus importants dans les pays frontaliers ? Décider de créer de vrais camps, organisés, structurés permettant une assistance plus facile ? Accroitre l’accueil de réfugiés dans d’autres pays ? Tout cela à la fois ? Poser aussi une autre question, naïve sans aucun doute : pourquoi l’énergie politique et diplomatique déployée à juste titre à propos des armes chimiques ne l’est-elle pas aussi pour l’enjeu humanitaire ?
Au Liban l’hiver qui vient est annoncé comme rigoureux. « Je redoute qu’il y ait des morts de froid, de maladies du côté des réfugiés » me dit une amie libanaise. Est-ce cela qu’il faut attendre ? Est-ce cela que nous attendons ?
Martine Storti
26 novembre 2013