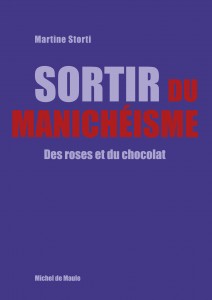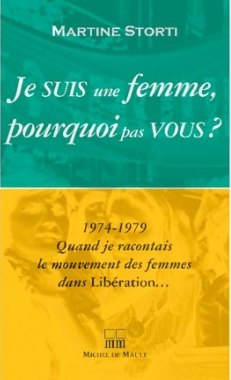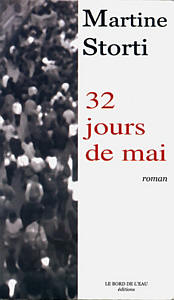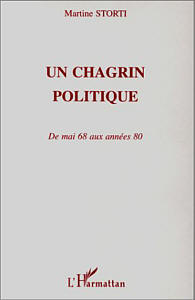Mon article publié par Libération 13 février 2025
Refrain, rengaine, ou encore «marronnier», pour reprendre le terme qui dans les médias désigne un sujet récurrent, autant de mots pour nommer la question que le Premier ministre Bayrou et d’autres ministres avec lui mettent à nouveau sur la table : qu’est-ce qu’être Français ? Qu’est-ce que l’identité française ? Questions une nouvelle fois posées et pas seulement depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec la création d’un ministère de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale et la tentative d’un débat en 2009. Non, il faut remonter plus tôt, remonter au début des années 1980, exactement en 1983, année où le Front national est sorti de son statut de mini groupuscule pour s’installer sur la scène politique.
Cela fait plus de quarante ans que la thématique de l’identité française que l’on croyait à jamais enterrée avec les tragédies meurtrières qu’elle avait suscitées dans la première partie du XXe siècle a refait surface, propulsée d’abord par le Front national, en lien avec l’immigration, mais reprise avec une époustouflante rapidité par une grande partie de la droite. En peu de temps, il devint urgent de savoir qui et quoi étaient français et qui et quoi ne l’étaient pas. Même les idées furent jugées à cette aune, ainsi Jacques Toubon, alors député RPR, déclarant le 10 novembre 1984 à Arras : «Les idées socialistes ne sont pas des idées françaises» ! Donc pas «françaises» les idées de Jaurès, pour ne citer que lui ! Et quand le Front national brandissait des banderoles «la France est de retour», le RPR lançait à l’automne 1985 une campagne d’affiches «Vivement demain, vivement la France», comme si la France et son identité disparaissaient quand la gauche la gouvernait, ce qui était alors le cas.
Plus grave encore, la conception d’une identité française fermée, ethnique, exclusive, xénophobe, raciste, nationaliste gagna rapidement du terrain. Les titres racoleurs ou intimidants se multiplièrent. «Serons-nous encore français dans trente ans ?» demandait le Figaro, et les questionnements s’enchaînèrent au fil des années : est-on Français par le sang, par la naissance en France, par une ancienneté de présence, par la maîtrise d’une langue et d’une culture, par des modes de vies, par l’adhésion à des valeurs ?
Fantasme d’une homogénéité perdue
Il est aisé de savoir, si François Bayrou conduit vraiment le débat qu’il envisage, ce que l’on va entendre ou lire. Tout ce qui a été dit et répété pendant plus de quarante ans, va être dit et répété à nouveau. Rengaine de la question et rengaine des réponses. A l’hérédité charnelle et à la France blanche et chrétienne, au fantasme d’une homogénéité perdue des uns va s’opposer une France métissée, plurielle, créolisée des autres, qui a su, au long de son histoire, intégrer des populations venues d’autres pays, d’autres cultures. Vont être aussi rappelées les difficultés rencontrées par ces différentes populations, et le racisme dont elles ont été l’objet, des «tristes puanteurs slaves» aux «polaks mités» ou à «la crasse des ritals». Et le contre commentaire est connu d’avance, lui aussi : ces étrangers ne l’étaient pas vraiment, certes Italiens, Polonais, Espagnols mais blancs, chrétiens, européens donc compatibles avec l’identité française. Tandis que l’immigration d’aujourd’hui, extra-européenne, souvent musulmane, voyez-vous, ne lui est-elle pas incompatible, par nature donc ou plutôt par essentialisation ?
Ce qu’on a déjà entendu, on va l’entendre encore, on l’entend déjà, par exemple à propos de l’école qui doit, selon le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, «apprendre aux jeunes à aimer la France». Non, monsieur le ministre, l’école n’a pas pour vocation d’être au service d’une vision mythique, embellie ou noircie, de la France, sa fonction n’est pas de construire un roman national mais de transmettre des connaissances, de faire comprendre ce qu’est l’humanité dans le temps, ce qui demeure et ce qui change, ce qui est arrivé et pourquoi. Et tout cela est bien plus décisif que de faire aimer ou détester la France ! Faire droit aux épisodes liés à l’histoire de la population française telle qu’elle est aujourd’hui ne relève pas du registre de la repentance, mais de celui de la nécessaire entrée dans le passé. On ne combat pas les fantasmes, les mensonges, les visions complotistes, les haines par le silence. On peut essayer de les combattre par les savoirs et par l’apprentissage de la pensée. Laissons aux politiques, aux idéologues, le récit mensonger ou unilatéral, et rappelons que la France c’est De Gaulle et Pétain, les collabos et les résistants, Napoléon III et Victor Hugo, les Versaillais et les communards, le colonialisme et les luttes anti-coloniales…
L’identité est en soi totalisatrice
«Je ne veux pas qu’on s’amuse avec l’identité», déclarait au Monde en mars 1985, Fernand Braudel. A l’évidence, pendant ces quarante dernières années, la judicieuse mise en garde de l’historien n’a pas été prise en considération. Avec l’identité, on s’est en effet beaucoup amusé. Et pas seulement à propos de l’identité nationale. Le joujou de l’identité nous a tellement plu qu’il est devenu pour beaucoup l’enjeu principal, le cadrage prioritaire. Tout le monde ou presque s’y est mis : la droite, la gauche, les immigrés, les autochtones, les de souche et les pas de souche, les blancs et les non blancs, les indigènes dits de la République, les écologistes, les féministes, les antiféministes, les trans et les anti-trans, les souverainistes, les pro-européens…
L’urgence n’est pas de donner un contenu, quel qu’il soit, à l’identité. L’identité globalise, essentialise, fixe, fige, réifie, enferme, sépare, exclut. De l’identité à l’identitaire, le passage est rapide parce que l’identité est en soi totalisatrice. La France créolisée de certains est aussi totalisatrice que la francité des autres.
L’urgence est de cesser de penser en termes d’identité, de cesser d’emprunter cette impasse. Parlons d’histoire, de cultures, de littérature, d’arts, de cuisine, de musiques, de chansons, de films. Aux identités, préférons les singularités.