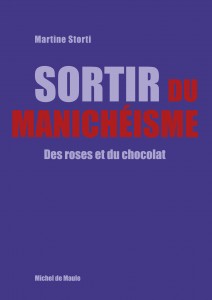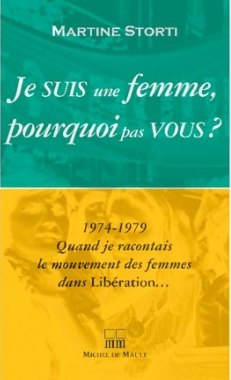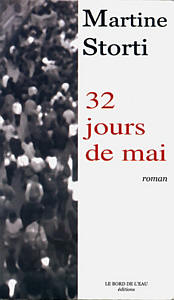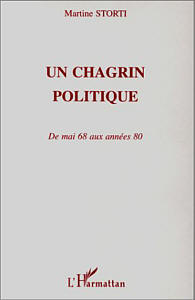Dans Le Monde du 31 décembre mon article
Je regarde à la télévision, ce 19 décembre, vers 13 heures, ces jeunes féministes rassemblées devant le tribunal d’Avignon qui entonnent, juste après la fin du procès de Mazan, l’hymne du Mouvement de libération des femmes écrit il y a plus d’un demi-siècle. A cinquante ans d’écart, les temporalités se télescopent. « Vingt ans pour tous ! », réclamait une banderole brandie par certaines féministes devant le palais de justice, en attendant le verdict. La cour criminelle du Vaucluse n’a pas suivi cette exigence, ce dont il faut se réjouir.
Le global renvoie au totalitarisme ; une justice démocratique juge au cas par cas. Il n’y a là nul éloge de modération de ma part, mais une prise en compte de la complexité des situations, des êtres, des vies. Pourtant, à l’exception de la peine de vingt ans de réclusion criminelle prononcée contre Dominique Pélicot, l’organisateur du sordide et effroyable scénario construit contre sa femme, les communiqués de la plupart des associations féministes regrettent des peines jugées trop légères.
Face à ces réactions, je ne peux m’empêcher de songer aux décennies antérieures, notamment aux années 1970, où des féministes – j’en étais – se battaient contre le viol, avec des mots parfois différents de ceux d’aujourd’hui, mais pour dire la même chose : que le viol signe le patriarcat, qu’il ne relève pas d’une prétendue pulsion sexuelle masculine irrésistible, mais du pouvoir, celui de l’appropriation par les hommes du corps des femmes, et que celles-ci doivent cesser d’avoir honte de le dénoncer.
Le combat s’est développé à partir de 1975, juste après qu’a été gagné, avec le vote de la loi Veil, celui mené pour la libéralisation de l’avortement. Deux enjeux qui concernent toutes les femmes, deux peurs, celle de la grossesse non désirée et celle du viol. Se battre mais comment ? En écrivant des tribunes, en inventant des slogans, en organisant des manifestations ? C’était utile mais insuffisant pour sonner l’alerte.
La tactique choisie fut d’articuler cette lutte à l’institution judiciaire. Puisque le viol est un crime dans le code pénal, il doit revenir à une cour d’assises de juger les violeurs et non, comme c’est trop souvent le cas, à un tribunal correctionnel, ce qui disqualifie le viol en coups et blessures ou en atteinte à la pudeur.
Les assises ? Quel scandale ! A l’époque, le réquisitoire contre nous n’est pas instruit par la droite, mais par l’extrême gauche et une partie de la gauche. « Honte à vous, les féministes, de faire appel à la justice, qui est forcément bourgeoise, raciste et si répressive », nous opposait-on. Bien sûr, tous ces procureurs affirmaient être pour l’émancipation des femmes et contre le viol, mais aucun ne proposait d’alternative au recours au système judiciaire.« Pas les assises pour juger les violeurs, dites-vous ? Préférez-vous que l’on s’organise en commando, que l’on s’arme d’un revolver ? », leur rétorquent certaines militantes.
A la culpabilité immémoriale des femmes violées qui s’étalait lors des interrogatoires policiers – « Vous étiez en minijupe, et dehors à minuit, ne l’avez-vous pas aguiché, vous ne vous êtes pas défendue ? », etc. – s’ajoutait une culpabilité morale, alimentée par le camp politique – la gauche −, qui était celui de la plupart des féministes et par ceux qui ont été leurs compagnons de route dans la lutte en faveur de l’avortement. Une culpabilité qu’elles ont fini par intérioriser.
En 1978, quelques mois avant le procès d’Aix, un Algérien, auteur de trois viols effectués sous la menace d’un couteau, est condamné à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Beauvais. A l’époque journaliste à Libération, je finis par céder moi-même à la pression et j’écris, la mort dans l’âme, un article intitulé « Vingt ans c’est pas possible ! », qui qualifie d’« impasse notre combat contre le viol » par la voie judiciaire. « On vous l’avait bien dit », lancent nos procureurs. Les féministes − avocates, militantes − baissent la tête. A tort.
Il faut rappeler la solitude des féministes des années 1970 dans leur combat contre le viol, la solitude des femmes osant porter plainte et se constituer partie civile, la solitude de leurs avocates aussi courageuses et aussi vilipendées que Gisèle Halimi, et dont il faut citer quelques noms : Monique Antoine, Colette Auger, Odile Dhavernas, Josyane Moutet.
Car des procès, il y en a eu plusieurs avant celui d’Aix. Celui-ci, si souvent évoqué au sujet de Mazan, s’inscrit dans cette longue lutte collective, difficile, qui affronte des obstacles et des résistances multiples et différenciées. Ce qu’on lui doit avant tout, à mon sens, grâce à une mise en scène et une médiatisation efficacement et habilement orchestrées par Gisèle Halimi, elle-même affranchie de ces pressions militantes,c’est d’avoir mis un terme à cette culpabilité sur la question des assises.
Faut-il considérer que les féministes d’aujourd’hui qui jugent « trop légères » certaines peines sont plus enclines à la répression que leurs prédécesseures ? Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être tirent-elles simplement quelques leçons des années antérieures. Tant de luttes, et depuis si longtemps pour que tant de plaintes pour viol soient classées sans suite, que tant d’enquêtes soient bâclées, que tant de femmes ne soient pas écoutées. Tant de tolérance au sexisme, à l’industrie pornographique, tant de réticences à inscrire dans la scolarité une éducation à la sexualité qui ne soit pas juste une leçon d’anatomie.
Des décennies plus tard, le procès des viols de Mazan s’inscrit dans une autre séquence, celle ouverte il y a sept ans par MeToo. Une continuité avec les luttes antérieures et un changement. Puisque police, justice, société, certes un peu moins sourdes qu’avant, le sont cependant encore bien trop, il faut passer à une autre forme d’offensive : dire, dénoncer, nommer. MeToo ou un universel en actes, des milliers de femmes dans de très nombreux pays rendant visibles harcèlement, agressions sexuelles, viols.
Certes, tout ne se joue pas devant les tribunaux. Gisèle Pelicot a formulé après le verdict, rendu le 19 décembre, l’espoir « que la société se saisisse des débats qui se sont tenus » au cours des audiences. D’où sa décision si courageuse, si risquée, si libératrice pour d’autres femmes, donc si politique, de refuser le huis clos. L’espoir est maintenant que les mots tant de fois répétés, « procès historique », « verdict pour l’histoire », trouvent leur écho dans la conscience des multiples champs à prendre en compte.
Le combat contre le viol est un combat sans fin que chaque génération doit hélas reprendre. Sans fin ne signifie pas sans progrès.