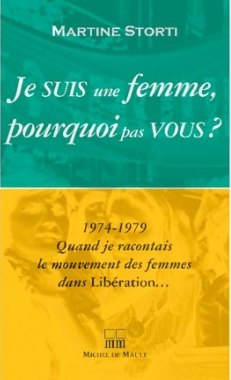Article publié dans le numéro de la revue Regards Printemps 1993 en hommage à Frank Arnal, mort du sida en janvier 1993
Vendredi 12 février
L’arrivée à Bedarieux, petite ville du département de l’Hérault, est assez sinistre. II est 13 heures.
II pleut. En cette saison et à cette heure, tout est fermé, les magasins, les cafés, les restaurants.
Personne dans les rues. Avec mon parapluie et mon petit cartable, je me sens très « hussarde de la République ».
C’est donc ça, être inspectrice générale de l’Education nationale, se retrouver dans une ville déserte, à la recherche d’un restaurant pour déjeuner avant d’aller inspecter un lycée professionnel.
Je finis par repérer l’hôtel Central, miraculeusement ouvert. Il est 13 h 30. J’entre, me retrouve dans une pièce assez sombre. Pas un convive ! Etonnée, une dame s’approche de moi en boitant : « Est-il possible de déjeuner ?» « A cette heure-là ?» Je sens bien que je dérange. Mais enfin, gentiment, on m’apporte une délicieuse aile de poulet avec du chou et des pommes de terre. En me donnant l’addition, la dame me demande si je suis representant. Parce que vous savez, à part les représentants, en cette saison, personne ne vient ici ! » Je n’ose pas lui dire que d’une cerrtaine facon, en effet, je represente, quoi, qui, au fond je n’en sais rien, le ministre, le ministère, la République ?
Jadis, Bédarieux, avec la confection des draps, le tannage des peaux, puis les mines de bauxite et les biscuiteries,avait une activité importante. La modernite a tout balayé, y compris une bonne partie de la population.
Restent le commerce et le tourisme, un tourisme vert, avec les balades sur les sentiers cévenols.
C’est le premier anniversaire de la mort de F.
F. est mort il y a juste un mois, à 42 ans. F. est mort du sida.
Demain j’irai a Toulon voir ses parents. Je sais qu’en entrant dans leur maison, je revivrai les dernieres semaines de F. Des semaines de souffrance. De tendresse. D’amour. De preuves d’amour. Des semaines où sa famille a été auprès de lui, presente, attentive, démunie face à ce corps maigre, si maigre.
Je vais donc inspecter le lycee professionnel de Bédarieux. Deux jours plus tôt, j’étais à celui de Castelnaudary.
C’est à chaque fois pareil, je tombe sur des gens dévoués, courageux, qui se battent pour leurs élèves, pas du tout l’image médiatique donnée de l’école, celle qui montre des profs déprimés, des élèves violents, drogués, désespérés. Des problèmes, c’est sûr, il y en a, un peu partout, mais beaucoup essaient de faire face. En parle-t-on ? Parle-t-on de ce directeur d’un collège de Lozère qui bénévolement donne des cours particuliers aux petites élèves maghrébines pour qu’elles rattrapent leur retard en français ? Ou de cette surveillante ZEP de Béziers qui, pour 7 000 F par mois, est présente dans son établissement de 8 heures du matin à 7 heures du soir, afin d’aider, aux heures de permanence ou de repas, les enfants en difficulté ? Quelle est la caméra qui se plante la, pour filmer ces moments ? J’ai droit à la visite de tout l’établissement, l’atelier menuiserie, l’atelier poterie, l’atelier graphisme, l’atelier gros-oeuvre, l’atelier électricité. Chacun – élèves compris – prend du plaisir, à m’expliquer le travail effectué. Ca me rappelle le temps où j’étais journaliste : quand je faisais des reportages sur des grèves, les gens avaient envie de raconter leurs problèmes, les raisons de leur grève, mais aussi leur boulot, leur métier, ce qu’ils faisaient precisement et dont ils etaient fiers ; ils voulaient parler aussi de ça et j’étais toujours émue par leur fringale de dire ce qui occupait leur journée, heure après heure. Les enseignants aussi ont envie de parler de ce qu’ils font, et sans doute aussi ont-ils envie qu’on leur renvoie une image un peu positive, je ne dis pas une image qui les flatte mais une image qui les conforte dans l’importance de leur rôle. Parce que evidemment, si c’est le salaire qui donne la mesure de la reconnaissance sociale, les bateleurs d’estrades télévisuelles sont les rois.
Justement, F. était enseignant de français dans un lycée professionnel, pas à Bédarieux, à Paris. En septembre 1992, il a dû renoncer à faire cours, il n’avait plus la force d’aller chaque jour au lycée, si maigre déjà et pourtant il allait encore maigrir, avec cette difficulté sans cesse croissante qu’il avait à manger. Malgré tout, il fut convoqué à un contrôle médical, à la Sorbonne. Quand le médecin le vit, il n’eut pas le moindre doute, il se sentit même gêné qu’on ait osé convoquer F. pour un contrôle, osé lui faire monter des étages, le faire attendre dans une salle inconfortable, comme s’il était besoin de vérifier qu’il s’agissait d’un vrai malade et pas d’un bidonneur. Le sida ne fait pas partie des maladies qui ouvrent droit à un congé de longue durée, comme la tuberculose, le cancer, la polio ou la maladie mentale.
12 février, au soir
A Paris, dans une librairie du Marais, un hommage est rendu a F., F. militant homosexuel, cofondateur du Gai pied. Jusqu’à l’arrêt de cet hebdomadaire, F. y tint la chronique «Les années sida ». Je suis à Montpellier et pas à Paris. Il fait assez doux, je m’offre du champagne en pensant a F. C’est ma manière à moi de lui faire un petit signe.
Je songe à cette soirée du souvenir où je ne suis pas. Sans doute va-t-on surtout évoquer le militantisme de F. Et moi je me souviens de ce jour d’été ou nous étions quelques-uns sur un bateau, au large de Saint-Mandrier, tous à poil, la vedette de la police maritime nous a approchés pour nous demander de mettre au moins un slip de bain, c’était il y a longtemps, très longtemps, dans les années soixante-dix, c’était des années où nous étions jeunes, des années où nous pensions encore qu’on allait changer le monde, des années sans sida.
Septembre, octobre, novembre, decembre, janvier.
J’ai vu F. plusieurs fois pendant ces mois d’automne et d’hiver.
En septembre, quand je l’ai revu après les vacances, sa maigreur m’avait alors paru insoutenable, je ne savais pas qu’elle allait encore s’aggraver. C’était à Pasteur, dans une chambre au rez-de-chaussée, pleine de soleil, F. quittait l’hopital, affaibli mais debout, on est parti en voiture, il faisait beau, on a pris l’autoroute, F. était content que je sois venu le chercher, il était emu, moi aussi, je ne pouvais pas faire face à son émotion, à ses larmes, bêtement je lui demandais de ne pas pleurer, je ne voulais pas qu’il pleure, et pourtant ce sont ces larmes qui nous
ont rapprochés, un échange de larmes comme dialogue, j’avais acheté des gateaux au chocolat, je n’avais pas compris que presque tous les aliments lui donnaient la nausée, je me sentais bête, conne, nulle.
Ensuite j’ai vu F. assez souvent, à Paris, chez lui ou à Pasteur ou à Toulon, chez ses parents ou chez sa sceur.
Le sida est alors devenu pour moi quelque chose de concret. Autre chose qu’un article de journal, ou qu’un livre. Hiv, T4, AZT, DDi, CMV, HAD, des sigles qui entrant avec le sida, qui deviennent bientôt familiers, si familiers, des sigles qu’on manipule, à l’hopital, à la maison, au téléphone, entre les entrées et les sorties de Pasteur, entre les examens de l’oeil, des intestins, des poumons, entre les prises de sang et les perfs.
«Alors comment ca va ce matin ?» Pauvre question qu’on pose quand même, en essayant de faire comme si, d’avoir un peu d’espoir, de donner un peu d’espoir. C’est inutile. On le fait quand même. L’important c’est d’être là, de parler, avec F., avec ses parents quand ils l’accompagnent à Paris.
Samedi 13 février
Je suis à Toulon. II y a juste un mois, F. était enterré par un matin gris et froid dans un joli cimetière varois qui sent le pin. Un enterrement civil et dans l’intimité, selon ses vceux. L’absence de cérémonie, de rite accroit la dureté du geste -. mettre quelqu’un en terre. Je vais à pied, en longeant la plage, jusqu’à la maison des parents de F. II fait un soleil magnifique.
En decembre aussi, il faisait beau. Et aussi en novembre.
En novembre, F. se levait encore. Il allait sur la terrasse de sa chambre, il regardait la mer, il parlait de son amour pour la vue qu’il avait de cette terrasse, les plages du Mourillon, la bale de Saint-Mandrier, une vue qu’il connaissait depuis l’enfance, même qu’avant elle était plus belle, la côte était sauvage, pas aménagée pour les touristes, avec pistes cyclables, restaurants, parkings, aires de jeux, toboggans.
En novembre, il pouvait encore sortir, parler, chanter, comme cet après-midi passé en famille ou nous nous sommes mis à fredonner les chansons venues de l’enfance, «A la claire fontaine », « Auprès de ma blonde », « Fleur d’épine », « Trois jeunes tambours », « Sur l’pont du Nord »… F. était allongé sur un canapé, et il chantait doucement, presque joyeusement.
Je marche le long de cette plage, sous le soleil, en compagnie d’un garcon de 11 ans qui me parle du match de foot qu’il va disputer à quatre heures. Ce match est important puisque de lui depend la montée de l’équipe dans la catégorie supérieure ; j’écoute passionnément cet enfant pour ne pas penser aux parents de F. que je vais revoir dans quelques instants, ou plutot pour ne pas penser à ce que je vais voir dans leurs yeux, cette peine encore brutale, pas encore maîtrisée, domestiquée, des yeux qui disent que l’habitude n’est pas encore prise de vivre avec 93, la mort de leur fils cadet.
Dans ses chroniques du Gai pied, F. ecrivait : « De l’amour, c’est ce que demande un malade du sida ». De ses parents, de sa famille, F. a eu, dans les derniers mois de sa vie, tout 1’amour du monde, pas un amour abstrait, pas seulement un amour de mots, mais un amour de gestes, avec ces semaines et ces journées qui lui furent tout
entières consacrées, dans l’espoir et le désespoir. Il écrivait aussi dans ces chroniques hebdomadaires à plu-sieurs voix qui dressent inévitablement la sinistre comptabilité des morts : « sa mort (celle d’un ami mort d’une crise cardiaque) est de celle qu’on peut souhaiter à tous les malades : il a sauté le pas du délabrement final ». Ce pas, F. ne l’a pas sauté, il a dû supporter toux, vomissements et diarrhées incontrôlables. On n’imagine pas ou peu, de l’extérieur, ce que c’est que ce putain de sida, dans quel état il met ceux qui en sont atteints, dans quel état physique et moral, cuvette, couches à changer, perfusion continue pour éviter la deshydratation, F. a connu ça, il disait «j’en ai marre, j’en ai marre », mais il a connu aussi tout cet amour du monde…
La chambre était dans la pénombre, malgré les volets et rideaux tirés, on sentait bien que dehors il faisait soleil, un gai soleil de l’hiver méditerranéen. Autour du lit de F. une attention constante, instant après instant, une écoute de sa respiration, une angoisse à la moindre irrégularité de cette respiration qui rattachait F. à la vie, et des caresses et des bisous, et la lecture des cartes envoyées par les amis ou les collègues de travail au moment de Noël, ça lui faisait plaisir, à F. que ces cartes lui soient lues, et les visites aussi, il aimait ça, même s’il ne pouvait tenir les yeux ouverts que pendant de brefs moments, il demandait : « à quelle heure arrive X ?, par quel train vient Y ?» et les rigolades aussi au milieu des chuchotements pour faire semblant et aider les autres à faire semblant.
Qu’est-ce qui se passe pour les malades du sida abandonnés par leur famille ou leurs amis ? Qui est auprès d’eux ? Qui leur parle ? Qui leur prend la main ? Qui les embrasse ? « Ce que demande un malade du sida, c’est de l’amour ». Je cite à nouveau ce qu’ecrivait, en juillet 1991, F., lui qui a été à l’ecoute de tant de malades.
Lundi 15 février
Je suis rentrée à Paris. Exceptionnellement il fait beau. Je lis les chroniques de F. dans leur integralité. Et son mémoire sur la prévention du sida en milieu homosexuel. Un mémoire comme un cri de rage, parce qu’il n’y a pas eu de veritable politique de prévention, comme si les pédés, après tout, n’avaient qu’à crever. Je m’apercois que F. a passé ses dernieres annees dans une gigantesque colère, du moins c’est ce qui ressort de ses textes, une colère contre le gouvernement, le corps médical, l’Eglise, les journalistes.
Mardi 16 février . ;..•
J’ai relu ces derniers jours quelques romans de Zola, dont la Curée et I’Argent. Que faut-il changer ? Quelques éléments du décor, quelques détails vestimentaires, quelques noms de rues peut-être ? Pour le reste, les spéculations immobilières et boursières, les fortunes rapidement faites et défaites, 1’affairisme brutal, on ne sait plus si l’on nous parle de la fin du siècle dernier ou de ce qu’on lit chaque jour dans le journal!
Mercredi 17 février
Michel Rocard nous annonce un big-bang politique. Outre le big-bang, chacun découvre l’existence de Montlouis-sur-Loire, petite ville d’lndre-et-Loire. Le big-bang fait la « une » des medias. Sans formule, pas de titre. Donc chaque homme politique peaufine avant tout expressions et petites phrases choc afin d’être assuré d’une reprise médiatique. Sinon, c’est le silence. Le discours de Rocard vaut plus que le big-bang. Qu’on soit d’accord ou pas avec «le candidat naturel», reconnaissons-lui au moins le mérite d’avoir utilisé les treteaux pour dire quelque chose. Par les temps qui courent, c’est presque du courage. « Pour transformer le monde, il faut le comprendre » nous rappelle l’ex-responsable du Psu. Qu’il faille penser le monde tel qu’il est devenu est en effet d’une absolue necessité. Souhaitons que Rocard ne se contente pas, avec sa proposition d’un regroupement inédit de forces politiques concurrentes, d’une stratégie de conquête du pouvoir.
Fou de rage, F. notait, en février 1992 : « la débandade socialiste des élections futures sera une leçon historique de taille. On ne brade pas ses valeurs au profit d’une inhumanité technique».
Jeudi 18 février . –
J’emmène ma mère au théâtre assister à une représentation des Monstres sacrés de Jean Cocteau. Ma mère est ravie de voir Michèle Morgan et Jean Marais. Je faisais la fine bouche, j’avais tort. D’abord la pièce ne manque pas d’intérêt, avec son éloge du théâtre et sa critique de la radio et d’Hollywood (Cocteau hurlerait s’il était là aujourd’hui !) ; ensuite parce qu’on est pris par le bonheur de jouer et de vivre qui se dégage des deux acteurs. Ils ont 70 et 80 ans. Ils nous emportent avec eux, on sort de la ragaillardis et heureux.
Vendredi 19 février ,
Je lis dans le Monde que le procès de Klaus Croissant s’est ouvert le 10 février à Berlin. L’ex-avocat de la Fraction armée rouge est accusé d’avoir été un informateur de la Stasi.
Je me souviens des manifs de novembre 1979 organisées à Paris pour empêcher l’extradition de Croissant en Allemagne. La première fut interdite, et pourtant plusieurs milliers de personnes réussirent à se regrouper à Montparnasse. La seconde, trois jours plus tard, rassembla 10 000 personnes place de la République. Tout le monde – à gauche et à l’extrême gauche – était contre cette extradition.
C’était dans une vie antérieure. dans un monde antérieur. C’etait dans un monde où il y avait le mur de Berlin.
C’était dans un monde où il n’y avait pas le sida.
A la fin de son mémoire, F. écrivait . ” Concluons donc sur ce désespoir planétaire dans lequel on inclut la mort
passée et future de tous nos amis et leurs amants. Leur souffrance servira-t-elle à quelque chose ?
Notre douleur. elle, ne peut les oublier.»
Martine STORTI.