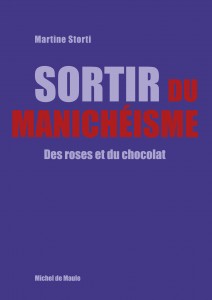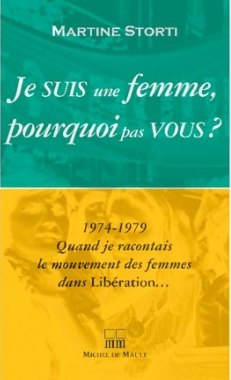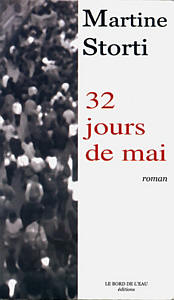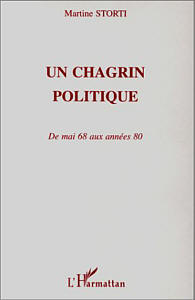Dans « Sortir du manichéisme » (ed. Michel de Maule, 2016), Martine Storti, présidente des 40 ans du MLF, s’attaque aux lectures binaires du réel et exhorte à en embrasser la complexité. Entretien paru dans Les Inrocks Mai 2016
.https://www.lesinrocks.com/actu/penser-termes-didentite-piege-71287-07-05-2016/
« Alors que depuis quelques années tourne en boucle la double exhortation de Charles Péguy – « Il faut dire ce que l’on voit » et « voir ce que l’on voit »-, j’ai plutôt l’impression que chacun ne voit que ce qui l’arrange » écrit Martine Storti, ancienne journaliste à Libération et présidente de l’association féministe des 40 ans du MLF, dans Sortir du manichéisme. Ecrit dans la foulée des agressions sexuelles survenues à Cologne la nuit du Nouvel An, son essai pointe le danger de lire l’actualité de façon simplifiée, et appelle à la modération en retrouvant le goût des idées.
Pourquoi notre société serait-elle manichéenne selon vous ?
Martine Storti – Le manichéisme est moins dans la société que dans les débats politico-intellectuels. Charles Péguy nous dit qu’il faut « voir ce que l’on voit », je me permets d’ajouter qu’il faut voir avec ses deux yeux, autrement dit ne pas être dans le « ou bien/ ou bien » mais plutôt dans le «et… et ». Par exemple, dénoncer la manière dont l’anti-racisme est dans certains cas devenu identitaire et communautariste – je pense notamment aux Indigènes de la République -, et dénoncer la droitisation de la laïcité, la façon dont elle a été transformée par certains – je pense notamment à Riposte laïque, en affirmation identitaire alors qu’il s’agit d’un concept politique. Il faut refuser l’enfermement identitaire prôné par Renaud Camus et celui prôné par les Indigènes de la République. La division entre Blancs et non-Blancs ne me paraît pas plus acceptable qu’entre les « de souche » et les « pas de souche ».
Le manichéisme, c’est refuser de penser au moins deux choses à la fois, d’avoir en même temps deux points de vue. Ainsi concernant l’islamisation de certains quartiers, il faut prendre en compte à la fois l’implantation délibérée d’une idéologie religieuse et politique et des causes sociales, la perpétuation du racisme qui peuvent expliquer des engagements intégristes politiques… Je suis frappée par le fait qu’aujourd’hui c’est toujours l’un ou l’autre. D’autre part, le manichéisme est aussi dans un certain spectacle médiatique. Il faut des affrontements, du combat de boxe. ONPC, par exemple, parmi d’autres émissions, fonctionne ainsi. Est-ce que le public demande de tels affrontements ou bien prend-il ce qu’on lui propose? Je pense que pas mal de gens sont comme moi fatigués de cette forme de débat.
Est-ce à dire que les idées disparaissent dans le spectacle médiatique ?
Du moins, elles se durcissent, elles s’autocaricaturent. Je suis affligée de voir que certains intellectuels se plient à ce jeu. Quelqu’un comme Alain Finkielkraut qui dénonce depuis des années la « défaite de la pensée » et vilipende l’école telle qu’elle est aujourd’hui s’est complètement plié à ce mode de fonctionnement. C’est évidemment son droit, mais alors qu’il ne donne pas de leçons de morale intellectuelle. Pour obtenir un match de boxe, il faut de l’affrontement et donc un fonctionnement sur le mode noir/blanc. Il me semble que le réel est plus complexe…
Le débat n’avance-t-il pas, aussi, avec des affrontements ?
Je ne prône pas le consensus, les désaccords sont nécessaires, ils sont même consubstantiels à la démocratie, je condamne les affrontements binaires et systématiques, qui conduisent à un durcissement des positions. Je ne cherche pas non plus le juste « milieu », un « entre-deux ». Je m’efforce plutôt de dire ce qu’il faut, selon moi, mettre à distance. Par exemple, je mets à distance l’analyse du monde sous le prisme de l’identité. Si l’on pense le réel en termes d’identité, on est dans l’affrontement et dans l’exclusion des uns par les autres. En trente ans, on observe que la pensée en termes d’identité est devenue majoritaire dans tous les camps. L’identitarisation chez Renaud Camus et l’approche identitaire des Indigènes de la République fonctionne avec le même logiciel si je puis dire.
La quête de l’identité ne se trouve-t-elle pas, de fait, au fondement de l’individu, et par conséquent au fondement de la société ?
Oui mais nous sommes pluri-identitaires. Qu’est-ce que je suis en définitive? Une femme, fille d’immigré italien, d’origine catholique mais athée, âgée, qui a vécu telle ou telle chose, etc. Fixer l’identité, c’est l’enfermer, l’essentialiser. L’identité française change. Il faut la penser en fonction de ce qu’on est aujourd’hui. Il faut prendre l’identité au jour J. Dans ce livre, je dis de manière un peu provocante que je me mets debout quand j’entends la Marseillaise. Mais je ne vais pas pour autant dire que pour être français, il faut se mettre debout chez soi dès qu’on entend la Marseillaise à la télévision ! Penser en termes d’identité c’est un piège, un égarement.
Qu’est ce qui est à l’origine de ce besoin d’identité ?
Je n’ai pas la réponse. Et d’ailleurs s’agit-il d’un besoin? Au plan politique l’identité est revenue sur le devant de la scène au début des années 80, très vite après l’élection de François Mitterrand. Il faut rappeler qu’à ce moment- là, pour une partie de la droite, la gauche élue au suffrage universel et entrant dans les palais nationaux, ce n’est pas vraiment la France. Deuxième point : le retour du FN sur la scène politique en 1983 remet sur le tapis la question de l’identité, qui avait été balayée par le nazisme, le pétainisme. Jusque-là l’identité renvoyait aux années sombres de la France, de l’Occupation. C’est à ce moment-là qu’est organisé par le club fabiusien Espaces 89, un colloque sur l’identité française, pour ne pas laisser au Front National l’instrumentalisation de l’identité française et surtout la définition de son contenu : à une identité française blanche, chrétienne etc nous opposons une identité plurielle, historicisée, incluant des apports multiples…
Vous allez jusqu’à parler d’un écho aux années 30…
J’évoque surtout la fin du XIXe siècle, la France « serrée autour de ses églises et de ses cimetières, communiant dans le culte des ancêtres », telle que l’évoque Zeev Sternhell dans son important ouvrage Ni droite ni gauche. J’ai récemment lu La France juive d’Edouard Drumont. Ce que l’antisémite Drumont dit alors des Juifs, ou pour prendre un autre exemple de l’émancipation des femmes résonne étrangement avec ce que l’on peut lire aujourd’hui à propos des musulmans, mais aussi des femmes, sous la plume par exemple d’un Eric Zemmour. Le « Grand remplacement » cher à Renaud Camus rappelle les propos de Drumont sur les juifs : le fantasme de l’invasion, et de la conquête, l’incapacité à s’assimiler… Mais l’idéologie, ce n’est pas le réel, c’est la manière dont on le perçoit, dont on le pense, dont on le restitue. Ainsi, Finkielkraut juge que l’immigration a des effets de « fragmentation » du territoire ou de « désintégration nationale ». Mais est-ce l’immigration en tant que telle ou son traitement?
Fait-on face à l’échec de l’intégration ?
La séparation a hélas toujours existé, entre les quartiers ouvriers et les quartiers bourgeois par exemple. Mais cette séparation sociale s’est accentuée au fil des décennies, a été surdéterminée par une séparation ethnique ou d’origine géographique. L’homogénéisation à caractère ethnique et religieux s’est opérée. Or, on aurait pu avoir une autre politique. Pourquoi ne l’a-t-on pas eu alors que depuis des décennies droite et gauche nous parlent d’une « politique de la ville »? Cela étant dit, je ne crois pas que l’on puisse parler d’échec de l’intégration. Nombreux sont les femmes et les hommes que l’on dit « issus de l’immigration » – ce qui est incroyable car beaucoup sont nés en France, voire sont enfants de gens nés en France- qui ont des parcours différents, et qui sont « intégrés », avec leur singularité, leur individualité.
Et puis, au fond, ça veut dire quoi être intégré et ne pas être intégré ? Est-ce qu’on n’entend pas, par-là, que ceux qui ne sont « pas intégrés », ne sont pas devenus ce qu’on aurait souhaité qu’ils deviennent, ou ne sont pas devenus comme « nous » ? Le nous renvoyant à cette fameuse « identité ». Dans L’Identité malheureuse, Finkielkraut parle de « deux peuples ». Or, je regrette, mais je ne fais pas peuple avec Marine Le Pen. Et puis c’est quoi le peuple ? Il ne serait que le mâle blanc hétérosexuel ? C’est le peuple peau de chagrin, une conception étroite du peuple, un peuple identitaire.
Avec Cologne, on a eu le sentiment que le féminisme était parfois instrumentalisé pour servir des discours islamophobes…
L’instrumentalisation de la question des femmes est très forte en effet. Il y a même une centralité de la question des femmes puisque les affrontements identitaires se jouent aussi et peut-être surtout sur cet enjeu. C’est extraordinaire que soudainement l’Occident prétende que l’égalité femmes-hommes fait partie de son identité, alors que c’est une conquête, que des siècles de combat ont été nécessaires pour parvenir à une émancipation qui est très importante même si elle n’est pas achevée. Rabattre l’émancipation des femmes sur l’identité, c’est lui ôter son caractère universel. L’émancipation des femmes est le produit d’une histoire et elle peut donc être le produit d’une histoire pour toutes, comme la démocratie, avec des spécificités bien entendu.
Propos recueillis par Carole Boinet

Martine Storti, Sortir du manichéisme, éd. Michel de Maule, mars 2016.
i