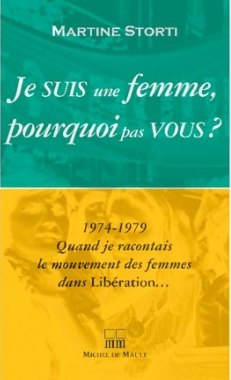Tribune que j’ai publiée dans Le Monde (27 décembre 2021)
C’est un refrain : la gauche aurait abandonné le « social » au profit du « sociétal », ce qui expliquerait que « les classes populaires » s’en détournent. Ce cliché qui se donne pour une analyse sociopolitique est repris à la fois par quelques farouches partisans d’un anticapitalisme radical, mais surtout par celles et ceux qui manient quasi quotidiennement cette opposition entre le social, qui serait du côté du peuple, et le sociétal, qui ne serait que du côté, au choix, des « élites », des « bobos », et autres tenants du « gauchisme culturel » ou du « wokisme ».
Le terme « sociétal » recouvre bien des choses souvent mises ensemble avec des formulations différentes selon les auteurs : l’« attention portée aux minorités », les luttes contre les discriminations de sexe, de genre, de sexualités, d’origines, les luttes contre les violences sexuelles, le sexisme, la misogynie, la parité, l’« insécurité culturelle », les enjeux identitaires, sauf celui qui renvoie à l’identité française ! Ce questionnement-là serait en effet très acceptable car il vient, nous dit-on, du « fond du peuple ».
Comment ne pas voir que sont ainsi réactualisées des conceptions que l’on pouvait croire définitivement derrière nous, lorsque les revendications féministes, les luttes contre les discriminations liées au sexe et aux sexualités étaient considérées comme ni importantes, ni sociales, ni politiques ? Le sociétal remplacerait-il « la tare des classes bourgeoises dégénérées », pour reprendre les expressions du procureur Nikolaï Krylenko qualifiant ainsi dans l’URSS stalinienne des années 1930, « l’inversion sexuelle » ? Faudrait-il revenir aux positions du Parti communiste français, aux années où le féminisme était traité de « bourgeois » ? A Maurice Thorez [alors secrétaire général du PCF] déclarant, en 1956, « que le chemin de la libération de la femme passe par les réformes sociales, par la révolution sociale, et non par les cliniques d’avortement » ? A Jeannette Thorez-Vermeersch affirmant que « le birth control, la maternité volontaire, est un leurre pour les masses populaires mais c’est une arme entre les mains de la bourgeoisie contre les lois sociales » et demandant : « Depuis quand les femmes travailleuses réclameraient le droit d’accéder aux vices de la bourgeoisie ? Jamais. »
Une représentation du peuple laide, sombre, triste
Justement, pour les femmes, la séparation entre social et sociétal n’a été et n’est d’aucune pertinence. Dans les enjeux qualifiés de sociaux, elles sont en première ligne : précarité, temps partiel imposé, bas salaires, faible retraite, pénalisation à cause des grossesses, plafond de verre, exploitation d’une main-d’œuvre féminine à l’échelle mondiale. Mais elles sont aussi concernées par les enjeux qualifiés de sociétaux : les violences, le partage du travail domestique, les structures familiales, les grossesses non désirées, le sexisme, les questions d’indépendance, de pouvoir, de reconnaissance… Et ces enjeux, contrairement à ce que certains se plaisent à affirmer, ne concernent pas que les « blanches » ou les « riches », ou les Occidentales.
Or, ce qui se disait dans les années 1950 et contre quoi les mouvements féministes, et plus largement les mouvements d’émancipation, ont dû se battre se retrouve à nouveau brandi en « défense du peuple ». Il y a bien du mépris dans cette idée que ledit peuple, hier comme aujourd’hui, ne serait concerné que par des enjeux économiques, sociaux, et que rien d’autre ne l’intéresserait. Bien du mépris dans cette idée que les droits des femmes, ceux des homosexuels, les nouvelles manières de faire famille ou d’être mère et père, les rapports entre les parents et les enfants, les « stéréotypes de genre », ne le concerneraient pas.
Ces autoproclamés défenseurs du peuple enferment celui-ci dans une représentation laide, sombre, triste ; ils l’identifient à la peur, à l’immobilisme, au repli, au retour vers le passé comme si des membres des classes aisées en étaient exonérés, au désir que tout redevienne comme avant, ainsi qu’on nous le répète chaque jour.
« Du pain et des roses »
C’était quoi « avant » ? Les soixante heures d’usine, malgré les quarante heures légales ; les trois semaines de congés payés une seule fois dans l’année ; les journées devant la machine malgré la grippe ou la bronchite sinon sautaient toutes les heures supplémentaires, celles qui permettaient de mettre du beurre dans les épinards ; les enfants d’ouvriers qui ne voyaient pas souvent les portes du lycée s’ouvrir devant eux ; les avortements sanglants chez la faiseuse d’anges ; la puissance patriarcale, en droit et en fait… Je ne suis pas en train de remonter à Zola, je parle du temps de mon enfance, celui des années 1950.
« Du pain et des roses », voilà ce que réclamaient les ouvrières grévistes de l’industrie textile américaine au début du XXe siècle. « Luttons pour les roses, pas seulement pour le pain », chantaient-elles. Le pain est indispensable, mais les roses ne sont pas superflues, elles sont nécessaires, terriblement nécessaires. Les roses ? C’est-à-dire le droit à la liberté, à l’émancipation, à la maîtrise de sa vie, la beauté, la création, la légèreté, le plaisir d’être. Les roses valent autant que le pain.
Pour le dire dans le langage d’aujourd’hui, le social et le sociétal ont la même valeur. Plutôt que les opposer, ce qui mène à une impasse, préférons souligner leur enrichissement réciproque et fructueux.