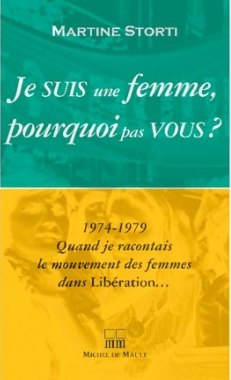Lampedusa : j’y suis allée en 2006, lorsque j’écrivais L’arrivée de mon père en France, déjà et depuis des longtemps, les naufrages, les morts, les larmes de crocodile… 2013, sept ans plus tard, rien n’a changé, pardon, si cela a empiré !
Ci dessous un extrait de L’arrivée de mon père en France
Eté 2007. Les dépêches se succèdent, les articles, les reportages, les images. Un soir, au journal télévisé, on nous montre une vidéo, quelques secondes d’une embarcation pleine à craquer, dans les parages des côtes maltaises et libyennes, puis on nous indique que le rafiot a disparu avec ses cinquante-sept passagers. Mais on ne nous explique pas comment une telle « disparition » a été possible, alors que le bateau avait été, pendant un moment au moins, surveillé par des caméras et des objectifs !
Un autre jour, on apprend que la frégate française La Motte-Picquet a repêché dix-huit corps au large de Malte. Douze hommes, quatre femmes, deux enfants, décomposition avancée des cadavres « vraisemblablement à l’eau depuis plusieurs jours », nous dit-on. Etaient-ils sur le rafiot filmé quelques jours plus tôt ou ces cadavres viennent-ils d’un autre naufrage ?
Encore un autre jour et une photo, prise par le commandant d’un avion de l’armée italienne, qui fait le tour de la planète. Des hommes sont en pleine mer, accrochés aux cages d’élevage de thons. On nous précise qu’ils sont restés ainsi pendant trente-six heures, alors que les cages étaient rattachées à un remorqueur maltais qui faisait route vers l’Espagne. Le capitaine du bateau savait que vingt-sept types étaient accrochés à ses filets mais a refusé de les prendre à son bord, de peur que l’armateur de son navire ne lui fasse des histoires, le chargement de thons étant trop précieux pour courir des risques. Selon un quotidien britannique, le dit capitaine aurait déclaré : « on n’échange pas un million de dollars contre un million de problèmes ». Voilà, on est en plein dans le réel, où les hommes valent évidemment moins que les thons, ou plutôt que le fric que ces gros poissons rapportent.
C’est d’un épisode de ce genre que je tire la certitude de la barbarie, de sa possibilité à venir, à revenir. La certitude que tout pourrait recommencer. Un type en laisse d’autres des heures attachés à des filets, il le sait, il les voit, il ne bouge pas, il ne fait rien pour mettre fin à leur supplice, il n’est pas spécialement salaud, il ne déteste pas particulièrement les hommes accrochés au filet, il a peur, il a des gosses à nourrir, il a peur pour eux, peur pour lui, il ne bouge pas, il obéit, non il n’obéit pas, il devance l’ordre, il n’attend pas qu’on lui donne l’ordre de ne pas sacrifier les thons, de lui-même il décide de ne pas les sacrifier, de lui-même il décide que la vie des hommes, donc la sienne propre en somme, ne vaut rien. Demain, il pourra aller plus loin, non seulement laisser les types dans la mer, des heures durant, mais leur tirer dessus, les descendre pour qu’ils lâchent le filet, pour qu’ils n’entravent pas la marche de son bateau, la marche de la pêche au thon, la marche du monde en marche.
Les vingt-sept hommes qui, nous dit-on, venaient de Niger, du Nigéria, du Cameroun, du Soudan, du Togo, ont fini par être repêchés par un bâtiment de la marine italienne et conduits à Lampedusa, avant d’être envoyés dans un autre centre, à Crotone, en Calabre.
A Lampedusa, j’étais allée l’année d’avant, juste après ma deuxième visite à Calais. D’une mer du Nord à une mer du Sud, il fallait bien que mon cheminement dans l’émigration et dans une certaine histoire de Matteo, me ramène vers l’Italie, oui il fallait que je repasse par ce pays devenu terre d’immigration, lui qui le fut longtemps d’émigration. Les Italiens ne quittent plus l’Italie. Mais ils expulsent ceux qui débarquent sur leurs côtes ou dans leurs îles.
De l’île de Lampedusa, les guides touristiques disent qu’elle est au sud de la Sicile, qu’elle est petite, à peine vingt kilomètres carrés, rocheuse et aride, havre néanmoins pour les chasseurs de grives dorées à l’automne et pour les amoureux de la plongée sous-marine, de la pêche, de la baignade, de la bronzette dès le printemps. Six mille habitants en hiver, vingt-cinq mille en été, cent cinquante mille en tout qui passent leurs journées sur les plages et leurs nuits dans les discothèques. Presque plus l’Europe, pas encore l’Afrique, un entre deux italien, qui, jusqu’à quelques années, n’évoquait pour moi que l’auteur du Guépard.
Guiseppe Tomasi di Lampedusa, pourtant, n’a jamais mis les pieds dans l’île dont il porte le nom. Quand il quittait la Sicile, il n’allait pas à Lampedusa, mais en France, en Angleterre, en Allemagne, dans les pays baltes. J’ignore si son arrière grand-père paternel, celui qu’il fait renaître à travers son personnage du prince Salina, y était allé, ou si la famille Lampedusa avait quelque terre dans cette île perdue entre la Sicile et l’Afrique.
A Lampedusa il y a un cimetière. Forcément. Il n’est pas loin de la mer. Pour autant ce n’est pas un cimetière marin. On l’atteint par la route qui mène à la Cala Pisana, une crique pour farniente et baignade rafraichissante. Mais de là où est le cimetière, la mer, on ne la voit pas. C’est une matinée radieuse, le ciel bleu, et un soleil déjà dur, le « soleil violent et impudent » de Tomasi, qui « épuise la turbulence des hommes. » Personne d’autre que moi dans ce cimetière, personne d’autre à errer comme je le fais entre les tombes, la plupart monumentales, les anciennes semblables à des chapelles, alourdies de stucs, de sculptures, de statues, les nouvelles, dans la partie récente du cimetière, grandes elles aussi, mais plus sobres. Non plus des chapelles mais des blocs de marbre empilés les uns sur les autres, qui ne s’enfoncent pas dans les profondeurs de la terre mais occupent l’espace découvert, s’élevant dans l’air, entre les palmiers et les cyprès, comme des maisonnettes prêtes à accueillir de nouveaux habitants, puisque les emplacements existent pour des cercueils futurs, des morts à venir, pour ainsi dire des morts attendus.
Caveaux et tombes avec les noms des familles de l’île, Tonnichi, Dimaggio, Tuccio, Migliaccio, Costanza, Sardina, Caranni, Licciardi, Lombardo, Russo, Martello, Partinicio, d’autres encore, Calogero, par exemple, ici comme patronyme alors qu’il est le prénom de l’un des personnages du Guépard, Don Calogero, celui qui, face au prince Salina dont le temps s’achève, incarne la classe montante. Il manque de chic, Don Calogero, mais pas d’argent, il ne sait pas porter le frac avec élégance, il est vulgaire mais riche, si riche que sa fille Angélique est un fort beau parti pour Tancrède, lui qui a encore un nom mais plus de fortune. D’où ce mariage, dont le désir des corps n’est pas absent mais qui est d’abord un contrat entre deux classes sociales, l’une, à son crépuscule, qui s’ouvre et s’allie à l’autre au début de son ascension. Une substitution, la place du pouvoir, de l’exploitation, de l’argent changeant d’occupants, un mouvement que Salina vit comme une déchéance : « nous fûmes les guépards, les lions : ceux qui nous succéderont seront les chacals, les hyènes. »
Ont-ils été des lions, des chacals, des hyènes ou juste des pauvres bougres, les morts de Lampedusa dont les noms sont illustrés de photos ? C’est grâce à cette coutume répandue dans les cimetières italiens que j’ai pu voir à quoi ressemblait mon grand-père paternel.
La seule photo du père de Matteo que je connaisse, je l’ai vue en effet pour la première fois lors du premier voyage en Italie, et là, devant ces photos qui ornent un grand nombre de tombes, je songe à cette première visite sur la tombe de Sandro, le souffleur de verre. Je revois ma tante Mara s’agenouiller, caresser puis embrasser le portrait de son père sous une plaque de verre collée à la pierre tombale, et je me souviens aussi du léger dégoût qu’alors âgée de douze ans j’avais éprouvé, face à ce geste que je jugeais trop théâtral, affichant le chagrin et l’amour. Je me trompais, ou plutôt j’ignorais que la part de sincérité, de peine véritable était bien plus grande que celle de comédie, avec cette manière italienne de ne pas rendre contradictoires la mise en scène et l’authenticité.
Chacals, hyènes ou pauvres bougres, les morts passés et sans doute aussi les morts à venir, ont un visage et un nom, tandis que ceux qui sont enterrés au fond du cimetière, ceux des douze sépultures vierges de toute pierre tombale et de toute photo, juste un tumulus de terre, une simple croix de bois et quelques pieds de menthe et de géraniums, sont pour l’éternité anonymes. Des douze corps qui sont sous la terre, on ne connaît ni le nom, ni l’âge, ni le sexe, la seule certitude est que ces tombes sont celles d’émigrants, arrivés à Lampedusa déjà à l’état de cadavres, soit sur les embarcations, soit rejetés par la mer sur l’une des plages de l’île, parmi d’autres cadavres à jamais gardés par la Méditerranée, à jamais perdus dans le canale di Sicilia, entre l’Afrique et l’Europe.
Quelques-uns arrivent donc déjà morts, d’autres arrivent hagards ou frigorifiés ou déshydratés, ou assoiffés ou affamés, tous ces qualificatifs sont utilisés à leur sujet, mais vivants, après une traversée épuisante, corps enchevêtrés les uns aux autres, corps qui doivent occuper le moins d’espace possible, corps mêlés et mêlées aussi la pisse, la merde, les vomissures, corps blessés, par la faim, la soif, les coups des passeurs, les salauds étant partout et de tous les côtés de la barricade ! Il n’est pas rare qu’ils soient obligés de changer de bateau en cours de route, quittant celui, assez grand, sur lequel ils ont laissé les côtes tunisienne ou libyenne, pour être transportés, à l’approche de la côte italienne, sur de petites et vieilles embarcations.
Ce sont elles qui s’entassent dans un coin du vieux port de Lampedusa, assez loin cependant des cafés, des restaurants, des discothèques et des bateaux qui promènent les vacanciers autour de l’île ou les emmènent faire des parties de pêche ou de plongée sous-marine.
Barques entassées dans le port, avant d’être débitées en petit bois, êtres humains entassés dans le centre, avant d’être expédiés ailleurs.
Lors des premières arrivées importantes, à la fin des années quatre vingt-dix, les habitants furent plutôt accueillants et charitables à l’égard des malheureux qui débarquaient sur leur île, leur offrant des couvertures ou une boisson chaude. Peut être Lampedusa voyait-elle dans ces misérables comme une trace de sa propre misère, quand ses enfants partaient ailleurs, plus loin même qu’en Italie, en France, en Allemagne, en Amérique. Mais elle ne veut plus voir cette misère passée, elle ne veut plus se souvenir de ce temps de « sales ritals » et de « sales macaronis », elle préfère ce qu’elle est aujourd’hui, une zone touristique et au fil des années, à la compassion a succédé un mélange d’indifférence et de plainte à l’égard des milliers d’hommes et même de femmes, qui « transitent », c’est le mot administratif, par l’île.
Les arrivées augmentant, un centre a été créé. Regrouper les immigrés-clandestin-sans-papiers, les mettre dans des centres, toute l’Europe de ce début du vingt et unième siècle s’y emploie. A des appellations différentes correspondent des fonctions assez semblables. A Lampedusa l’italienne, pas un CRA, comme en France, centre de rétention administrative, mais un CPTA, centro di permanenza temporeana e assistenza, centre de permanence temporaire et d’assistance. Appellation étonnante, n’est-ce pas, la permanence temporaire ou le temporaire permanent, en fait Lampedusa comme lieu de transition, peut être aussi un non lieu, ou un lieu qui ne serait plus ni italien ni autre chose, pas même un territoire, un lieu juste pour accueillir avant d’envoyer, ailleurs en Italie, ou de renvoyer.
J’ai laissé derrière moi le silence des tombes et je suis allée à pied jusqu’au CPTA. Le soleil, la mer, des criques, des plages, des maisonnettes bleues ou vertes, la campagne, la chaleur, drôle de tourisme d’un cimetière aux morts anonymes à un centre où sont retenus ? détenus ? les vivants, ceux qui ont échappé au naufrage et qui sont en attente. En attente de quoi, le sait-on exactement ?
Donc décision a été prise de créer un centre. Mais où le mettre ? Une partie de l’île, qui a été base de l’Otan, est toujours terrain militaire. Le reste, mais l’île est petite, est livrée aux estivants. On n’allait tout de même pas installer un centre de rétention sous leur nez ! Lorsque certains ont proposé de rouvrir un ancien centre datant de la période fasciste où étaient enfermés les condamnés italiens à un exil intérieur, quand même, l’idée a fait mauvais effet. Finalement le CPTA a été installé sur le terrain de l’aéroport, tout prêt de la piste qui permet l’atterrissage des Airbus et des Boeing, tourisme de masse oblige.
De la salle d’embarquement, lorsqu’on attend l’avion pour Palerme ou Catane ou Rome, on peut apercevoir, de loin, à condition de savoir ce que l’on cherche, la cour du centre, une surface bétonnée sans arbre. On peut aussi, certains jours, apercevoir quelques personnes, debout ou assises par terre, ou bien des vêtements en train de sécher… Mais quand on est à l’extérieur de l’aéroport, on ne voit que des bungalows derrière un mur de béton surmonté de barbelés, avec, devant la grille d’entrée, une voiture de police.
Comment les choses se passent-elles à l’intérieur ? Difficile de le savoir. Des mots, des images, des films pour dire et montrer, jour après jour, les arrivées, soit pour mettre en scène « l’invasion », mais presque rien sur la manière dont ceux qui « arrivent » sont traités, non dans une prise en charge improvisée, comme au début, mais une prise en charge officielle, organisée par l’Italie et par l’Union européenne. Le centre n’est guère accessible, sauf aux carabiniers ou à ceux qui y sont employés.
Il y a bien, de temps en temps, des visites de parlementaires, en particulier européens, mais même lorsqu’ils viennent au printemps ou en été, période où les arrivées sont les plus fréquentes, comme par hasard le centre est presque vide et comme par hasard un trafic exceptionnel de vols militaires a été observé dans les jours précédents. Ainsi les députés de la Commission des libertés civiles du parlement européen qui visite le centre en septembre 2005 n’y trouvent que onze personnes alors qu’il y en avait deux cents peu de temps auparavant. Les parlementaires de la gauche unitaire européenne avaient eu, quelques mois plus tôt, plus de « chance », si j’ose dire, puisque 197 personnes étaient présentes ce jour-là, mais « quatre jours avant l’arrivée de la délégation, il y en avait 900. »
Ces délégations font des rapports, qui précisent la « capacité du CPTA », 186 personnes, tout en soulignant que parfois il y en a 1000, qui présentent la structure, faite de « quatre conteneurs », oui, c’est le mot utilisé par les parlementaires, « quatre conteneurs, chacun comptant quelques 40 lits, sur deux files de lits superposés. » En comptant bien cela fait 160 places et non 186, passons. Les lits ont « des matelas de caoutchouc mousse », les matelas sont « légers et usés » précise un rapport, tandis qu’un autre affirme qu’ils « sont « nouveaux. » Tous sont d’accord pour constater qu’il n’y a pas de drap, pas de couvertures, qu’il y a « dix WC pour tout le centre », que « les WC, les lavabos et les douches n’ont pas de portes », que « les carreaux des fenêtres sont cassés », que « les douches et les lavabos sont alimentés par l’eau de mer, donc salée », eau qui « alliée à la chaleur contribue certainement à causer de redoutables dermatites qui touchent nombre de migrants du centre », tandis que l’infirmerie n’est pas « équipée pour soigner ce type d’infections. » Les rapports concluent quelque chose comme « les conditions de vie sont précaires et totalement inadéquates », ou bien « que la situation est inacceptable tant d’un point de vue humain que juridique. »
Les journalistes ne sont pas autorisés à pénétrer dans le CPTA, sauf à se faire passer pour un clandestin, comme le fit Fabrizio Gatti, de L’Espresso. Un jour de septembre 2005, il s’est jeté à la mer, non loin d’une plage, a été secouru par des riverains, pris en charge par des carabiniers, s’est fait passer pour un réfugié kurde irakien nommé Bilal Ibrahim El-Habib et est resté six jours dans le centre avant d’être transféré en Sicile. Rentré à Rome, redevenu Fabrizio Gatti, il a raconté, dans l’hebdomadaire italien, son séjour sous le titre Dans l’enfer de Lampedusa.
De l’intérieur, et pas pour une visite de quelques heures, cela donne : interrogatoires, prise des empreintes digitales, attribution d’un billet portant un numéro matricule, fracas assourdissant des avions, les jets d’air chaud envoyés par les Airbus manœuvrant sur la piste de l’aéroport vers les fenêtres de la pièce où dorment les immigrés, mauvaises conditions matérielles et sanitaires, nombre insuffisant de lits, nourriture dégueulasse, saleté, puces qui infestent le centre, merde qui déborde dans les toilettes, portes cassées, absence d’intimité… Fabrizio Gatti a raconté d’autres choses encore, les coups sur la tête, les coups de poings, les gifles de gants de cuir donnés sur les oreilles, l’obligation de s’asseoir dans des écoulements d’urine, les humiliations, les actes racistes infligés par les gardiens, par exemple des musulmans mineurs obligés de regarder des photos pornographiques sur le téléphone portable des carabiniers… Evidemment, tout cela assez loin de nos prêches droits-de-lhommistes.
Après la publication de l’article, l’Italie tout entière s’est scandalisée, les politiques se sont émus, des grands mots ont été brassés, on a parlé du « trou noir de la démocratie », du poids qui « pèse sur la conscience de l’Europe »… Des parlementaires ont interrogé le gouvernement, d’autres ont fait une visite mais ce jour-là le centre était vide, puis plus rien. Ou plutôt si, quelques articles, toujours les mêmes, pour raconter à nouveau l’arrivée, les barques secourues, les types accueillis, quelques articles pour dire l’invasion qui continue.
Et si nous sommes envahis, assiégés, ne faut-il pas nous défendre, y compris en traitant les migrants-clandestins-sans-papiers comme des stocks, du fret, à gérer, avec des objectifs d’expulsion à atteindre, du chiffre à réaliser ? Ou même en les traitant comme des hommes autres, ou comme une autre espèce d’homme, ou comme des sous-hommes?
La question est bien celle-là : pourquoi, en plus de la rétention, prélude à l’expulsion, ces mauvais traitements ? Car de nombreux témoignages, enquêtes, rapports, l’attestent. A Lampedusa, ou ailleurs, dans les pays européens ou non européens, dans des centres ou des camps, les immigrés sont maltraités. A l’inconfort matériel s’ajoutent très souvent brimades, violences, insultes, humiliations… Sur la scène européenne, pas d’ordre qui obligerait les policiers, des agents des Etats, des fonctionnaires à de tels comportements. Pas d’ordre explicite. Pas de politique d’Etat décidant, organisant, planifiant, administrant, ordonnant des violences et des humiliations. Alors quoi ? Pourquoi de telles conduites ? Parce que ceux qui les adoptent savent qu’elles sont tolérées. Implicitement tolérées. Par la hiérarchie. Par les politiques. Par le corps social. Nous tolérons ces traitements, nous tolérons des zones où le droit est bafoué, nous tolérons ces zones d’exception.
Nous tolérons l’exception et sa banalisation.
Il y a une différence, je le sais, entre une exception tolérée et une exception transformée en norme. Ce n’est pas la même chose que les immigrés soient maltraités par laxisme, par tolérance implicite que par un règlement qui relèverait d’une politique décidée. Mais que des policiers, des fonctionnaires jugent pouvoir prendre le droit – dans une quasi-impunité – de se livrer à des actes de maltraitance, bref d’utiliser cette marge que nous leur accordons – car nous la leur accordons – ne fait que me conforter, hélas, dans cette triste idée qu’il n’y a pas de barrage assuré contre la barbarie. Rien ne nous garantit en effet que demain, après-demain, un jour, il ne sera pas considéré, dans un contexte autre, une situation différente, que les brimades et les humiliations doivent laisser la place à des comportements plus radicaux. Affaires de contexte, de circonstances. Déjà je l’ai dit.
J’ai de la chance, je ne fais pas partie des clandestini, alors, ce printemps-là, en revenant de Lampedusa, je me suis offert Palerme, stucs de Serpotta, mosaïques de la Chapelle Palatine, palais aux façades décrépies, fontaines des Quattro Canti, couvents, oratoires, tête levée vers les « coupoles émaciées, aux courbes incertaines » que décrit Tomasi, flânerie dans « l’enchevêtrement des petites rues obscures. » Je me suis offert quelques heures dans cette ville où le vent aussi, comme les hommes, peut venir d’Afrique, charriant la poussière de la cité superbe, hautaine et humble à la fois, ardente, populeuse, mafieuse, qui conserve encore, soixante plus tard, des ruines de la guerre, l’argent prévu pour la reconstruction des maisons bombardées, des bâtiments écrasés, étant allé dans d’autres poches.
J’ai marché dans l’un des décors naturels du Guépard de Visconti, traîné autour du vieux palais Gangi, sans pouvoir pénétrer dans les salons où fut tournée la fameuse scène du bal chez les Ponteleone, à la fois apothéose et déclin de la vieille aristocratie sicilienne. Cette scène dont la réalisation anime la légende viscontienne, symbolisant l’exigence inouïe du maître, son souci maniaque du détail, quintaux de fleurs fraîches envoyées chaque jour de San Remo pour les différents vases du palais, vaisselles d’or et d’argent prêtées par les anciennes familles palermitaines, vraies chandelles sur les lustres, cuisines installées à proximité de la salle de bal pour que les plats arrivent encore fumants au moment du tournage, boutons d’uniforme authentiques comme les parfums et les sels des dames…
Pendant ce bal, scène d’un monde en train de mourir et d’un autre en train de naître, pour citer à nouveau Gramsci, le prince Salina se serait laissé absorber par sa méditation sur la mort, si la belle Angélique ne l’avait pas invité à valser …à chaque tour de valse une année lui tombait des épaules, il se retrouva tel qu’il était à vingt ans… Il y a moins de sensualité suggérée dans le roman de Tomasi que dans le couple superbe et ambigu que forme, le temps d’une danse filmée par Visconti, la très jeune Claudia Cardinale et un Burt Lancaster vieillissant. Le film se termine dans l’aube de l’après fête, lueur du jour qui naît et balles qui fusillent les soldats déserteurs, pour la plus grande satisfaction de Don Calogero Sedara : « maintenant nous pouvons être tranquilles.» Tranquille en effet, pour quelques décennies, la bourgeoisie qui s’installe tandis que l’aristocratie meurt comme va mourir le prince Salina. Juste avant, il s’est mis à faire le bilan de sa vie, ou plutôt, allongé devant la mer, il se livre à une étrange comptabilité, arrivant à la conclusion que sur les soixante-treize années de sa vie, le total de ce qu’il a « vécu, vraiment vécu » n’est que de « deux ou trois ans, au maximum. »
Mais qu’est-ce que vivre vraiment ?
Puis je suis retournée à Calais. Je suis remontée du Sud vers le Nord, de l’extrême pointe sud de l’Italie vers l’extrême nord de la France A Calais, ils sont toujours là, à attendre, attendre le repas distribué devant la cabina, le long du canal, près du quai de la Moselle, attendre la voiture qui les emmènera prendre une douche, attendre le repas du soir, attendre le camion sur ou sous lequel ils parviendront à se glisser, qui les emportera vers l’Angleterre. Attendre, espérer, être patient, oui, il leur en faut de la patience, de la ténacité, de l’habileté, du courage pour parvenir à leurs fins.
Plus loin, plus haut, à Loon-plage, aussi ils attendent, gigantesques parkings, alignement de camions avant leur embarquement sur un ferry, véhicules de multiples nationalités, polonais, bulgares, espagnols, turcs, portugais, slovènes, italiens, eux aussi attendent, les types tournent autour, passent journées et nuits dans des containers à marchandises situés au cœur même du port, objets, êtres humains, tout est marchandise.
En somme rien n’a changé ou presque. Et ceux qui sont là, à attendre, peut-être ont-ils commencé leur périple en quittant une côte africaine, peut être sont-ils passés par Lampedusa, ou par Malte. Certains, en tout cas, à Calais, n’y arriveront jamais. Par exemple ceux dont les dix-huit corps ont été repêchés par la frégate française la Motte-Picquet et qui ont été enterrés dans le cimetière ouest de Toulon.
Douze hommes, quatre femmes, deux adolescents repêchés le 1er juin 2007, enterrés le 7 juin, dix-huit corps mis dans des cercueils en pin et dix-huit cercueils enfournés dans des boîtes en pierre, massives, grises, alignées dans le carré numéro 7, celui des indigents, ceux qui ne peuvent pas se payer une tombe et que l’on met là, pour cinq ans, avant de les placer dans l’ossuaire.
Deux rangées de 70 tombes, 140 places en tout, au milieu des palmiers verts et des lauriers roses, non loin des tombes blanches du carré militaire, de ceux qui sont « morts pour la France ». Pour qui, pour quoi sont-ils morts, ceux qui n’ont pas de nom, qui sont sans doute à jamais sans nom ? Sur leur tombe en effet, juste une plaque « Inconnu mort en mer, mai 2007 », et une petite fleur artificielle, entre rose et violet, une fleur de plastique que seule la pluie lavera. Aucune autre indication, rien qui dise comment ces hommes, ces femmes, ces adolescents sont morts. Ni où. Ni pourquoi. Comme si on n’avait voulu garder aucune trace de la manière dont ils ont été découverts, comme si, à l’anonymat des corps, devait s’ajouter le silence de leur mort. Des corps sans nom, des vies et des morts sans récit.
Saura-t-on un jour nommer ces morts ? Nommer ces dix-huit là, et tous les autres, ces milliers d’autres, morts d’avoir voulu partir. En dressera-t-on un jour la liste? Auront-ils un mémorial ? Dira-t-on de quoi, de qui, ils ont été les victimes ? De la misère ? De l’Europe ? De l’égoïsme des riches ? Du capitalisme ? Des passeurs ? De notre indifférence ? De leur famille qui les envoie gagner de quoi nourrir la marmaille ? D’eux-mêmes, dans leur désir de remplir un devoir ? Ou dans leur envie de vivre une autre vie ?