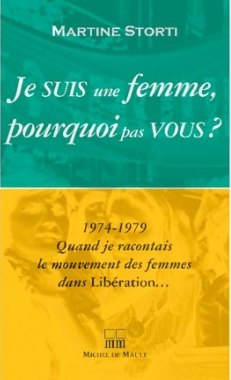Les patins à roulettes Revue La faute à Rousseau. Octobre 2011
Moi aussi j’avais des patins à roulettes. Mais ils n’avaient pas la séduction des siens. Les miens, avec leurs quatre roues métalliques, étaient bruyants, lourds, lents, vulgaires. Lui, quand il s’élançait sur ses patins à trois roues recouvertes de caoutchouc, était léger, délicat, aérien. Le luxe, la richesse, pour la fillette que j’étais dans les années cinquante, s’incarnaient d’abord dans ces patins à trois roues caoutchoutées avec lesquels s’amusait mon cousin germain. Pour mes parents la richesse passait plutôt par ces objets qu’ils n’avaient pas encore mais auraient plus tard – le frigidaire, le pick-up, la télévision, la machine à laver – et surtout par ces possessions qu’ils n’auraient jamais : la Cadillac, le grand pavillon en meulière, les meubles anciens, les bijoux, la villa sur la Côte d’azur, le manoir en Sologne… De ces objets et possessions, eux les patrons, c’est-à-dire mon oncle et ma tante, en jouissaient sans songer un instant à les partager avec ceux qui étaient restés ouvriers, c’est-à-dire mes parents.
Qu’à cela ne tienne : pas de bijoux, pas de meubles, pas de grosses cylindrées, mais la fille cadette au lycée. Ma mère à sa belle-sœur : « vous avez acheté cette commode Louis XV, Martine a le premier prix d’histoire, ce collier en diamants, Martine est première en version latine, cette Porsche, Martine est présentée au concours général… » Pas de fric donc, mais de la réussite scolaire affichée, exhibée même. A chacun ses signes extérieurs de richesse !
Avant même de comprendre que l’école serait ma planche de salut, j’ai vite compris ce qu’elle représentait pour mes parents : certes l’espoir de me voir échapper à leur condition, mais aussi, surtout peut-être, une revanche sur l’autre partie de la famille. Et sans doute ai-je joué le jeu sans en souffrir. Ma chance en effet fut d’aimer l’école, peut-être comme l’aiment (à moins qu’ils ne la détestent) celles et ceux qui n’ont pas le choix.
J’eus aussi très vite deux certitudes : l’absolue nécessité d’échapper à l’usine, mais sans passer de l’autre côté, le côté de ma tante et de mon oncle, le côté qui me lançait : « ton père est un con, il n’a pas su se débrouiller ». Ma réussite scolaire me montrait le chemin : au capital qui se constituait sur le dos des travailleurs, j’allais choisir le capital culturel, celui que l’institution scolaire me permettait d’acquérir sans faire de mal à personne.
Il fallut que j’arrive dans la prestigieuse khâgne du lycée Fénelon à Paris pour découvrir que ce capital-là aussi se transmet. Moi j’avais un capital acquis : l’histoire du monde dans l’ordre du programme, l’Antiquité en sixième, le Moyen âge en cinquième etc. Processus identique pour la littérature vue par Lagarde et Michard et assimilée année après année, classe après classe, le 17ème siècle en seconde, le 18ème et le 19ème en première, des bribes du 20ème en terminale, plus quelques lectures complémentaires faites au hasard, et surtout grâce au cinéma. Il n’y avait pas de livres à la maison mais il y avait la séance cinématographique du dimanche, du moins jusqu’à l’achat de la première télévision. C’est par exemple à leurs adaptations hollywoodiennes que je devais la lecture des Frères Karamazov ou de Guerre et Paix, dont on ne parlait pas en classe, ou bien celle de certains romans américains.
En prépa, ce capital acquis paraissait ne pas valoir tripette au regard du capital que possédaient les « héritières », non pas héritières de fric mais héritières de culture, filles de philosophes, d’écrivains, d’intellectuels, de personnalités politiques. Ce qu’elles avaient reçu, ce dont elles s’étaient imbibées à la table ou au salon de leur famille, dans les réunions, les conversations, leur donnait avec la culture, en tout cas avec les modes intellectuelles, une familiarité que je n’avais pas.
Comme mon cousin qui glissait avec élégance sur ses patins, elles évoluaient avec aisance dans la culture. Ayant lu les grands auteurs du passé – du moins en donnaient-elles l’impression – elles savaient aussi quels livres du moment étaient importants, quelles revues étaient indispensables, quels débats animaient la scène publique.
Je me suis mise, un moment, à singer les « héritières » : côté cour j’affichais une désinvolture d’emprunt, côté jardin je travaillais d’arrache-pied non pour être bien vue des profs ni même pour viser une entrée à Normale sup’ mais pour me faire admirer de ces filles. Le critère de la reconnaissance étant la réussite en philosophie, je mis un point d’honneur à obtenir de bonnes notes – et parfois la meilleure – aux dissertations. Collée à Normale sup’, je filai à la Sorbonne, bien sûr en philo. Bientôt ce fut mai 68. Un Mai qui ne fut pas juste une monôme de fils et de filles à papa, comme certains se plaisaient, se plaisent encore à le dire. Mais un moment de grâce, de bonheur collectif parce que tentative, une de plus, de sortir des « eaux glacées du calcul égoïste ».
Juillet 2011