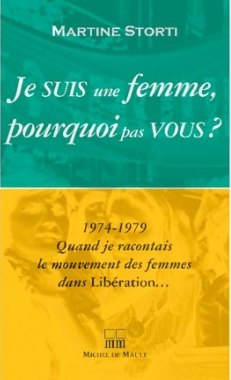Texte publié par la revue Drôle d’époque, numéro 11, automne 2002
Quand le comité de rédaction de ” Drôle d’époque ” m’a demandé un article sur mes missions en Afghanistan, précisant : ” 25 000 signes, pas plus “, j’ai d’abord pensé que c’était beaucoup. Mais dès que j’ai commencé à écrire, cela m’a paru très peu, en tout cas insuffisant, tant me submergeaient instant après instant de multiples souvenirs, de lieux, de visages, de choses vues, de moments vécus, d’impressions ressenties au cours de ces deux séjours en Afghanistan, le premier en janvier 2002, le second en mars.
Comment ne pas évoquer, même rapidement, mon premier contact avec Kaboul, fait d’impressions attendues et d’autres inattendues, en tout cas auxquelles je n’étais pas préparées ? Attendues, les ruines, mais malgré les images auparavant vues à la télévision, pouvais-je les deviner si massives, plus de la moitié de la ville détruite, larges avenues bordées de carcasses d’immeubles et de bâtiments publics ou quartiers resserrés en lambris. Attendus les hommes drapés dans une couverture brune et les quelques femmes aperçues, elles sans visage, corps et figures enveloppés dans le tchadri, fantômes bleus, furtifs et muets. Mais plus surprenant pour moi fut le spectacle de l’intense activité déployée au cœur des ruines ou dans les quartiers qui tiennent encore debout, étals de légumes, de fruits, de viandes, d’œufs, entassements de briques et de poutres, boulangeries ouvertes sur les rues, boutiques de réparateurs de toutes sortes, changeurs de monnaie, écrivains publics, photographes aux appareils d’un autre temps, gamins cireurs de chaussures, vendeurs de cigarettes, de cassettes, de raisins secs, d’épices, le tout dans une poussière inouïe et un ballet de voitures, de vélos, de taxis jaunes, de charrettes à bras… Je m’attendais, sans doute à cause d’une insistance médiatique, à trouver un peuple écrasé, brisé, à terre. Et je côtoie des gens sûrement fatigués, sûrement malades, sûrement sans ressources mais debout, dignes, énergiques et incroyablement chaleureux. Je ne m’y attendais pas, pas plus que je ne m’attendais à ce qu’existe déjà à Kaboul une rue à touristes, Chicken street, avec ses boutiques de souvenirs afghans : tapis, bijoux, poteries, verreries, cuirs, gants de peau, foulards et pacols en grand nombre, béret rendu célèbre par le commandant Massoud !Deux missions effectuées à la demande du ministre de l’éducation nationale, Jack Lang, que j’avais convaincu de la nécessité de m’envoyer là-bas, avec la certitude qui est la mienne que l’éducation doit être une composante de l’urgence humanitaire, qu’il faut lui faire sa part, toujours, pendant les guerres et les crises, et immédiatement après, sans attendre une paix définitivement assurée, ou le retour à un ordre, ou le rétablissement d’un Etat.
J’avais bien compris cette nécessité, au printemps 1999, quand j’étais allée dans les camps de réfugiés kosovars en Albanie et en Macédoine, et quelques mois plus tard au Kovoso même. S’agissant de l’Afghanistan, un simple bon sens politique (mais pas forcément présent au sein de l’administration française, singulièrement celle du ministère des Affaires étrangères) indiquait qu’il ne fallait pas s’en tenir à la seule réouverture des deux lycées franco-afghans de Kaboul (Esteqlal pour les garçons, Malalaï pour les filles), qu’il fallait aussi tenter de contribuer à la rescolarisation dans les quartiers populaires de Kaboul ou dans d’autres villes du pays ou dans les campagnes.
Donc 25 000 signes, soit une limite quantitative qui m’oblige à trier, à ne pas entrer dans trop de détails, alors que tout me paraît important, significatif, non pour faire – ou donner l’impression de faire – quelque analyse géopolitique, même pas pour donner une représentation objective, mais pour tenter de restituer une ambiance, une atmosphère – en tout cas ce que j’en perçois – de l’Afghanistan au début de l’année 2002, un pays que j’approche naïvement, n’en étant pas spécialiste, n’ayant même pas fantasmé sur lui, ni dans les années soixante-dix où une certaine mode invitait à le parcourir ni plus tard, pendant la résistance à l’occupation soviétique.
Faire un tri. Mais comment choisir ? A quoi dois-je renoncer ?
Dans les jours suivants, quand je marcherai dans la ville, dans ces rues animées, moi femme occidentale en pantalon, la tête nue, aucune marque d’une quelconque animosité mais une intense curiosité, des attroupements d’hommes et de garçons autour de moi, aussi quelques femmes parfois, qui parlent, qui me parlent dans une langue que je ne comprends pas et cette expérience, insupportable, d’avoir en face de moi des êtres humains dont je ne vois ni la bouche ni le sourire – parfois en effet j’entends comme un rire dans la voix – ni surtout le regard, oui c’est cela qui m’est le plus pénible, qui me peine le plus, non pas ces mots incompréhensibles, mais cette absence de regard, comme si les yeux faisaient l’humanité, le caractère humain.
Sept semaines plus tard, en mars, Kaboul est toujours en ruine, mais la population s’est encore accrue, Kaboulis rentrés chez eux, surtout réfugiés en quête de logement, de travail, de nourriture, plus d’animation encore, plus de 4X4 des internationaux qui commencent à arriver en masse, flambée des prix, multiplication des commerces (électroménager, informatique, vidéos), et dans les rues, davantage de femmes, encore nombreuses en tchadri mais quelques-unes tête nue ou portant seulement un foulard, telles ces enseignantes ou ces mères d’élèves, le jour de la rentrée scolaire, le 23 mars. Davantage de mendiants aussi, des enfants et des femmes au tchadri troué, sale, qui vous courent après, main tendue, répétant à l’infini : ” dollar dollar “.
Dans les ministères aussi, on réclame des dollars, car évidemment j’ai fait la tournée des ministres, ministres de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la culture, des affaires étrangères, des affaires sociales, de la reconstruction, de la condition féminine, ils ont tous un bureau, situé dans un ministère, et dans le bureau un kit fourni par l’ONU, téléphone, ordinateur, imprimante, tous sauf la ministre de la condition féminine qui, elle, n’a rien, pas de ministère, pas de bureau, pas de kit, mais elle a un 4X4 garé dans le jardin de sa maison, là où nous la rencontrons, elle dit qu’elle espère avoir bientôt un bureau et une équipe avec laquelle elle pourra travailler.
Certains ministres rentrent d’un exil parfois assez long, dans un pays voisin ou plus lointain, quelques-uns n’ont pas mis les pieds en Afghanistan depuis l’invasion soviétique ou même depuis le coup d’état communiste, presque un quart de siècle ailleurs, au Pakistan, en Inde, en Australie, aux Etats-Unis, en Allemagne…Contraste entre les ministres en costume occidental et les hommes, rarement des femmes, qui font antichambre, attendant de retrouver l’emploi qu’ils occupaient avant les Talibans ou d’en trouver un autre et contraste encore plus grand entre le ministre installé dans un bureau somme toute feutré et la multitude misérable et bariolée de la rue qui borde le ministère…Une tâche gigantesque, titanesque attend ces ministres sans ministère et sans moyens et l’ensemble du gouvernement intérimaire présidé par Hamid Karzaï : reconstruction matérielle, institutionnelle, morale d’un pays qui sort de plus de vingt années d’occupation, de guerre, d’instrumentalisations internes et externes. 
25 000 signes ! Mais impossible de ne pas consacrer quelques lignes à cette route qui court droit vers le Nord, bordée de petites pierres rouges et blanches, signe de son déminage, et qui traverse la plaine de Shamali, toujours minée, elle, ravagée, bombardée par les Soviétiques, puis ligne de front de tous les combats, tanks et camions russes rouillés, renversés, disséminés dans les champs, ruines ocre des villages dont se devine la configuration, chemins défoncés, vignobles brûlés. C’était quoi avant ? ” Le verger de l’Afghanistan, me répond Ashmat, infiniment triste, il fallait voir ça, les vignes, les arbres fruitiers, les cultures… “. Mais la tragédie humaine, la folie des hommes a tout balayé. Comment ne pas parler d’Istalif, célèbre pour ses poteries, dont il ne reste pour ainsi dire rien, ni maisons, ni écoles, ni ateliers, ni magasins. Mais dès janvier, quelques tentes, dressées au milieu des ruines. Et des gosses qui vous courent après ou qui se plantent devant vous, la mine réjouie, l’œil vif. Et ce vieillard au visage usé, courbé sous son fagot. Et cette femme en tchadri, enceinte d’au moins six mois, qui traîne elle aussi quelques branchages et à laquelle il n’est pas possible de parler, son mari répondant toujours à sa place.
Des huit écoles d’Istalif, demeurent ici des murs sans toit, là des poutres branlantes. Tout est à reconstruire. Combien de temps l’entreprise prendra-t-elle ? Mais ne faut-il pas donner rapidement un espoir à ces quelques réfugiés déjà rentrés, à ceux qui vont revenir au fil des semaines ? C’est décidé, le ministère français de l’Education nationale que je représente, financera la reconstruction d’une école, sur l’emplacement d’une ancienne école de filles. ( Mais quelle énergie il me faudra, rentrée à Paris, pour bousculer les bureaux du ministère, obliger chefs et adjoints à rompre avec leurs lenteurs et leurs pinaillages, comme si la notion d’urgence leur était à jamais étrangère !)
25 000 signes, mais tout de même, dire un mot de la vallée du Panshir, fief, chacun le sait maintenant, du commandant Massoud, route de terre battue, cahoteuse, escarpée, tant de fois empruntée par des cohortes de fuyards, mais là, dans ce jour de janvier, sous ce ciel d’un bleu intense, oserai-je parler du sentiment de paix qui m’envahit, et de beauté, oui quelle beauté dans ces montagnes enneigées, dans cette rivière qui serpente, dans ces parcelles de blé et de maïs qui au regard de Shamali dévastée paraissent des signes de vie et d’espoir. Et comment ne pas songer au potentiel de développement touristique que contient ce pays, tourisme de randonnées, de découvertes naturelles et culturelles. Mais où ai-je lu qu’il faudrait sept ans pour déminer l’Afghanistan ?
Je vais avec Chekeba voir le lycée 1d’Hannaba dont la construction, partiellement commencée, pourra s’achever grâce à un financement du MEN. Plus loin, de l’autre côté de la rivière que nous traversons à pied, c’est le village de Qalatcha, avec une école primaire installée dans la mosquée et un mollah ” libéral ” qui accepte qu’y soient accueillis garçons et filles. Chekeba parle avec le maître d’école, les gosses s’agglutinent autour de moi, ils rigolent, ils me disent des mots que je ne comprends pas, les garçons bien sûr plus audacieux que les filles, jouant des coudes pour être au premier rang lorsque je prends des photos, et bousculant sans ménagement les filles pour qu’elles ne soient pas devant l’objectif. 
Comment ne pas parler de la montée vers Mazar-e-Sharif, la grande ville du nord tenue par Rachid Dorstom et ses milices, rencontrées ce jour-là à la tombée de la nuit, alors que Mazar est encore à une heure et que le 4X4 a deux pneus crevés ? Route apparemment déserte et quinze types qui en un instant surgissent, kalachnikov sur l’épaule, hommes de Dorstom, ceux que l’on accuse de vols, de viols, d’assassinats, d’exactions diverses et qui là soulèvent en rigolant la voiture, prêtent une deuxième roue de secours, nous guident jusqu’à un garage que sans eux nous n’aurions pas trouvé – car comment penser que cette masure de tôle ondulée au bord de la route est un garage ? – Et ce jeune homme qui a la lueur d’une lampe à pétrole examine la chambre à air, la recoud d’abord avec du fil avant d’ y coller une rustine supplémentaire alors qu’elle en compte déjà une demi douzaine. Et au retour, dans le sens Mazar-Kaboul, une nouvelle panne, de radiateur cette fois et d’autres hommes en armes, qui nous ramènent jusqu’à Kaboul, l’heure du couvre-feu étant passée.
Mazar qui est largement moins détruite et qui paraît plus riche que la capitale, bazar bien approvisionné, bière en vente dans les magasins, et ce directeur régional de l’éducation à qui je demande ” combien d’écoles ? combien d’élèves ? combien d’enseignants ? ” et qui sort des poches de son veston un petit papier où figurent les réponses, ajoutant : ” c’est mon ordinateur ! ” Et Mireille, la responsable à Mazar de l’ONG Acted qui nous raconte ses distributions de vivres dans des hameaux qu’elle ne peut atteindre qu’à cheval, ou encore les effets pervers des camps de réfugiés : les gens quittent leurs villages pour s’y installer parce qu’ils y trouvent de la nourriture.
25 000 signes, mais une allusion cependant à ces repas – galette de pain, riz aux raisons secs, brochettes de moutons, thé – pris accroupis dans les chaïkhana (maisons de thé), par exemple à Djabal-us-Seradj, ou à Gulbahar, ou à Pul-i-Khumri, à Mazar, moi seule femme dans la salle centrale, seule femme au milieu des hommes, objet ? sujet ? d’une curiosité si vive, d’un étonnement si grand, mais encore une fois sans aucune agressivité, donc moi femme européenne, accompagnée d’hommes, européens ou afghans, autorisée à manger là, dans la salle centrale. Mais je me souviens de ce restaurant de Mazar où Denis et moi entrons en compagnie d’une jeune afghane qui travaille à l’Unicef et que nous invitons à déjeuner, (jeans et tee-shirt quand elle est à son bureau, tchadri quand elle le quitte – ” j’ai peur de sortir dans la rue sans tchadri “) et où tout naturellement nous nous installons dans la grande salle, ce qui suscite non plus de la curiosité mais une franche hostilité. Ce qui est m’est permis est interdit à Asina, il faut s’exiler dans une arrière-pièce, moche, sale, sans fenêtre et où nous sommes seuls.
Consacrer un instant aussi à la route qui, à partir de Peschawar, mène à Djalalabad : traversée de la zone tribale pachtoune avec un garde du corps, franchissement de la Khyber Pass, formalités de douane à Torhham, route de montagne d’abord puis, en Afghanistan, ligne droite bordée de champs de blé, d’oliviers, d’eucalyptus, d’amandiers et de pavot dont la culture reprend. L’ambassade de France à Ismalabad s’opposait à ce nous l’empruntions, car ” dangereuse “, disaient les diplomates. Mais avaient-ils une fois fait ce trajet et savaient-ils que la route était si encombrée de voitures, de camions du Programme alimentaire mondial chargés de sacs de blé et de farine, de véhicules de la Croix-Rouge, de 4X4 de l’ONU et d’ONG diverses et surtout de cars et de camions bariolés, débordant de réfugiés qui quittent le Pakistan pour rentrer chez eux ?
Djalalabad, ville pachtoune, peut être repaire de Ben Laden, mais où les enseignants de l’institut pédagogique nous expliquent en détail leurs besoins matériels mais aussi, mais surtout leurs attentes en matière de formation et d’échanges avec les autres pays, dont la France.
Comment ne pas parler de toutes ces écoles visitées, la plupart en mauvais état – deux tiers des établissements scolaires afghans détruits ou très délabrés – et ceux qui tiennent encore à peu près debout manquent souvent du confort minimal (eau courante, électricité, sanitaires) ou du matériel scolaire de base (tables, chaises, bureaux, tableaux, livres, crayons etc.) ? Les besoins en réhabilitation, reconstruction, construction sont immenses, non seulement au regard des établissements existant antérieurement mais aussi au regard des exigences en matière de scolarisation d’une population qui compte beaucoup d’enfants et de jeunes.
Souligner aussi l’immense désir d’éducation qui se manifeste après les années-taliban, années qui ont vu, on le sait, la poursuite de la scolarisation des garçons, mais dans des écoles transformées en madrasas (écoles coraniques), et l’interdit de scolarisation pour les filles. Interdit partiellement transgressé grâce à l’acharnement mis par des enseignantes à organiser des écoles clandestines.
Comment ne pas dire l’émotion ressentie en janvier, alors que c’était la période des vacances scolaires, à la vue de ces élèves, petits et grands, garçons et filles, qui, entassés dans des classes bondées, humides et glaciales, suivent, assis par terre, des cours dispensés par des professeurs qui ne sont pas payés ? Les filles, les adolescentes surtout, manifestaient un bonheur d’être là qu’il est difficile d’imaginer si l’on n’a pas croisé ces regards qui marquent un appétit et une espérance, appétit d’éducation, espérance que grâce à elle un avenir peut s’ouvrir. Et dans les yeux des professeurs, sans tchadri quand elles sont en classe, quelque chose d’une volonté, d’une force, d’une détermination qui donne confiance.
Comment ne pas s’arrêter sur la rentrée scolaire du samedi 23 mars ? Ce jour qui restera sans doute comme un jour de joie dans l’histoire de l’Afghanistan du 21 ème siècle, cette ” journée nationale de l’éducation ” qui a vu des centaines de milliers d’enfants, filles et garçons, retourner à l’école avec une excitation et une joie que partageaient enseignants et parents, malgré l’exiguïté et le délabrement de locaux qui en France n’accueilleraient pas plus de 200 élèves et qui là-bas en accueillent plus de 2000.
Comment ne pas souligner l’immense attente à l’égard de la communauté internationale, non pas une attente de compassion, ou d’assistance, ou de paternalisme, ou de substitution mais une attente de coopération égalitaire, en matière de formation d’enseignants, de pratiques pédagogiques, d’organisation des cursus, de contenus disciplinaires, de formation professionnelle, d’appui au rattrapage scolaire des filles qui peuvent se retrouver, à quinze ans ou davantage, à l’école primaire?
Comment enfin ne pas parler de Nahrin visitée presque par hasard, ce mercredi 20 mars ? Je désirais avoir un aperçu de la scolarisation en zone rurale et ainsi identifier d’éventuels projets. ” Allez à Nahrin, avait répondu Mireille, la responsable d’Acted à Mazar “. Nahrin donc, dans la province de Baghlan, à 170 kilomètres au nord-est de Kaboul. A partir de Pul-I-Khumri, trois heures en 4X4 sur une rude piste de montagne, quelques cours d’eau au bord desquels des enfants remplissent de vieux bidons portés par un âne, des vaches maigres, et puis l’arrivée à Nahrin, plus qu’un village, un gros bourg à l’habitat dispersé entre la vieille et la nouvelle ville et des habitants revenus chez eux après avoir fui les combats et la sécheresse.
Traversée de Nahrin à pied et comme je suis accompagnée par une équipe de France 5 qui tourne un documentaire sur la rentrée scolaire en Afghanistan, c’est un cortège d’hommes, de jeunes gens, de garçonnets qui ne cesse de grossir au long de la visite des écoles. Onze écoles au total, mais une seule pour les filles, excentrée et en très mauvais état. D’où l’évidence que la scolarisation des filles passe par la construction de nouvelles écoles. Mais cinq jours plus tard, c’est une grande partie de Nahrin qui sera à reconstruire, après le tremblement de terre qui a secoué l’Hindou Koush, fait 1000 morts et 20 000 sans abri. Et la certitude d’avoir, parmi mes photos des gosses de Nahrin, des visages d’enfants morts.
En cette mi-septembre 2002 où j’écris ces quelques lignes pendant que, sur fond de préparatifs d’une intervention américaine en Irak, les cérémonies du premier anniversaire battent leur plein, qu’on nous repasse jusqu’à la nausée les images de l’effondrement des tours jumelles du World Trade Center à New York, qu’on nous rabâche Ben Laden, Al Qaïda, les talibans, l’islamisme, les attentats en Afghanistan et l’insécurité qui, dit-on, ” y règne “, je voudrais, quant à moi, qu’on me dise si Nahrin, dont plus personne ne parle, (dont plus personne n’a parlé trois jours après le tremblement de terre), est reconstruite, au moins en partie. Je voudrais qu’on me raconte la vie quotidienne des Afghans, qu’on me dise le taux de l’afghani aujourd’hui, qu’on me dise combien de gens, d’hommes, de femmes d’enfants, de vieillards, de bébés meurent encore de faim, combien sont dans des camps de réfugiés et aussi si les professeurs sont payés. Je voudrais qu’on me dise combien de dollars, sur les 1,8 milliards promis pour 2002 en aide multi et bi-latérale, ont été effectivement versés, et à qui. Aux experts internationaux qui coûtent fort cher ? Aux ONG occidentales ? Au gouvernement afghan ? Au peuple afghan ?
Car si les promesses faites ne sont pas tenues, si la présence occidentale ne se traduit pas par un effet réel sur la vie quotidienne des populations, alors le risque existe que les Afghans se retournent contre elle.
Je ne suis pas retournée en Afghanistan depuis la fin mars et l’envie évidemment me tenaille d’y repartir, ne serait-ce que pour voir ce que j’appelle mes écoles, celles pour lesquelles un financement est venu du ministère de l’Education nationale, peu de chose, 300 000 euros mais qui ont permis de reconstruire trois établissements à Kaboul, un à Istalif, un à Mazar-e-Sharif, un à Djalalabad, un à Hannaba, un à Nahrin. Bien peu au regard des besoins et même au regard de ce que j’aurai aimé pouvoir faire, une goutte d’eau sans doute. Mais chaque goutte ne compte t-elle pas ?
Martine STORTI
Paris le 14 septembre 2002
1 L’appellation ” lycée ” ne désigne pas un établissement du second degré comme en France mais un établissement où se déroule l’intégralité du cursus scolaire, soit douze années (six années de primaire et six années de secondaire en deux cycles de trois ans). Seules les trois premières années du primaire peuvent être mixtes.