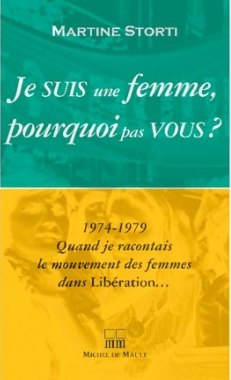Tribune parue dans Libération le 17 janvier 2022
La France a placé sa présidence du Conseil de l’Union européenne sous l’égide de trois termes : « puissance », « relance », « appartenance ». Prenons les au sérieux et allons au-delà d’un affichage rimé.
Si l’on entend par « puissance » non la domination mais la capacité à agir, à s’emparer de la complexité du présent, à préparer l’avenir, à se donner les moyens d’une indépendance et d’une souveraineté à plusieurs, alors il n’y a pas de « puissance » sans égalité entre les femmes et les hommes, c’est-à-dire sans abolition générale du patriarcat et de la domination masculine. Les inégalités entravent la « puissance » ainsi conçue, l’égalité la favorise.
La « relance », enjeu d’importance pour les pays européens, ne doit donc être que pour toutes et tous. Depuis 2 ans, la pandémie ne fait que confirmer ce que nous savions déjà : femmes en première ligne dans les emplois essentiels du quotidien et dans ceux du « care », souvent sous-payés et précaires, effets négatifs de la crise sanitaire particulièrement pour des femmes, quel que soit le pays, ce que l’Union européenne ainsi que l’ONU ont parfaitement reconnu. On attendait donc que la « relance » énonce des objectifs précis relatif à cet enjeu. Tel n’est pas le cas. Aussi bien dans le « Programme de la présidence française » ou dans ce qui s’appelle la « Facilité pour la reprise et la résilience » énoncée par l’UE, on trouve certes des généralités sur la nécessaire égalité femmes/hommes mais, comme le souligne le Haut conseil à l’égalité femmes/hommes dans son avis sur la PFUE, « aucun objectif ni qualitatif ni quantitatif contrairement aux engagements environnementaux et au numérique qui sont strictement encadrés et placés au centre du plan de relance européen »[1].
Troisième élément du triptyque français : l’« appartenance ». Sans doute est-ce le plus crucial. Car s’il s’agit de l’appartenance à l’Union européenne, force est de constater que cette appartenance est hélas à géométrie variable, puisqu’elle relève de l’adhésion à des principes politiques ou à des valeurs pour certains Etats et seulement à une appartenance institutionnelle pour d’autres. Le « conflit » – le mot n’est pas trop fort – que l’UE a avec la Pologne et la Hongrie renvoie, nous dit-on, au fonctionnement de l’Etat de droit.
C’est là que le bât blesse en particulier pour l’enjeu des droits des femmes. Car si l’Etat de droit est en effet l’une des valeurs fondatrices de l’Union européenne, la lecture qu’elle en fait est trop limitée, centrée sur quatre piliers : le système judiciaire, la lutte contre la corruption, l’équilibre institutionnel des pouvoirs, la liberté et le pluralisme de la presse. Ces critères sont pertinents mais insuffisants et les droits humains, donc les droits des femmes devraient faire partie de la définition de l’Etat de droit.
La France n’a pas mis ce point à l’ordre du jour de sa présidence, ce qui est dommage et regrettable. Il y avait là, pour un Etat qui se réclame – et il faut s’en réjouir – d’une « diplomatie féministe » un objet et un enjeu permettant de prouver la volonté de la mettre en œuvre. Car c’est par l’inclusion des droits des femmes dans la définition de l’Etat de droit que peut être combattue l’opposition que certains membres de l’UE mettent à des textes et à des politiques. Ainsi l’UE, bien qu’y étant favorable, ne peut ratifier la convention du Conseil de l’Europe contre les violences faites aux femmes (Convention d’Istanbul) parce que plusieurs Etats (Bulgarie, Hongrie, République tchèque, Slovaquie) ne le veulent pas.
Plus grave encore, l’opposition de certains états membres à un droit essentiel pour les femmes, celui de la maitrise de son corps, au fondement de laquelle se trouve les droits sexuels et reproductifs et en particulier le droit à l’interruption volontaire de grossesse. Or des Etats s’y refusent ou limitent très fortement ces droits, en défense, affirment-ils, de la famille ou pis encore de leur identité, ainsi la Pologne, ainsi la Hongrie, ainsi Malte. En outre la probable élection à la présidence du parlement européen de Roberta Matsola qui est opposée à l’IVG n’est guère rassurante.
Dans le programme français pour sa présidence, pas un mot sur l’avortement. Pour ne pas jeter de l’huile sur le feu ? Sans doute. A tort. Car les droits des femmes ne se sont jamais développés sans combat et sans affrontements, toute l’histoire de cette émancipation en apporte la preuve au fil des siècles. On a beaucoup débattu, ces derniers mois, de la conditionnalité des financements européens au respect de l’Etat de droit et à sa mise en œuvre. La conditionnalité devrait inclure les droits des femmes et le droit à l’IVG devrait être une des conditions de l’adhésion à l’UE. On connait le contre argument : l’avortement relève de la santé et la santé dépend non de l’UE mais des Etats. C’est un sophisme et un déguisement : l’enjeu de l’IVG ne relève pas d’abord de la santé mais d’un droit, celui de la maitrise de son corps.
Il n’est pas trop tard pour que la présidence française s’empare de cet enjeu car le moment est venu non seulement de faire entrer ce droit dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – ce qui n’est pas encore le cas – mais aussi de reconnaitre les droits sexuels et reproductifs pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des droits politiques.
Des millions de femmes dans le monde se battent pour eux ainsi que le Forum génération égalité qui s’est déroulé au cours du premier semestre 2021 en a apporté, s’il en était besoin, une nouvelle preuve. Sans ces droits – et le droit à l’avortement en est une composante essentielle – tous les discours si souvent répétés sur « l’égalité femmes/hommes », ou sur « l’autonomisation des femmes » sont de vains bavardages.
Dans sa conférence de presse du 7 janvier le président de la République a précisé qu’il voulait faire de la PFUE « un moment utile pour l’Europe ». Il n’est pas trop tard pour apporter aussi la preuve d’une volonté : celle d’un moment utile pour les droits des femmes.
[1] Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes « Quelles priorités pour la présidence française de l’Union européenne » Avis n° 2021-06-INT-49 publié le 28 juin 2021.