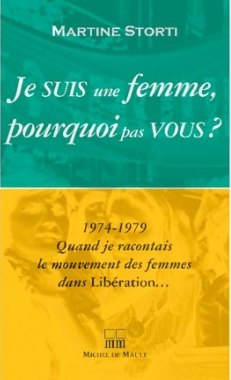Article in F magazine Juin 81
L’orageuse liaison du socialisme et des femmes
La gauche et les femmes : historiquement, une succession de rendez-vous décevants. En sera-t-il autrement cette fois, à l’heure où la France donne sa chance aux socialistes ? La réponse dans les mois qui viennent.
« L’année prochaine doit être pour les femmes ce que fut le Front populaire pour la classe ouvrière : l’année de la libération. » Qui a dit cela ? François Mitterrand. Quand ? Lors de sa première candidature à l’Elysée. Le grand vainqueur d’aujourd’hui accomplira-t-il l’ambition du perdant de 1965 ? En 1981, les femmes qui, dans l’intervalle, se sont activement occupées de leur libération, savent bien qu’une année n’y suffit pas. Mais le présent et l’avenir de la « moitié du ciel » peuvent avantageusement s’éclaircir si le ciel tout entier s’en mêle. Pendant le septennat giscardien, les Françaises ont été séduites et abandonnées. Qu’en sera-t-il sous la présidence de François Mitterrand?
Le candidat socialiste n’a pas mené de campagne spécifique en leur direction, refusant — à juste titre — de les considérer comme une catégorie sociale à part. Même s’il a jugé utile de s’entourer, sur ses affiches électorales, de deux femmes : Catherine Lalumière, spécialiste de la fonction publique, et Nicole Questiaux, du Conseil d’État. Il a cependant pris des engagements — généraux et particuliers — tout à fait importants. Pas de doute : la priorité accordée à la lutte contre le chômage et à la revalorisation du Smic profitera avant tout aux femmes puisqu’elles représentent 60 % des chômeurs et qu’elles sont cantonnées dans les salaires les plus bas. Le programme présidentiel contient bien d’autres aspects positifs. Citons, en vrac, la lutte pour l’égalité des rémunérations, l’accès à part égale des femmes et des hommes à la formation professionnelle, l’égalité à l’embauche, la réduction du temps de travail, l’augmentation des allocations familiales, le congé parental rémunéré, la création de 300 000 places de crèche, la mise en place d’un fonds de garantie pour le paiement des pensions alimentaires, une allocation veuvage qui ne sera pas inférieure à 80 % du Smic, le taux de la pension de reversion porté à 60 %, une information télévisée sur la contraception, la gratuité de l’avortement et l’allongement du délai à quatorze semaines, etc.
Même si tout ne changera pas d’un coup, même si les effets de certaines mesures ne se feront sentir qu’au bout de plusieurs mois, voire de plusieurs années, une chose paraît évidente : le pouvoir est désormais exercé par des femmes et des hommes plus proches des réalités sociales, plus soucieux de lutter contres les inégalités et les injustices.
Quels moyens le nouveau président et le nouveau gouvernement se donneront-ils pour tenir leurs engagements électoraux ?
Une antenne efficace
François Mitterrand est favorable à la création d’un « grand ministère » des droits des femmes, « peut-être même un ministère d’Etat », disait-il avant le second tour, doté d’un budget et d’une administration. Valéry Giscard d’Estaing avait innové en créant un secrétariat d’Etat, puis un ministère de la Condition féminine. Mais Françoise Giroud puis Monique Pelletier qui ne disposaient ni d’argent ni de pouvoir réel en furent réduites à un seul moyen d’action : la persuasion. Dans le nouveau gouvernement, il devrait en être autrement. Surtout si le ministère des Femmes dispose, comme il en est question, d’une antenne efficace dans chaque secteur de l’exécutif. Selon le président de la République, cette structure est indispensable pour « donner un élan sans lequel rien ne se fera ». Précisément, au-delà des dispositions organisationnelles, seule une réelle volonté politique fera bouger les pesanteurs économiques, sociales, idéologiques, culturelles qui entravent encore l’épanouissement des femmes.
Cette volonté politique s’exercera-t-elle sous le prochain septennat ? François Mitterrand, contrairement à son prédécesseur, n’a jamais cherché à passer pour un foudre de féminisme. Rappelons cependant qu’il eut, en 1965, lors de sa première candidature à l’Elysée, le courage de demander l’abrogation de la loi de 1920 afin que « soit accordé aux femmes le droit à la maternité consciente » et supprimée la plaie des avortements clandestins. Au fil des années, François Mitterrand a sans aucun doute compris l’exigence des femmes à l’égalité et au partage des responsabilités. Il a même sensiblement évolué. En novembre 1977, clôturant un « week-end femmes », il déclarait aux militantes socialistes : « J’espère qu’il ne s’agit pas ici de féminisme. » Moins de quatre ans plus tard, quelques jours avant le 10 mai dernier, il affirmait : « Le XXIe siècle amènera une transformation profonde des mœurs par le féminisme. » Le mot féminisme a donc cessé de brûler les lèvres du nouveau président. Mais François Mitterrand n’est jamais allé au-delà d’un simple assentiment aux revendications égalitaires. Il n’a jamais voulu — ou jamais pu — comprendre que la critique du patriarcat dépasse largement la lutte contre les discriminations. Qu’elle remet en cause l’ordre social dans sa totalité. Qu’elle conduit à une autre politique, un autre rapport femmes-hommes, une autre organisation du travail et surtout à d’autres valeurs. Il n’est pas d’ailleurs le seul dans ce cas, que ce soit au parti socialiste ou dans l’ensemble de la gauche.
Depuis cent cinquante ans, la gauche française, imprégnée de marxisme et de proudhonisme, témoigne de cette fantastique méconnaissance du féminisme même si les luttes révolutionnaires et les luttes des femmes ont toujours été étroitement liées Avec Proudhon, les choses étaient claires : la femme ne pouvait être que « ménagère ou putain ». Marx et Engels, plus subtils, prirent conscience que l’émancipation du prolétariat passait aussi par l’émancipation des femmes. Mais la tradition marxiste a constamment subordonné la libération des femmes à la suppression du capitalisme. Première conséquence : les femmes furent sans cesse renvoyées aux lendemains du grand soir révolutionnaire Deuxième conséquence : en attendant, elles pouvaient tout au plus participer aux luttes globales, si toutefois leur rôle essentiel de mère de famille leur en laissait le loisir ! C’est contre cette conception réductrice du combat politique des femmes que les mouvements féministes autonomes ont surgi. Et c’est contrainte et forcée que la gauche a pris en compte le féminisme.
L’histoire récente du parti socialiste liste atteste la guérilla constante, épuisante même que les militantes ont dû mener pour se faire entendre. Quand, au congrès d’Epinay de 1971, le PS. renaît de ses cendres sous la conduite de François Mitterrand, il n’existe pas de « secteur femmes ». Marie-Thérèse Eyquem a certes fondé en 1963, avec Colette Audry et Simone Menez, le Mouvement démocratique féminin. Mais bien peu fréquentent ce «club» dont l’influence est mince. En 1973 — le MLF a commencé de secouer la société française —, le congrès de Grenoble adopte le système du quota et fixe à 10 % minimum le nombre de femmes obligatoirement présentes dans toutes les instances du parti. Une mesure « imbécile », « désespérée », aux dires même de celles,qui l’ont proposée, mais nécessaire pour contrer les habitudes misogynes qui imprègnent le PS.
En 1975, une nouvelle étape est franchie avec la création, au congrès de Pau, d’une délégation nationale à l’action féminine confiée à Denise Cacheux, actuelle maire adjointe de Lille. Sa fonction ? Etre le porte-parole du premier secrétaire sur « les problèmes féminins ». Rien de plus. Elle ne dispose pas de budget, elle n’a pas d’appareil administratif. Avec d’aussi faibles moyens, la tâche de Denise Cacheux n’est pas aisée. Elle crée cependant une commission femmes, informelle, qui amorce la réflexion du parti sur les rapports du féminisme et du socialisme, et organise deux rencontres nationales, fin 1975 et fin 1976. Il faut attendre le congrès de Nantes, en 1977, pour que soit créé le Snaf (Secrétariat national de l’action féminine) dont la direction est assumée par Yvette Roudy. Ambition de la nouvelle secrétaire nationale : former les militantes pour qu’elles grimpent les échelons de la hiérarchie du parti. Mais en remplissant — et bien — ce contrat Yvette Roudy n’a pas réglé la question de fond. Le socialisme s’enrichira-t-il du féminisme ? Ou bien continuera-t-il à le prendre pour une éternelle source d’ ennuis et de complications ? Tel est l’enjeu de la Convent nationale qui se tient à Paris en janvier 1978, juste avant les élections législatives. Devant les ténors masculins du parti, deux stratégies s’affrontent. Pour la direction et la majorité des membres du P.S., l’intégration égalitaire des femmes doit régler tous les problèmes. Il suffit donc d’ajouter au programme politique général quelques paragraphes spécifiques, de favoriser la promotion des femmes, de détruire quelques réflexes phallocratiques. Mais une minorité, active et insolente, se bat pour dépasser ce minimum réformiste et reconsidérer la théorie socialiste à la lumière des questions posées par le féminisme. Par exemple, repenser le modèle de croissance en fonction du développement du salariat féminin. Ou encore changer de mode de militantisme et, plus 1argement, la conception de la politique. Cette minorité, sans doute lasse de prêcher dans le désert, lance au printemps 1978 une véritable bombe : la création d’un « courant femmes ». Trois d’entre elles ont pris la tête de la révolte Françoise Gaspard, maire de Dreux et jeune espoir du parti, Cécile Goldet, une gynécologue qui se bat depuis longtemps pour la contraception et l’avortement et Edith Lhuillier, entrée au PS en 1974.
La règle du jeu
Ce courant, éphémère dans sa réalité organisationnelle, ne le sera pas dans ses effets. Exaspéré mais interpellé, le P.S. réagit : le quota passe à 20 %, puis à 30% pour les élections européennes de 1979. Le « projet socialiste » reconnaît que la lutte des femmes ne se réduit pas à la lutte des classes. Le programme s’étoffe. SI la misogynie n’est pas définitivement éteinte, loin de là, les femmes accèdent plus facilement aux postes de responsabilité Encore faut-il qu’elles acceptent de jouer la règle du jeu et, tout simplement, qu’elles ne se réclament pas du féminisme, sinon discrètement. Car celles qui ne sont pas assez dociles sont bien vite marginalisées et éloignées des sommets. Avant les élections présidentielles, le comité directeur P.S. comprenait 27 femmes sur 130 membres, le bureau exécutif, 5 femmes sur 27 membres, et le secrétariat national 4 femmes sur un total de 20 personnes. Côté mandats électifs, la situation n’est guère brillante : une seule femme est maire d’une ville de plus de 30 000 habitants (Françoise Gaspard à Dreux). Pas une femme ne préside un conseil général à majorité socialiste. Et le groupe socialiste à l’Assemblée nationale ne compte que deux députées (Marie Jacq et Edwige Avice). La féminisation sera-t-elle plus importante lors des prochaines élections législatives ? Les dirigeants du P.S. s’abritent facilement derrière la démocratie pour justifier du petit nombre d’élues : c’est la base qui décide des investitures et la base est à l’image de la société tout entière. En réalité, désigner une femme, c’est exclure un homme. Et ces messieurs ne sont pas vraiment disposés à céder la place qu’ils ont occupée tant d’années sans qu’elle leur soit disputée. L’an dernier, le P.S. a étudié la proposition de Véronique Neiertz, secrétaire nationale aux droits des femmes : modifier le système d’investiture en réservant une circonscription sur quatre à une candidate. Mais cette procédure, qui n’a pas encore été entérinée par la direction du parti, ne pourra s’appliquer complètement lors des législatives de juin. Pour ces dernières, seules quelques circonscriptions seront réservées et nous saurons fin juin si la prochaine Assemblée nationale compte davantage de femmes. Pour ce qui est du gouvernement, François Mitterrand a pris, avant son élection, des engagements précis en déclarant à F. Magazine : « Des femmes seront membres du gouvernement que je demanderai au Premier ministre de constituer. Il me paraîtrait normal, précisait-il en outre, qu’assez rapidement il y ait, au sein du gouvernement, autant de femmes que d’hommes. » Attendons le second gouvernement — qui comptera vraiment — du septennat Mitterrand, constitué après les élections législatives de juin pour tester la fidélité du président aux promesses du candidat. Test quant au nombre et à la répartition des portefeuilles. Mais la féminisation du gouvernement nécessaire et légitime, n’est pas suffisante. La capacité d’action et d’écoute compte autant, sinon plus.
L’élection d’un président de gauche représente, c’est une évidence, un souffle d’air pour 1a société française. Le « rassemblement », « l’élan national » que François Mitterrand appelle de ses vœux ne peut que susciter dans les semaines et les mois à venir, initiatives et propositions. Les luttes féministes devraient retrouver la vigueur qu’elles ont perdue depuis deux ou trois ans, conscientes que l’accès de la gauche au pouvoir représente une chance historique pour les femmes. En 1936, le Front populaire réalisa une première en nommant trois femmes au gouvernement(1) . Quarante-cinq ans plus tard, le socialisme doit à nouveau réussir une première : ne pas manquer son rendez-vous avec les femmes. La renaissance du féminisme a marqué les années 70. L’idée de la libération des femmes, si elle n’est pas une idée neuve du XXe siècle, a fait son chemin dans toutes les couches de la société. L’élection d’un socialiste à la présidence de la République prouve d’ailleurs que le vote des femmes — celui des jeunes en particulier — a basculé à gauche. L’abolition du patriarcat ne leur sera pas servi sur un plateau. Aux femmes d’œuvrer. A la gauche de ne pas les décevoir.
(1) Irène Joliot-Curie, sous-secrétariat d’Etat à la Recherche scientifique, Suzanne Lacore, sous-secrétariat, d’Etat à la Santé publique, et Cécile Brunschvicg, sous-secrétaire d’Etat à l’Éducation nationale