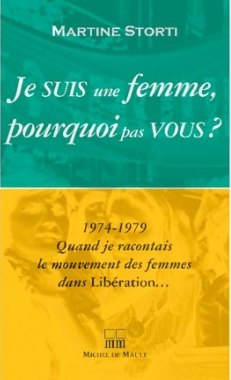Le masculin ne l’emportera pas (au paradis !) Article publié dans la revue La Faute à Rousseau, octobre 2013
En ce temps-là, on ne parlait pas de genre. Le mot était certes utilisé mais peu dans l’acception qui aujourd’hui agite tant certains esprits. On le trouvait, par exemple, dans la chute si terrible et drôle à la fois d’Un amour de Swann : « Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre ! » Ou encore dans cette expression « avoir mauvais genre », sans qu’il soit alors vraiment précisé ce que « mauvais » signifiait. Et encore évidemment dans la grammaire qui distinguait le genre masculin et le genre féminin et qui décidait : le masculin l’emporte. Ce qui continue, hélas !
Mais le genre comme gender, non, en en ce temps-là, soit à la fin des années 60 et dans les années 70, on n’en avait pas l’usage, nous en tenant, si j’ose dire, au sexe. Et de la différence des sexes, de la différence entre le féminin et le masculin ( et Godard de titrer ainsi l’un de ses films), de l’obligation de résider dans sa case, nul-le n’était ignorant-e. Oui l’un et l’autre, l’une et l’autre, savaient ce qu’il en était du féminin et du masculin, ce qu’il convenait d’être et surtout de faire selon l’appartenance de sexe.
Il en était ainsi dans tous les milieux et même dans les rangs de ceux qui s’autoproclamaient « révolutionnaires » et que bientôt le PCF (parti communiste français qui avait perdu de vue la révolution) allaient qualifier de « gauchistes », reprenant l’antienne léniniste (Le gauchisme, maladie infantile du communisme). Dans ces rangs où l’on affirmait vouloir changer le monde, en finir avec l’oppression et l’aliénation – et pour la plupart la volonté était réelle et l’aspiration à une autre organisation de la société sincère – eh bien, dans ces rangs-là, à la fin des années 60, pas de mise en cause ou bien peu de la traditionnelle répartition des tâches entre les sexes : aux garçons les responsabilités organisationnelles, la prise de parole, l’écriture des tracts, aux filles la frappe des dits tracts et le tirage à la ronéo. Pour s’en sortir, une seule solution : ne pas savoir taper à la machine et refuser obstinément d’apprendre ! Ce fut mon cas. Mais on n’en restait pas là. Aux filles dévouées à la révolution qui ne pouvait être que prolétarienne, revenait la tâche exaltante d’aller séduire les jeunes-ouvriers-des-banlieues pour les enrôler dans le parti à construire et/ou à développer. En général, ça se passait pendant le week end, avec des réunions qui se finissaient en bal, situation considérée comme plus appropriée que le seul meeting pour la conquête des jeunes masses populaires et masculines !
Est-ce mai 68 (on limite toujours à mai alors que l’affaire dura aussi tous les jours de juin et même dans certaines usines et facultés jusqu’en juillet) qui ébranla la différence construite, sociale, culturelle des sexes ? Disons que le chemin reprit alors mais s’élargit surtout dans les années suivantes, lorsqu’avec le MLF (mouvement de libération des femmes), les filles venues des rangs « gauchistes » et en rupture avec eux, décidèrent d’en « finir avec le patriarcat » non pas plus tard, lors des lendemains qui devaient chanter, mais ici, et là-bas et maintenant. Autant celles qui avaient accepter de taper les tracts que celles qui avaient refusé de le faire trouvaient en effet qu’il était « temps de prendre en mains leur libération ».
La décennie 70 pendant laquelle surgirent des mots alors nouveaux, par exemple « macho », « sexisme », « sororité », balaya-t-elle rapidement, je m’en tiens aux post-gauchistes, les représentations traditionnelles du féminin et du masculin et surtout les tâches et les rôles correspondants? Loin s’en faut. Comment ne me souviendrais-je pas de la répartition des tâches dans le quotidien symbolique de l’époque, Libération ? Salaire dérisoire et égal pour tous, certes, mais majorité de filles à ce qui s’appelait alors la « fabrication » (soit la frappe des articles, leur mise en page…) et minorité à la rédaction. De surcroît dans ce que l’on nommait non pas une direction ou une rédaction en chef – mots honnis- mais un « collectif d’animation » pas une seule fille, ce qui ne manqua pas de susciter l’étonnement de Sartre lui-même, déjà presque aveugle mais toujours vigilant, en visite au siège du journal, rue de Lorraine, à Paris.
Il fallut du temps et bien des luttes pour que « les assignations de genre », je reprends le langage d’aujourd’hui, soient remises en cause. Et encore très, trop partiellement. Mais l’enjeu n’était pas seulement d’abolir les stéréotypes masculins et féminins, les formes traditionnelles de la différence des sexes, ni même la hiérarchie et les inégalités induites par cette différence. Il s’agissait aussi d’affirmer une fierté, celle d’être une femme, comme en témoigne avec humour l’un des slogans d’alors « Je suis une femme, pourquoi pas vous ? »
Cette fierté prit, il faut le noter, de multiples formes, et suscita de multiples questions : l’égalité suppose-t-elle l’abolition de toutes différences (hors celles relevant de la biologie) ? Ou y a-t-il une autre différence à retrouver ou à faire advenir ? Un féminin à faire émerger, au risque d’un essentialisme des sexes dont précisément le féminisme avait voulu se débarrasser ? Ce débat d’il y a 40 ans court toujours…