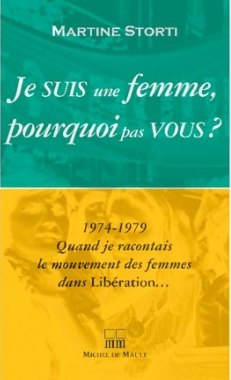Qu’est-ce que c’est ? De la nostalgie ? Un désir d’enfance ? Une envie de passé ? Ou celle de marquer la reconnaissance, la gratitude ? Gratitude comme rendre grâces et comme dire ce que l’on doit. A l’évidence tout cela à la fois.
Mais d’abord ce mélange de « je me souviens », de sensations, d’émotions qui reviennent, un demi-siècle plus tard, 52 ans très exactement. Reviennent-elles ou ne m’ont-elles jamais quittée, comme si quelque chose de ces années et particulièrement de cette année-là, l’année scolaire 1954-1955, l’année où j’ai eu madame Enaudeau comme maîtresse de CM1, m’avait accompagnée toute ma vie, m’accompagnait encore ?
Quoi exactement ? Le goût, appris sans doute déjà avant mais confirmé par elle, développé avec elle, du travail bien fait, bien fait c’est-à-dire fait avec soin, avec sérieux, avec conscience, avec curiosité aussi et plaisir, oui le travail fait avec plaisir, l’entrée dans la connaissance, dans l’aventure humaine comme un plaisir sérieux, comme une jouissance ordonnée, construite. Et adossée à l’exigence de madame Enaudeau, car elle l’était, exigeante, sur l’orthographe, sur la construction des phrases, sur la mémoire des poèmes, sur la précision des cartes de géographie, sur la beauté des bordures, sur la propreté des cahiers… Ces cahiers qu’elle a gardés, année après année, au long de son parcours d’institutrice et longtemps après, jusqu’à sa mort, ces cahiers d’élèves et ces cahiers thématiques ( l’aventure du Kon-Tiki, les joies humaines, le monde de la mer, l’Union française…) soigneusement protégés par des couvertures colorées et composés des meilleures dictées, ou des meilleures rédactions, ou des meilleurs dessins et qui étaient mis en valeur lors de l’exposition de fin d’année, cette exposition visitée par les parents et qui se déroulait en même temps que la fête de l’école organisée, elle, au cinéma « Le Colombes-Palace », alors situé rue Saint-Denis et hélas aujourd’hui remplacé par une grande surface commerciale.
Exigeante, oui, madame Enaudeau l’était. Une exigence bienfaisante, une exigence pour élever les fillettes qui étaient devant elle, avec elle, inscrivant ainsi son travail d’institutrice dans le sens premier du mot élève. Une exigence empreinte de respect, d’affection et oserai-je le dire, de tendresse. J’ai cette certitude là, en effet, que madame Enaudeau respectait et aimait tendrement ses élèves dans l’effort même qu’elle leur demandait, et dans ses efforts à elle, dans ces heures et ces journées données avec tant de générosité pour bâtir un enseignement et le renouveler chaque année.
A madame Enaudeau, je dois donc des souvenirs d’école qui sont des bouffées de bonheur. Ce qui n’est pas rien. Mais je lui dois davantage encore. Je lui dois d’avoir dit à ma mère quelques mots décisifs qui ont orienté ma vie.
« Il faut que Martine aille au lycée et fasse du latin ». Ces mots, en effet, ces mots dits à ma mère, sans doute à la sortie de l’école, sans doute un samedi, quand les parents venaient plus que les autres jours chercher leurs enfants et qu’ils avaient, un peu plus que les autres jours, le temps de parler avec les institutrices, après que les élèves aient franchi le porche sans avoir omis de marquer un temps d’arrêt devant la directrice, la si sévère et si dévouée madame Prêté, marquer un temps d’arrêt pour la saluer de la tête, cérémonie qui s’accomplissait immanquablement chaque semaine, ces mots donc, que je me plais à imaginer dits dans une conversation improvisée, sur le trottoir de la rue des Monts Clairs, un après-midi de printemps, ces mots dits par madame Enaudeau à ma mère « il faut que Martine aille au lycée et fasse du latin », que signifiaient-ils ?
Ils signifiaient que cette institutrice, non seulement se souciait de ce qu’on appelle aujourd’hui « les apprentissages fondamentaux » et « la transmission des savoirs » mais aussi d’accompagner ces fillettes, et de leur donner, à elles et à leurs parents qui peut être ne les possédaient pas, certaines des clefs du fonctionnement social. En ce temps-là, où des termes aujourd’hui si utilisés, tels que discrimination ou ségrégation, n’étaient pas à la mode, ce qu’ils désignent était bien en acte, l’école communale comme école commune mais après, plusieurs filières, quasi complètement fermées les unes aux autres, cours complémentaire, école commerciale, enseignement professionnel, apprentissage… Et ces différenciations décidées très vite, très tôt, et seule une petite partie de ce qui ne se nommait pas encore « classe d’âge » s’engageait dans la voie royale, c’est-à-dire le lycée.
Ce lycée qui commençait en sixième, cette sixième dans laquelle on n’entrait qu’en réussissant un concours, ce concours auquel il fallait oser s’inscrire, et pour avoir cette audace-là, il ne fallait pas seulement penser qu’on était intellectuellement capable de réussir, il fallait aussi juger qu’on y avait socialement, en quelque sorte, le droit. C’est cette audace-là, ce droit-là, cette légitimité-là que madame Enaudeau transmettait, signifiant ainsi que le lycée n’était pas, ne devait pas être seulement réservé à ceux qui depuis toujours, depuis leur naissance, de par leur appartenance sociale, lui étaient destinés.
Moi qui était fille d’ouvrier émigré, serais-je allée au lycée sans madame Enaudeau ? Je n’en suis pas certaine. Quoi qu’il en soit, je lui dois d’y être allée, concours d’entrée réussi, en étant intimement persuadée que j’y avais ma place, que j’y étais légitime, avec la certitude républicaine que l’origine sociale ne doit pas décider du destin scolaire. Bien des années plus tard, c’est cette certitude qui me guide dans mon actuelle fonction.
Voila, de manière bien trop sommaire, quelques lignes de témoignage en prélude à l’hommage qui sera, dans quelques semaines, rendu à madame Enaudeau. Hommage rendu à une personne singulière qui a marqué tant d’élèves de cette école Lazare Carnot créée l’année du premier centenaire de la Révolution française. Mais au delà, ou à travers madame Enaudeau, c’est un cortège d’institutrices et d’instituteurs que l’on doit aussi saluer, ces femmes et ces hommes qui, quand ils en ont la conscience et le désir, peuvent faire d’une salle de classe, pour chaque petite fille et chaque petit garçon transformé en élève, un lieu d’émerveillement.