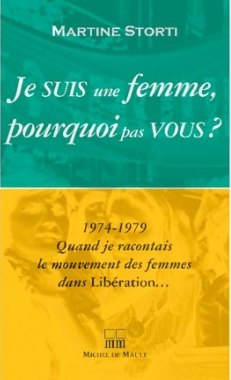Qu’as-tu à raconter ? Quelques jours en mai et juin 68 ? C’est-à-dire ? As-tu à raconter des manifs, des barricades, des charges de police, des jeunes gens qui brandissent des drapeaux rouges ou qui s’époumonent dans des meetings, des rassemblements, cocktails Molotov et bombes lacrymogènes, matraques et pavés, voitures brûlées, ce qu’on montre habituellement de Mai, images vues et revues, diffusées et rediffusées, toujours les mêmes ?
Tu ne sais pas ce que fut Mai, certains paraissent le savoir, ils ont les mots, ils ont la capacité de nommer, ils disent : « une fête », « un grand monôme », « une crise adolescente », « une farce de fils à papa ». Ils disent aussi : « la porte d’entrée de l’individualisme, ou du libéralisme, ou du développement de la société de consommation ou de l’américanisation de la France. Ils disent encore : « Mai 68 c’est la ruse de l’histoire pour moderniser la France contre une bourgeoisie archaïque », on a lu son Marx « les hommes font leur propre histoire sans savoir quelle histoire ils font… »
Est-ce qu’ils ont raison ? Est-ce que Mai fut objectivement cela ?
Certains savent ce que fut Mai, toi non, mais tu sais ce qu’il fut pour toi, et s’il y a quelque chose à restituer, c’est moins ce qui fut pensé que ce qui fut vécu, éprouvé, ressenti, retrouver moins des idées, des pensées, que des sentiments, des émotions, des manières d’être, essayer de revenir à cet emballement des corps, des cœurs et des âmes.
Retrouver quelques jours de Mai, tenter de revenir à cette suspension de la vie quotidienne, pas pendant une journée ou deux, Mai ce n’est pas deux ou trois jours de grève, ni même une semaine, ce qu’on appelle Mai 68 court sur plusieurs semaines, déborde largement sur juin, plusieurs semaines d’ordinaire suspendu, où les modalités de la vie habituelle sont brisées, effacées, où l’on se sait même plus comment c’est l’ordinaire, une mise entre parenthèse de la vie ordinaire pour le pays tout entier.
Mai sans doute irracontable, en raconter cependant des bribes en assumant le risque de la naïveté, prendre ce risque-là et le préférer à une attitude plus fréquente, qui manie l’ironie, le sarcasme, la causticité, la condescendance, qui dit : Mai bêtises de jeunesse, tissu de vieilleries, poubelles de l’histoire. Ou bien qui dit : Mai responsable de tout, pas la faute à Voltaire ou à Rousseau, non, la faute à Mai, les valeurs qui foutent le camp, l’autorité qui n’existe plus, les élèves qui n’apprennent plus rien, l’absence de civisme, les repères qui ont disparu, sempiternellement la faute à Mai, sûrement pas la faute au chômage, au libéralisme débridé, aux politiciens la main dans la caisse, aux pots de vin, aux jeux télévisés où l’on gagne l’équivalent d’une année de travail en répondant à des questions ineptes, aux ménages grassement payés des stars du cinéma ou des medias, à l’étalage du fric…
Assumer le risque de la naïveté, et celui de la nostalgie et le revendiquer, bien que la nostalgie ne soit pas à la mode, pas bien vue, ringarde, surtout s’il s’agit de la nostalgie de Mai 68, pas une nostalgie intellectuelle ou politique de Mai, une nostalgie de ce qui fut ressenti, Mai comme une histoire d’amour, Mai semblable aux commencements de l’amour, quand on le suppose, le devine aussi chez l’autre, quand le monde s’embellit, quand le quotidien est suspendu, quand du matin au soir on est excité, haletant, puissant, d’une puissance inouïe, pareil Mai et être amoureux, embellissement du monde et embellissement de l’être aimé, journées enchantées par Mai et par l’amour, le sentiment amoureux, enchantement qui ne s’assimile pas à la fête, à la rigolade permanente, non l’enchantement c’est sérieux, plus que sérieux, grave. Mai grave comme l’amour.
Mardi 14 mai,
il est dix heures du soir, peut être onze, ce qui est certain c’est qu’il fait nuit et que l’air est doux, on est à Paris, place Saint-Germain-des-Prés, pas devant l’église, juste en face, du côté des Deux magots, exactement devant ce qui était à l’époque le « 44 rue de Rennes » et qui est aujourd’hui le « 4 place Saint-Germain-des-Prés », mais le 14 mai 1968, l’appellation exacte était le « 44 rue de Rennes.
Pourquoi les étudiants de philo se sont-ils réunis au 44 rue de Rennes et pas dans un amphithéâtre de la Sorbonne occupée depuis la veille, tu ne saurais le dire, mais c’est un fait, la première assemblée générale de philo s’est tenue dans la salle du rez-de-chaussée de l’hôtel de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, ce qui ne manque pas de piquant si l’on veut bien prendre en compte que les jours à venir n’allaient pas être très encourageants pour la dite industrie !
Tu as mille choses en tête, mille choses auxquelles tu dois penser, dont tu dois t’occuper ou qui t’occupent, tu es incroyablement excitée, à l’instar des filles et des garçons qui stationnent sur la place Saint-Germain-des-Prés, forcément avec tout ce qui vient de se passer, tout ce qui est en train de se passer, quelques jours et la France n’est plus la même, quelques jours, onze exactement, entre le 3 et le 14 mai.
Chacun le sait Mai 68 a commencé le 3 mai, je dis chacun le sait, mais j’exagère, qui s’en souvient, les septuagénaires peut-être. Dans les manuels scolaires, on ne trouve pas grand-chose sur Mai 68, des manifs, des barricades, les grands moments, nuit du 10 au 11, la grande manifestation du 13, le sommet de Grenelle, la manif du 30, et après le 30 mai, plus rien, tout s’arrête à ce moment-là, Mai 68 c’est le mois de mai, rien en juin, alors que le mouvement, la grève ont continué, pas seulement au Quartier latin, dans les usines aussi. Et même pour les plus âgés, le 3 mai, qu’est-ce que ça leur évoque exactement ?
C’était un vendredi, un meeting de l’UNEF dans la cour de la Sorbonne pour protester contre la fermeture de la faculté de Nanterre la veille et la convocation devant un conseil de discipline de six étudiants, un recteur qui appelle la police, les flics qui entrent dans la vieille faculté et embarquent les militants de différents groupes ou organisations, mouvement du 22 mars, UNEF, Fédération des étudiants révolutionnaires, Jeunesse communiste révolutionnaire, Mouvement d’action universitaire, 527 militants arrêtés, incroyable, quand on y pense, 527 interpellations pour un seul meeting, le Quartier latin qui se révolte, des manifs qui se prolongent jusqu’au milieu de la nuit, des affrontements avec la police, la Sorbonne qui est fermée, et dans la semaine qui a suivi, protestation contre la condamnation de sept étudiants à des peines de prison, les meneurs, c’était le terme utilisé, en l’occurrence Daniel Cohn Bendit, étudiant à Nanterre et Jacques Sauvageot, le vice-président de l’UNEF, manifestations « libérez nos camarades », barricades, « la Sorbonne aux étudiants », ratonnades, « ce n’est qu’un début, continuons le combat », arrestations, « une dizaine d’enragés », blessés, « nous sommes un groupuscule ».
Manifestations chaque jour ou presque, affrontements avec les flics, pas vu de telles manifs depuis longtemps, le pays pas indifférent, syndicats, partis de gauche, chacun y est allé de ses commentaires, analyses, explications, jugements, Nanterre et Sorbonne toujours fermées, groupes gauchistes sur la place publique, manifestations quotidiennes jusqu’à la nuit dite des barricades, nuit du 10 au 11 mai, qui sans doute reste dans les mémoires, surtout parce qu’images vues et revues, flics casqués, imperméables noirs, grenades lacrymogènes, barricades de troncs d’arbres, voitures, pavés, grilles de fonte des marronniers, couvercles de poubelle, panneaux de signalisation, baraques de cantonniers, planches de maçons, Parisiens qui suivent la bataille sur leurs transistors, rue Gay-Lussac au matin du 11 mai, chaussée dépavée, carcasses de bagnoles, « halte à la répression », appel à la grève générale pour le lundi 13 mai.
Ce magnifique lundi 13 mai,
immense défilé qui a duré l’après-midi entier, de la gare de l’Est à la place Denfert-Rochereau. Combien étaient-ils ? Deux cent mille, comme le dit le ministère de l’intérieur ? Un million, comme l’affirment les organisateurs ?
Toi des heures assise devant la gare de l’Est, à attendre l’ébranlement du cortège, attente sous le soleil, attente interminable, un monde fou, les gens partout, places, rues, trottoirs, carrefours, des cortèges venus de Paris, des banlieues, femmes, hommes, jeunes, vieux, ouvriers, étudiants, lycéens, une foule immense, interminable attente à cause de cette foule immense mais pas seulement, attente aussi parce que le cortège étudiants-lycéens-enseignants, rassemblé gare de l’Est, peine à se fondre avec celui des syndicats, organisé à partir de la place de la République, les représentants des centrales ouvrières acceptant difficilement que les leaders étudiants soient avec eux en tête du cortège.
Des heures donc à attendre, tantôt debout, tantôt assis par terre, qu’un mouvement enfin s’esquisse, et puis comme les centaines de milliers d’autres, tu as marché longtemps, lentement, « Etudiants, enseignants, travailleurs solidaires », « De Gaulle démission ! », « Ce n’est qu’un début, continuons le combat », tu as chanté L’Internationale, tu as crié et marché jusqu’au soir, jusqu’au couronnement de cette journée triomphale, l’entrée dans la Sorbonne, ouverte et immédiatement occupée, ce drapeau rouge hissé sur le dôme de la chapelle, cette fête improvisée, cette foule d’étudiants, de jeunes ouvriers heureux d’être là, ces amphis bondés, cette irruption de paroles surgies dans la nuit.
Un miracle, en dix jours, la France n’est plus la même. Et pourquoi exactement ? Qui le sait ? Ils disent « révolte juvénile », ou « crise de l’autorité », ou « meurtre du père », « inquiétude des étudiants pour leur avenir professionnel », « archaïsme de l’enseignement supérieur », ils répètent leurs tentatives d’explication, des mots vides pour toi, des inepties.
Trois ans que tu es étudiante à la Sorbonne et trois ans que tu te définis comme une « militante révolutionnaire », c’est-à-dire à la gauche de la gauche, à l’extrême gauche, « gauchiste » quoi, comme vous qualifient les communistes qui désignent ainsi tous les groupes, les trotskistes de multiples obédiences, les maoïstes, les anarchistes, tous les groupes, les groupuscules, encore un de leurs mots, qui, tout en se réclamant du marxisme, dénoncent le stalinisme, ne prennent pas l’Union soviétique pour la patrie du socialisme et jugent le parti communiste français complice de la bourgeoisie.
Tu assumes le qualificatif de gauchiste mais tu n’appartiens à aucun de ces groupes, ou plutôt tu n’y appartiens plus, tu les as expérimentés mais tu en es revenue, tu les as trouvés brutaux, sectaires, dogmatiques, radoteurs, rabâchant les mêmes analyses incapables de rendre compte du monde tel qu’il est.
Les trotskistes bassinaient avec Le programme de transition écrit avant la seconde guerre mondiale par le « prophète armé » puis « désarmé », « les forces productives ont cessé de croître », ils répétaient cette phrase, presque une vérité révélée, c’était la bible, rien de nouveau en trente ans !
Les maos, eux, voyaient dans la Chine un paradis terrestre, on n’allait tout de même refaire le coup de l’URSS, mais si, ils le refaisaient, tu ne pouvais pas croire ça, que la Chine devait être un modèle pour la France de la fin des années 60, tu ignorais ce qu’on a appris ensuite de la grande révolution culturelle, les millions de morts et le reste, les déportations, la rééducation, tu l’ignorais mais tu ne pouvais pas croire la vision idyllique donnée par les penseurs de la rue d’Ulm. Tu n’es donc d’aucun de ces groupes mais tu as fait ton miel de chacun, butinant ici ou là ce qui te convenait, te situant résolument dans un refus de la société capitaliste, pourvoyeuse à ton avis d’exploitation, d’aliénation, d’inégalités, d’injustices.
Alors ce qui se passe depuis le 3 mai, quelle excitation ! C’est comme la réalisation d’un rêve, comme si arrivait ce que tu as espéré pendant ces trois années où, étudiante en philosophie, tu as passé tout ton temps ou presque à distribuer des tracts, à prendre la parole dans les amphis, pour convaincre les étudiants de la nécessité de lutter contre l’université bourgeoise et contre l’ordre capitaliste.
Mais la fête qui depuis la veille anime la Sorbonne ne peut pas te suffire, tu n’es pas dans la fête, pas dans le « jouir sans entraves », « l’interdit d’interdire », tous slogans répétés jusqu’à la nausée comme incarnant Mai 68, non, toi tu es dans l’espérance révolutionnaire, il te faut plus que la fête, il te faut davantage, il te faut la révolution.
Que mets-tu alors dans le mot de révolution ? Tu y mets « le renversement du gouvernement », « la classe ouvrière au pouvoir », « la suppression du capitalisme », « la construction d’une société nouvelle », mais ces formules ne traduisent pas, ne peuvent pas rendre compte des aspirations qui étaient alors les tiennes et qui étaient contenues dans le mot révolution : en finir avec la saloperie, avec l’inhumanité du monde que tu attribues seulement, dans la naïveté et l’ignorance de tes vingt ans, à un ordre économique et social injuste.
Oui, tu croyais ça, que la révolution permettrait d’en finir avec la saloperie du monde, c’était ta naïveté, ton innocence, ta bêtise.
Plus tard, au fil des années, de l’expérience, de la vie, tu as compris qu’il y avait une saloperie sociale liée à toute société, et peut-être même pas seulement à la société, à l’homme, des forces du mal inhérentes à l’être humain, l’admettre t’a pris du temps, tu as résisté des années avant de te résoudre à penser ce qui te semblait trop moralisateur, ou pouvait servir d’alibi à la résignation, mais en 68, à vingt ans, tu as des idées simples, et même simplistes, sans doute parce que seules les idées simples permettent d’agir, dès qu’on complique trop les choses, on est foutu, plus difficile de courir.
D’ailleurs revenir à Mai, n’est-ce pas revenir à un moment de simplicité et à un moment d’innocence, à un moment d’avant les compromis et les compromissions et les arrangements, avant les déceptions, un moment d’innocence sociale, où l’on croyait que les stratégies individuelles n’existaient pas ? Pas un seul instant tu n’es traversée par l’idée que certains pouvaient être là par stratégie ou intérêt personnels, on pouvait être en désaccord sur la manière de combattre la bourgeoisie, le capitalisme, mais aucun doute sur le fait qu’on ne s’y rallierait pas, qu’on ne jouerait pas le jeu, qu’on ne ferait pas fonctionner le système…Quant à la trahison, des idées et des êtres, elle n’existait pas et les salauds n’étaient pas de ton bord, ne pouvaient pas l’être, c’était ça évidemment la connerie, évidemment qu’ils pouvaient l’être. Plus tard tu as compris que oui, ils pouvaient l’être, carriéristes, vendus, collabos, petits surtout, minables, aussi minables que n’importe qui, et cette question que tu répétais si souvent : « comment avais-je pu croire appartenir à une génération différente, à une génération qui ne cèderait pas ? »
Donc ce mardi 14 mai,
tu te moques pas mal du débat qui s’est ouvert dans l’après-midi à l’Assemblée nationale. Compter sur les partis politiques de la gauche officielle ? Sûrement pas. Mais tu t’es particulièrement réjouie d’apprendre, dans le courant de la journée, que les ouvriers de Sud-Aviation, à Nantes, s’étaient mis en grève et occupaient leur usine. Et si d’autres allaient faire la même chose ? Si d’autres, au lendemain de la grève générale que les syndicats prévoyaient, voulaient sans lendemain, allaient faire comme les ouvriers de Sud Aviation, se remettre en grève et occuper leur usine ?
Au cours de l’assemblée des étudiants de philo qui vient de s’achever, les débats n’ont pas porté sur cette grève mais sur les examens. Les cours n’ayant plus lieu, le fonctionnement normal de l’université étant paralysé par l’occupation des facultés, les examens seront-ils organisés en juin ? En septembre ? Sous leur forme habituelle ? Autrement ?
Ces interrogations et ces inquiétudes, surtout exprimées par les étudiants les moins politisés, toi et tes compères vous vous êtes empressés de les balayer, en faisant voter le boycott des examens, leur report à l’automne et la création d’une commission qui, dès le lendemain, pourrait commencer à élaborer les modalités des épreuves futures… Jugée purement technique et subsidiaire, cette question fut rapidement évacuée au profit d’autres enjeux estimés autrement plus importants, lutter contre une université qui était au service de la bourgeoisie, qui excluait quasiment les enfants d’ouvriers, inscrire cette lutte dans un combat anticapitaliste, combattre la société dans son ensemble, affirmer son refus de la faire fonctionner.
Mercredi 15 mai,
savoir si d’autres ouvriers vont, comme ceux de Sud Aviation la veille, se mettre en grève, occuper leurs usines, voilà ce qui t’obsède, tu ne peux pas te contenter de la fête, ce qui t’intéresse, te mobilise, c’est la grève. Tu files à la Sorbonne, où pourrais-tu aller sinon là, dans cette vieille Sorbonne que tu aimes tant, où tu te sens chez toi, les couloirs tortueux, les amphithéâtres majestueux, les escaliers mystérieux sont devenus au fil des années tes territoires, arpentés chaque jour, moins pour aller aux cours que pour distribuer des tracts, participer à des réunions, des débats, des rencontres ?
Ce 15 mai, la vieille faculté des lettres, rebaptisée « Université autonome populaire », a changé d’allure, drapeaux rouges et noirs qui flottent un peu partout, portraits des grands ancêtres, Marx, Lénine, Trotsky, Mao, Castro, d’autres encore, qui se dressent de tous côtés, graffitis insolents qui recouvrent les murs, multiples stands installés dans la cour, salles transformées en cuisine, en infirmerie, en permanence du service d’ordre…Et toi, tu es partagée entre le plaisir de discuter avec les uns et les autres, à aller de débats en débats, d’amphis en amphis, plaisir que tu ne nies pas, partagée entre ce plaisir et une certaine réserve, voire de l’inquiétude, te demandant si cette prise de parole tumultueuse, cette révolte affichée dérangent vraiment le système en place, si « l’imagination au pouvoir », proclamée par l’un des slogans du jour, est autre chose qu’un pouvoir imaginaire.
Ces questions en tête quand tu montes vers la salle Cavaillès, au premier étage de l’escalier C, où doit se tenir la commission « examens ». A ce moment-là, quand tu montes cet escalier, pas un seul instant tu ne songes à Jean Cavaillès. Pourquoi y penserais-tu ? La seconde guerre mondiale t’est si lointaine, tu es née après, juste après, et la guerre n’est pas dans ta vie, vingt-trois années te séparent d’un autre mois de mai, du mai de 1945.
La guerre t’es lointaine et de Cavaillès, tu ne sais presque rien, juste qu’il a été professeur à la Sorbonne et tu crois que c’est pour cette raison qu’une salle porte son nom. Tu ne sais même pas qu’il a été un grand résistant et qu’il en est mort.
Il a fallu, en 1982, le beau récit de Gabrielle Ferrières, la sœur de Cavaillès, Un philosophe dans la guerre, pour que tu prennes la mesure de la dimension du personnage, prisonnier en 1940, puis évadé, résistant dès 41 dans le mouvement Libération, double vie d’abord, philosophe, mathématicien, logicien le matin quand il prépare ses cours et rédige son Traité de logique, résistant le reste de la journée, puis l’arrestation, l’internement près de Limoges, une nouvelle évasion, la révocation de ses fonctions de professeur par Vichy en 42, un court séjour à Londres, début 43 (« mais ce contact avec la France libre le déçut, la légèreté des bavardages, cette « mentalité d’émigrés », « l’esprit de chapelle » de tout ce clan gaulliste et surtout les calculs, les ambitions – la basse politique qui aboutit au comité d’Alger – scandalisèrent le soldat qu’il était resté », c’est ce qu’écrit la sœur de Cavaillès, notons bien les mots – « calculs », « ambitions » – donc même chez les gaullistes de la première heure, même à Londres !) Cavaillès préfère rentrer en France, et se « consacrer tout entier à l’action militaire », toujours les mots de sa sœur, jusqu’à l’arrestation en août 43, la torture, le camp de Compiègne, et la mort en janvier 44, Cavaillès fusillé à Arras avec onze autres résistants, après une condamnation par le tribunal militaire.
Tu es tombée par hasard sur ce livre en 1982, à cette date ton admiration pour les Résistants était bien plus intense qu’en Mai 68, admiration qui n’a fait qu’augmenter au fil des années, pas seulement parce qu’ils avaient choisi le « bon camp ». Ton expérience de la vie, de la société a accru année après année cette admiration, t’a fait prendre la mesure de leur courage physique mais aussi, mais surtout intellectuel, moral. Qu’était résister, en effet, si ce n’est d’abord rompre, rompre avec les pouvoirs en place, avec l’attitude la plus fréquente des élites, (pas forcément collabos les élites, pas forcément copain-copain avec les Allemands, pas forcément auteurs de lettres anonymes, pas forcément donneurs de Juifs à la police française ou à la Gestapo, non, la plupart rien, la vie qui continue et la démerde individuelle pour s’en sortir), rompre avec ce qu’on appelle aujourd’hui le consensus, l’air du temps, le politiquement correct, le confort, la facilité, le goût de la reconnaissance, ruptures déjà assez rares quand on ne risque rien, alors quand le risque est l’arrestation, la prison, la torture, la déportation, la mort ?
Cependant, ce 15 mai 68, tu ne penses pas du tout à Cavaillès quand tu entres dans la salle qui porte son nom, au premier étage de l’escalier C, cette salle que tu es ravie de voir archipleine, tu es vite emportée par la réunion, tu écoutes ce qui se dit, tu prends toi aussi la parole, car rien, en ces heures, ne pourrait t’empêcher de parler, tu as tant à dire et sur tant de sujets, tu es, à ce moment, comme les autres, dans la délectation de cet échange incessant de mots, de phrases, d’idées : examens… sélection sociale…regarder les chiffres… combien d’enfants d’ouvriers dans les facultés… pourquoi pas plus nombreux… plus bêtes que les gosses de bourgeois ou pas moyens financiers de faire des études… ou pas héritiers… pas cette complicité, dès l’enfance, avec la culture et le langage dominants pour réussir au lycée, puis à l’université…
Tu es dans les mots, mais pas seulement, pas seulement dans la fête non plus, tu n’es pas dans l’image qu’on se plaît à donner de Mai, image répétée, ressassée, le grand monôme, les jeunes contre les vieux, le neuf contre l’ancien, entreprise délibérée de réduire Mai à ces clichés pour barrer, masquer, oblitérer le reste, le reste c’est-à-dire ce qu’on n’a pas réussi mais qu’on a tenté, peut-être pas ce qu’on a fait mais ce qu’on a vécu, ce que tu as vécu, et s’il faut des oppositions, plutôt exploiteurs/exploités, l’espérance de la grève générale, de la prise du pouvoir et pas seulement de parole, de la destruction du système en place, la tentative de passer de la révolte à la révolution.
En Mai, tu attends, souhaites, veux la révolution, à ce moment tu n’as qu’une vision positive de la révolution, une vision romantique, tu n’ignores pas le stalinisme, les camps, le goulag, les déportations, les massacres, la bureaucratie, la dictature, mais tu as la certitude de ne pas reproduire les mêmes erreurs, ta révolution sera la libération du peuple par lui-même, elle sera démocratique, la révolution t’est un mot magique, et des images de la révolution, tu en as plein la tête.
Ils disent : « Mai dans la jouissance de l’instant », mais non, plus sûrement Mai enfoncé dans l’Histoire, ancré dans le passé, dans une mythologie révolutionnaire, française et étrangère, et des représentations, des images façonnées par les manuels scolaires, les romans, les films, qui mêlent tout, les pays et les années, 1789, 1830, 1870, 1905, 1917, foule qui saccage Versailles, barricades des Misérables, combats sanglants de la Commune, prise du Palais d’hiver à Saint-Pétersbourg, harangues de Lénine à Moscou, train blindé de Trotsky fonçant à travers des plaines enneigées, longue marche de Mao Tsé Toung…
Et tu te demandes si tu vas vivre des événements aussi grandioses, si tu sauras y tenir ta place, si tu seras à la hauteur de la situation et capable de pensées, de gestes, de conduites héroïques. Car à ce moment-là de ta vie, tu as une vision épique de l’Histoire, et tu as besoin de grandeur, et de dépassement…
Passer de la révolte à la révolution… Mais comment s’y prendre ? Tu ne le sais pas vraiment, tu n’as qu’une seule certitude, il faut que la classe ouvrière s’en mêle. Tu n’es pas dans le parti avant-garde des masses, « l’orga », comme disent les trotskistes, tu n’es pas dans l’idolâtrie des masses populaires, comme les maos, mais comme eux, tu crois au rôle historique de la classe ouvrière, tu as lu Marx, Lénine, Trotsky et les autres, donc pour toi, la classe révolutionnaire, c’est la classe ouvrière, elle seule peut renverser le système capitaliste, abolir l’ordre bourgeois.
Jeudi 16 mai,
la brèche paraît s’élargir, car après Sud-Aviation en grève depuis l’avant-veille, d’autres débrayages se sont produits, aux chantiers navals de Bordeaux, à l’usine Renault de Cléon, à l’usine Loockeed de Beauvais, à l’entreprise UNELEC d’Orléans, les ouvriers, à l’évidence, sont en train de prendre la relève des étudiants qui sont incapables, seuls, de faire la révolution.
Au matin de ce jour, des usines en grève un peu partout dans le pays, et dans l’après-midi, l’information merveilleuse, la forteresse de Renault-Billancourt entrée à son tour dans la grève, cette annonce alors que se termine l’assemblée générale de philosophie.
Deuxième AG de philo, mais AG fondatrice, celle de l’énoncé des principes, celle qui servira de modèle à toutes les autres, infime épisode de Mai, emblématique cependant de ce qu’il fut dans les facs, l’AG comme lieu de pouvoir, en tout cas de pouvoir apparent d’un peuple souverain, en l’occurrence les étudiants de philosophie, des étudiants résolument rousseauistes, tenant d’une démocratie directe, où rien ne se délègue à personne, où l’on débat sans cesse, où il n’y a que des individus.
Tu es à Censier, tu pestes une fois de plus contre la laideur de l’annexe de la Sorbonne, un bâtiment récent et affreux qu’on appelle Censier parce qu’il longe la rue du même nom et même quand il est, comme ce 16 mai, occupé, couvert de banderoles, d’affiches, de graffitis, noyé dans les stands et les réunions, tu le trouves moche.
Sauf qu’aujourd’hui, tu t’en moques, tu es excitée, impatiente que l’AG commence, d’y prendre la parole pour inciter les étudiants à refuser la voie réformiste que déjà certains leur proposent, ceux qui veulent saisir l’occasion pour en finir avec la vieille université afin d’en bâtir une nouvelle, plus moderne, plus efficace. Mais toi, de la modernisation de l’université française, tu te soucies comme d’une guigne et tu la considères comme une manière de mieux adapter l’enseignement supérieur aux besoins du capitalisme. Tu veux aussi mettre en garde tes camarades contre une autre menace, le délire verbal, la fête sans lendemain, déjà tu te méfies de Mai, ou plutôt des dérives que tu entrevois et qui te font peur.
Des étudiants à cette AG, aussi une douzaine d’assistants qui entourent Vladimir Jankélévitch, le seul professeur titulaire de chaire présent, tandis que les autres, par hostilité au mouvement, ou parce qu’ils estiment ne pas devoir se mêler aux assemblées étudiantes, ne sont pas là. Janké, tu l’aimes bien, tu apprécies davantage l’homme que la pensée, mais tu ne sais pas grand-chose de la philosophie de Jankélévitch. Tu n’as pas lu ses livres, tu n’as assisté que deux ou trois fois à ses cours, mais le regret, le remords, la durée, Bergson, le je ne sais quoi et le presque rien, tu estimes que cela ne te concerne pas, que c’est trop loin de toi, du moins le crois-tu, trop loin de la classe ouvrière, de la révolution, et tu te trompes évidemment, ces textes sont bien plus proches de toi que tu ne le penses, bien plus proches de l’existence, de ce qu’est exister, être au monde, donc ce 16 mai, tu n’as pas beaucoup lu Janké, mais tu le trouves sympathique, drôle, attachant, encore plus depuis qu’il manifeste sa solidarité avec les étudiants, présent dans les manifs, présent aux AG, tu as envie d’aller le saluer mais tu n’en as pas le temps, François t’a rejointe à grandes enjambées : « les types de la FER se sont installés à la tribune, il faut les déloger, viens avec nous au premier rang », tu le suis, tu descends l’amphi, les militants de la Fédération des étudiants révolutionnaires ont commencé à parler et il n’est pas question de les laisser présider l’assemblée générale, sous prétexte qu’ils dirigent le groupe UNEF de philosophie, pas question de laisser ni eux ni qui que ce soit s’emparer de l’AG, pas question qu’elle soit soumise aux groupuscules, aux organisations à ligne juste, à analyse globale, à détentrices de la vérité, à je sais tout à la place des autres, à répéter ce que je dis, à ceux qui ne pensent pas comme moi sont des ennemis, ces organisations qui passeront à côté de Mai, la FER est la pire de toutes, mais elles ont toutes les mêmes caractéristiques.
Toi tu attribues un rôle prépondérant à la classe ouvrière, mais tu n’es pas dans la mythologie du parti, tu n’es pas dans la théorie léniniste, tu ne pourrais pas alors expliquer pourquoi, plus une intuition qu’une analyse, d’ailleurs tu passeras Mai en n’étant d’accord avec personne, pas d’accord avec les tenants du parti avant garde des masses, pas d’accord avec l’adulation de la classe ouvrière, pas d’accord avec les jouisseurs sans entraves, d’accord avec personne donc et pourtant dans Mai comme un poisson dans l’eau, à l’aise dans cette orgie de mots, de paroles, de discussions à l’infini, à deux, à dix, à cent, à mille, du matin au soir, du soir au matin, tu es complètement dans ce flot de paroles et en même temps tu éprouves de la méfiance.
Tu seras l’un des piliers de ces AG, l’une des rares filles à y prendre la parole. Tu as de l’énergie, de la vivacité, de l’aplomb, dans ces AG qui se tiendront trois fois par semaine comme va le décider celle qui vient de vider de la tribune les représentants de la Fédération des étudiants révolutionnaires, ce qui prit un certain temps. Il y a d’abord les apostrophes hostiles : « On ne veut pas de vous à cette tribune ! », « Ni de représentants d’aucun autre groupe ! », « Tirez-vous ! », apostrophes qui ne t’étonnent pas, tellement la FER, branche étudiante des trotskystes « lambertistes », regroupés au sein de l’Organisation communiste internationaliste et éternels rivaux des trotskystes « frankistes » qui animent la Jeunesse communiste révolutionnaire, est sectaire, dogmatique et détestée par tout le monde ou presque. Pas plus que ne t’étonnent les réponses des types de la FER, qui, comme d’habitude n’ont aucune finesse tactique et s’arc-boutent à leur légitimité syndicale, comme si elle avait encore un quelconque sens dans un moment où chacun s’empare de la parole.
« Dehors, dehors! » hurle l’AG, rigolarde et résolue à la fois, et toi aussi tu rigoles, et bien que l’exercice te donne beaucoup de plaisir car tu as du goût pour ces joutes oratoires, ces manœuvres et contre-manœuvres, tu proposes, pour interrompre ce petit jeu qui pourrait durer des heures, que l’AG affirme ses principes politiques constitutifs et en tire, pour son fonctionnement, les conséquences. Les mots s’enchaînent, « assemblée générale souveraine »… « aucun individu, aucun groupe, ne peut prétendre parler en son nom, la représenter ou la présider »… « élisons un comité de grève, ne sera qu’un organisme technique, devra démissionner à chaque nouvelle AG » » … ne pourra prendre aucune décision sans notre aval »… « candidatures strictement individuelles, pas de candidatures d’organisation ou de groupes politiques »…
L’AG applaudit, les militants de la FER qui, dans un tel système, n’ont aucune chance d’être élus, hurlent que « c’est antidémocratique » non, répondent les autres, « c’est la véritable démocratie, la démocratie directe, on garde le pouvoir, on contrôle nos représentants, on empêche la bureaucratie ». Tu jubiles, tu penses qu’on va passer à l’élection des membres du comité de grève, mais une autre question surgit, soulevée cette fois par les enseignants. Vont-ils participer à l’élection des membres du comité de grève ? Peuvent-ils eux-mêmes être élus à ce comité ? Mais alors par qui ? Par toute l’AG ? Par les seuls enseignants ?
« Les étudiants et les enseignants ne peuvent être confondus, affirme une assistante, vous ne reconnaissez que des individus et vous les voulez sans détermination sociale, vous oubliez qu’à la différence des étudiants, les enseignants sont des fonctionnaires, c’est-à-dire des salariés de l’Etat, nous ne pouvons pas élire des étudiants et nous ne pouvons pas être élus par eux. Il faut faire deux collèges électoraux, l’un pour les étudiants, l’autre pour les enseignants ». Cette intervention, approuvée par presque tous les assistants, suscite un véritable tollé de la part des étudiants et des répliques virulentes : « Vous n’êtes pas là en tant qu’enseignants, mais en tant que personnes ! », « ce qui compte, ce sont les positions politiques des uns et des autres, pas leur statut social ou professionnel », « si vous ne vous sentez pas membres de cette AG comme n’importe quel étudiant, quittez-la, et rejoignez les rangs des mandarins ! »
Tu dénonces cette idée de deux collèges électoraux distincts et la solidarité corporatiste qu’elle induit, comme si les enseignants, parce qu’enseignants, ne pouvaient qu’avoir une position politique unique, ne pouvaient être, à l’instar des étudiants, en proie à des désaccords. Et comme tu es applaudie, tu te crois démocrate et généreuse, alors que tu n’es que démagogue, en soumettant au vote la suggestion du double collège qui est, à mains levées, massivement refusée.
Va-t-on enfin passer à l’élection du comité de grève ? Pas encore ! Car il faut décider des modalités de vote. Applaudissement ? Main levée ? Bulletin secret ? Malgré la difficulté matérielle de l’opération, c’est le vote à bulletin secret qui l’emporte.
Tu fais acte de candidature, tu sais que tu seras élue, la plupart des étudiants de philo te connaissent, tu es à l’aise dans l’AG et de surcroît, tu fais partie des « inorganisés » ce qui, par ces temps de méfiance à l’égard des groupuscules, n’est pas un mince avantage. Et lorsqu’un peu plus tard tu t’assoies à la tribune avec les cinq autres élus, il ne reste plus qu’à décider de modalités organisationnelles : réunion quotidienne du comité de grève, tenue d’un AG au moins trois fois par semaine, création de cinq commissions, « examens », « contenus et méthodes », « concours », « IPES », « liaison étudiants/ouvriers ». Après ces quatre heures de débats procéduriers, signes de la crainte obsessionnelle des étudiants de philo d’être dépossédés de leur pouvoir ou d’être récupérés, l’énergie commence à fléchir quand l’annonce du débrayage de l’usine Renault de Billancourt fait le tour de l’amphi. Les applaudissements crépitent. Avec la Régie occupée, pas de doute, c’est la grève générale qui commence.
Vendredi 17 mai,
trois cent mille grévistes à onze heures, six cent mille à dix-sept heures, grève dans toutes les usines Renault, à Billancourt, à Sandouville, à Flins, au Mans, grève à Berliet, grève à la Rhodiaceta, grève aux chantiers navals du Trait, grève aux Forges et Aciéries du Creusot, grève à la manufacture d’armes de Bayonne, grève dans les usines métallurgiques d’Elbeuf, grève qui commence à la SNCF, à la RATP, à Air France.
Emballement de la grève, grève qui s’étend comme une trainée de poudre, et sans mot d’ordre syndical, souligner ce fait, les syndicats ne sont pas très favorables à cette grève qui se développe sur la seule initiative des ouvriers.
« Grèves spontanées avec occupation des lieux de travail », disent les journaux, « pas de mot d’ordre de grève générale illimitée », précise Georges Séguy. Mais on s’en fout, camarade Georges, des mots d’ordre de la CGT ! Les ouvriers t’ont-ils attendu pour se mettre en grève ?
Samedi 18 mai,
au moins deux millions de grévistes, on ne compte plus les usines occupées, grosses entreprises. Petits ateliers. Partout. Dans les grandes et les petites villes. Au Nord, au Sud, à l’Est, à l’Ouest. Trains, métro, autobus, avions, courrier, tout est en train de s’arrêter, tout s’arrête.
S’y mettent même ceux des petites usines, même ceux qui n’avaient jamais fait grève de leur vie, même ceux de la Préméca, où ton père est raboteur.
Dimanche 19 mai,
tu déjeunes chez tes parents, malgré la grève des transports, arriver chez eux, à Colombes, ne t’a pas été difficile, tant les automobilistes, comme gagnés par une grâce nouvelle, font volontiers office de taxi collectif et gratuit. Dans Le Monde, tu as parcouru la liste des usines de la banlieue parisienne occupées : Alsthom à Saint-Ouen, Chausson à Gennevilliers, Ericsson à Boulogne, Kléber à Colombes, autant de noms qui te sont familiers, tellement tu les as entendus dans ton enfance, parce qu’un voisin y travaillait, parce qu’un accident s’y était produit, plus rarement parce qu’une grève y était menée. Le quotidien aurait pu citer aussi la Préméca qui a débrayé la veille.
Tu es curieuse de savoir comment les choses se sont passées, tu écoutes ton père avec avidité : « c’est pas compliqué, hier, avant de mettre en marche les machines, on a discuté. Un ouvrier a lancé : « dans cette usine, il n’y a jamais eu de grève, il serait temps de commencer ». On n’a pas même pas pensé à voter, on a tous dit : « oui, oui, t’as raison, il est temps de s’y mettre! ». Tu ne peux pas imaginer dans quel état de rage étaient le monsieur Claude et son fils le monsieur Serge. On a mis une banderole grève avec occupation au-dessus de la porte d’entrée. Voilà c’est tout ».
Ce c’est tout te comble, car s’il est un signe de l’ampleur du mouvement en cours, c’est bien cette occupation de la Préméca, une entreprise qui, en trente ans d’existence, n’a jamais connu un seul jour de grève, et dont le patron licenciait sans vergogne les ouvriers syndiqués.
Jamais tu n’as vu ton père aussi enflammé, enthousiaste. Cet homme que tu as toujours trouvé soumis, trop soumis, qui n’a jamais osé dire à son patron un mot plus haut que l’autre, voilà qu’il laisse libre cours, enfin, à une révolte longtemps dominée, contre la dureté du travail, mais aussi, mais surtout, contre l’exploitation et le mépris. Tu t’étonnes encore plus de l’attitude de ta mère qui, pour la première fois, fait fi de ses sempiternelles craintes du licenciement, de la maladie, pour lancer avec détermination : « la grève, il faut la mener jusqu’au bout ». « C’est quoi le bout ? » « Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de patrons ! ».
Voilà ce qu’était Mai, des femmes et des hommes qui n’avaient jamais levé le petit doigt, jamais osé, et bien même ceux-là étaient en grève. Occupation, prise de parole, fin du silence, de l’obéissance, de la soumission…
Est-ce de cette rupture que l’on ne veut pas se souvenir, que l’on enfouit, recouvre, enterre sous l’imagerie ? Est-ce cette tentative de prise en main de sa propre vie que de Gaulle, rentré plus tôt que prévu de son voyage en Roumanie, appelle « la chienlit » ? « Au cours du conseil des ministres, le président de la République a déclaré « la réforme oui, la chienlit non », tu entends ces paroles historiques à la radio, et tu en rigoles, tu es encore à Colombes, dans cet appartement où tu as passé ton enfance, tu es dans la grève de la Préméca, dans l’inattendue et salutaire fermeté de tes parents, tu es dans cet appartement et en même temps tu es ailleurs, au Quartier latin, alors, tu quittes tes parents, tu retournes à Paris.
Quand tu arrives à la Sorbonne, tu es stupéfaite du monde qui s’y presse, une foule hétéroclite où se côtoient des familles endimanchées paraissant faire là leur promenade dominicale, des loubards de banlieue à la fois arrogants et perdus, des types puant le fric, des bonnes femmes émoustillées à l’idée de côtoyer les « enragés » dont une semaine avant elles ne soupçonnaient même pas l’existence. Tu n’aperçois aucun visage connu, ni dans la cour de ta Sorbonne, ni dans les rues et les cafés alentour, tu t’en vas, tu t’enfuis, tu refuses et le spectacle et le public, comme si tu y trouvais la confirmation de ce que tu as déjà deviné, la capacité du système à tout digérer et l’impasse de la seule révolte. A partir de ce jour, tu as éprouvé pour la Sorbonne que tu aimes tant une sorte de dégoût, tu as commencé à lui préférer Censier que tu n’appréciais guère avant, mais qui échappe à la mondanité qui s’est emparée de la vieille faculté.
Lundi 20 mai,
quand même tu es à nouveau à la Sorbonne, le nombre de grévistes a encore augmenté, sept millions, toujours sans mot d’ordre des centrales ouvrières, comme on les appelait alors, grèves déclenchées sans elles et même contre elles, puis trahies par elles, il faut s’en souvenir de la trouille des bureaucraties syndicales, de leur façon de tout mettre en œuvre d’abord pour enrayer les grèves, ensuite pour les arrêter, bureaucraties qui freinent des quatre fers toute la semaine sans parvenir à empêcher le développement du mouvement, sept millions de grévistes le lundi 20 mai, ouvriers, employés, enseignants, étudiants, et aussi médecins, acteurs, avocats. Et Georges Séguy qui insiste : « pas de grève insurrectionnelle ». Et pourquoi pas ? Pourquoi pas une insurrection ? Pourquoi pas la révolution ?
Pour l’heure, à défaut d’insurrection et de révolution, monceaux d’ordures ménagères sur les trottoirs, queues aux guichets des banques qui limitent les retraits d’argent à 1000 puis 500 francs, stations-service qui commencent à manquer d’essence, gens qui se mettent à stocker pâtes, riz, huile, sucre. Et les Français qui marchent, qui font du stop, qui enfourchent leurs vélos, qui grimpent dans les camions militaires. Et le soir, à nouveau une foule considérable qui se presse à la Sorbonne, attirée cette fois par les célébrités intellectuelles qui doivent se produire dans le grand amphithéâtre, avec, en tête d’affiche, Jean-Paul Sartre.
Tu es émue à la perspective de voir en chair et en os Sartre et Beauvoir que tu ne connais pas mais que tu admires, autant pour leur vie que pour leur œuvre, que tu ne sépares pas. Tu ne les a vus et entendus qu’une seule fois, c’était en décembre 1964, le 9 exactement, lors du débat organisé à la Mutualité par Clarté, le mensuel de l’Union des étudiants communistes, autour de la question Que peut la littérature ? Tu avais alors vu en chair et en os, celle et celui que tu avais tant lus, et qui t’avaient donné une représentation romanesque et romantique du Quartier latin, de la Sorbonne, de Normale sup, de la vie d’étudiante et peut-être même de la vie tout court. Et c’est sans doute grâce à eux que tu as choisi de faire des études de philosophie, comme si celles-ci, immanquablement, menaient à une existence semblable à la leur, faite d’engagements, de voyages, d’amours.
Mais tu arrives en retard, l’amphi est archibondé, tu ne peux pas rentrer, tu vas au café parler avec les uns, les autres.
Mardi 21 mai,
encore davantage de grévistes, dix millions, encore de nouvelles occupations, celles de tous les grands magasins, de Opéra et de l’Opéra-comique, des sièges de la Confédération générale des cadres, de la Société des gens de lettres, de l’ordre des médecins, de la fédération française de football et même du CNPF !
Inouï. Magnifique. Merveilleux. A-t-on déjà vu cela en France ? « C’est mieux qu’en 36 » affirment ceux qui ont vécu le Front populaire.
A-t-on déjà ressenti cette légèreté qui a conquis Paris, cette allégresse qui traverse les quartiers, comme une grâce imprévisible, née on ne sait comment ? A-t-on déjà vu autant de gens se rencontrer, se parler, dans les rues, les usines, les bureaux, transformant le pays en une immense assemblée générale?
Dans leur mépris ou leur peur, les autres disent « psychodrame », les autres disent « défoulement collectif », et toi tu estimes que si les gens se défoulent, c’est qu’ils en ont assez de taire ce qu’ils ont sur le cœur : la dureté du travail ou l’ennui du boulot, l’injustice et l’humiliation de chaque jour. Enfin ils se mettent à parler publiquement, sans honte, sans crainte, des cadences, des fins de mois, à dire leur refus d’une société sans âme, leur envie d’autre chose, leur aspiration à autre chose, sans qu’il soit possible de préciser vraiment cet « autre chose », avec l’évidence que les formules quelles qu’elles soient – « en finir avec le gaullisme », « en finir avec le capitalisme » – ne parviennent pas à traduire ce désir de vivre autrement, tandis que s’esquisse une mise en acte de cet autrement, dans une nouvelle manière d’être ensemble, joyeuse, solidaire, fraternelle.
Mais comment aller plus loin ? Comment transformer cette formidable aspiration en force révolutionnaire capable de changer la société ? Combien de réunions qui débattent de cette question ? Combien de tracts qui prétendent apporter la réponse ? Rendus euphoriques par cette expansion des grèves, les étudiants de philo, réunis en AG à Censier, n’ont qu’un souci, savoir comment ils peuvent continuer à contribuer à cette paralysie qui prend peu à peu le système, conscients pour la plupart d’être devenus, après avoir joué leur rôle historique de détonateurs, des acteurs secondaires.
« Il faut quitter les facs, aller aux portes des usines pour soutenir ceux qui sont déjà en grève, pour pousser ceux qui ne le sont pas encore à s’y mettre » soutiennent les uns. « Il faut rester dans les facs, et y développer une stratégie radicale et maximaliste, refuser les revendications partielles, faire avorter toute tentative de négociations, empêcher les projets de réforme de l’université » affirment d’autres. « Il faut nous investir dans nos quartiers, créer des comités d’action partout où c’est possible, pour y développer une perspective révolutionnaire, résister aux réformistes et aux staliniens » proclament les troisièmes. Derrière l’apparente diversité de ces propositions, un point commun : l’attente des étudiants à l’égard de la base ouvrière, jugée révolutionnaire, leur espoir qu’elle ne se laissera pas manipuler par les directions syndicales et enfermer dans des revendications traditionnelles.
Le pays tout entier réfléchit. Le pays tout entier attend. Mais qu’attend-il ? De quoi est-il attente ? On l’ignore. On devine que l’actuelle situation ne peut durer infiniment sans savoir d’ailleurs pourquoi. Pourquoi en effet ne pourrait-on pas toujours vivre dans cette parenthèse? Pourquoi n’est-ce pas la parenthèse, avec cette grève continue, sans cesse recommencée, avec la beauté de ces femmes et de ces hommes qui parlent, qui se parlent, à chaque coin de rue, à chaque carrefour, dans chaque cour d’immeubles, qui est la vie ? N’est-ce pas ainsi qu’il faudrait toujours vivre? N’est-ce pas ainsi que devrait être la vie ? N’est-ce pas cela « changer la vie » ?
Que va-t-il se passer ? Que va faire le gouvernement ? Est-il encore capable de prendre une décision ? Oui, il en est capable : il interdit à Daniel Cohn Bendit, parti à Berlin, de revenir en France. Le motif ? En déclarant que le drapeau tricolore devait être déchiré pour devenir un drapeau rouge, Dany n’a-t-il pas insulté le drapeau national ?
Mercredi 22 mai,
après le gouvernement c’est la gauche qui veut prouver son existence en déposant une motion de censure à l’Assemblée nationale. Renverser Pompidou, prendre sa place, voilà ce qu’ils veulent, les Guy Mollet, les Mitterrand, les Waldeck Rochet, prêts à brader la grève pour un fauteuil ministériel, un bout de pouvoir, une petite place au soleil. Mais que croient-ils ? Que le changement de gouvernement va passer pour un changement de la société ?
Jeudi 23 mai,
tu te réjouis d’apprendre qu’à Saint-Brieuc des paysans fraternisent avec les cheminots en grève, « ouvriers, paysans, étudiants, même combat ». Mais tu t’inquiètes d’entendre les syndicats annoncer qu’ils sont « prêts à négocier », toi tu penses qu’il faudrait dire : « prêts à brader la grève ». Neuf jours de grève et déjà prêts à négocier, à la faire entrer dans les quelques pour cents d’augmentation de salaire qu’ils vont demander, ont la trouille, les syndicats, peut-être autant que le gouvernement. Négocier quoi ? La révolution ? ».
Tu ne cesses de répéter ces accusations pendant que tu distribues le tract de l’UNEF qui appelle, pour le lendemain, à un rassemblement devant la gare de Lyon : « faut que les travailleurs refusent le piège des négociations annoncées »… « faut se battre contre l’interdiction de séjour de Cohn Bendit »… « faut que de Gaulle quitte le pouvoir »… « faut pas penser que Mitterrand ou même Mendès France représentent une solution »… « faut affirmer la solidarité des étudiants et des travailleurs »… « faut continuer la grève et l’occupation des lieux de travail »…« faut coordonner les luttes et créer des comités qui regroupent, à la base, les ouvriers, les paysans, les enseignants, les étudiants »… Tu passes des heures à enfoncer ces clous, répéter ça, sans être certaine qu’ils suffiront à briser les manœuvres des uns et des autres. Mais que faire d’autre ?
A Censier tu vas de salle en salle, d’amphi en amphi, distributions de tracts et discussions sans cesse répétées.
A quatre heures de l’après-midi, tu déboules à la commission baptisée Contenus et méthodes, juste pour distribuer tes tracts car l’objet de ladite commission, bâtir un nouvel enseignement de la philosophie, élaborer d’autres contenus et d’autres méthodes d’enseignement, tu t’en fiches, ou plutôt tu t’en méfies, tu le juges susceptible d’être récupéré par les réformistes, utilisé pour donner un vernis moderniste à l’université, mieux l’adapter à la société telle qu’elle est. Tu entends des profs dire : « on ne peut pas enseigner dans le désordre … l’acte même d’enseigner suppose un ordre… les enseignants peuvent vouloir un ordre différent de celui qui existe mais que c’est tout de même un ordre qu’ils veulent… l’exercice de leur profession suppose un fonctionnement de l’Université… »…Tu entends ces propos, tu t’empares de la parole : « de quel ordre est-il question ? Les patrons aussi peuvent faire l’éloge de l’ordre, l’estimer nécessaire au travail, à la production… l’ordre n’est-il pas aussi ce qui permet l’exploitation…Et l’ordre qui régit l’actuelle organisation de la société, qui distingue ceux qui dirigent et décident de ceux qui exécutent, qui commandent la division du travail et du savoir, qui se fait passer pour un ordre naturel, intangible, voilà bien ce que notre mouvement conteste… Quant à l’enseignement, il se peut qu’il suppose un ordre, mais lequel ? Et pour enseigner quoi ? Et à qui ? Et comment ? Et pour quel usage social ? »
Vendredi 24 mai,
d’abord c’est une promenade dans la douceur printanière, vers cinq heures, à quelques centaines on quitte Censier pour rejoindre la gare de Lyon, un cortège bon enfant, détendu, qui s’engage dans la rue Daubenton, longe le jardin des Plantes. Sur le pont d’Austerlitz, le cortège s’accroit d’autres manifestants arrivant on ne sait d’où, impossible d’atteindre l’esplanade de la gare de Lyon, tant la foule est déjà nombreuse, et de tous côtés, continuent d’affluer des étudiants mais aussi des jeunes ouvriers qui, après avoir participé, dans l’après-midi, aux manifestations de la CGT, rejoignent, malgré les mises en garde répétées du parti communiste, le rassemblement de l’UNEF.
Il fait beau et chaud, la foule est calme, massive, presque immobile, brouhaha de conversations, L’Internationale reprise à intervalles réguliers, bribes de discours qui parviennent d’une invisible tribune, vagues des slogans « Les usines aux travailleurs », « Nous sommes tous des Juifs-Allemands », « Le pouvoir est dans la rue », « Ouvriers et étudiants solidaires ». Et toi tu ne tiens pas en place, tu virevoltes, tu bavardes avec l’un, avec l’autre, en attendant le discours de de Gaulle, juste avant vingt heures, des groupes se forment, compacts, autour de ceux qui ont eu la bonne idée d’apporter un transistor, la voix s’élève de centaines de postes, « mutation nécessaire de la société » … « participation »… « reconstruction de l’Université »…« évolution du pays »…« adaptation de l’économie aux nécessités nationales et internationales »… Le discours se termine, un referendum est annoncé et de Gaulle précise : « au cas où votre réponse serait « Non ! », il va de soi que je n’assumerais pas plus longtemps ma fonction ».
Alors comme les autres, tu agites ton mouchoir, tu chantes, sur l’air des lampions, « adieu de Gaulle, adieu de Gaulle, adieu ! » tu lances « Quel vieux con ! » Tu es alors trop jeune pour excuser un présent que tu juges médiocre au nom d’un passé magnifique.
Bien des années plus tard, tu ne t’es pas mise, comme d’autres, à regretter d’être passée à côté du général de Gaulle, à le parer de toutes les vertus, pour chaque moment de sa carrière et de l’exercice du pouvoir. Tu as continué à penser que le de Gaulle de ta jeunesse n’était pas celui de la guerre. Ton regret cependant fut d’avoir recouvert complètement le premier par le second, et des années après, comme pour Cavaillès, tu pris la mesure de son courage et de la grandeur de son geste en 1940.
Mais ce 24 mai 68, tu identifies de Gaulle à ce pouvoir que tu combats, à ces tirs de grenades lacrymogènes qui commencent à se faire entendre. En effet, alors que les manifestants sont encore debout devant la gare de Lyon, que le cortège paraît encore immobile, hésitant, il semble qu’ailleurs, tout près – mais où exactement et pourquoi ? – des affrontements avec la police ont déjà commencé.
Les chaînes se forment, les bras s’accrochent, un mouvement s’esquisse, d’abord vers la Nation, on marche, on court, on s’arrête, on court à nouveau, la foule change de direction, envahit le boulevard Voltaire, bombes lacrymogènes, cocktails Molotov, la nuit est tombée, on avance toujours, on est place de la République, puis tu cours, tu cours rue de Turbigo, tu as beau chercher des visages connus, tu n’en remarques aucun, tu cours rue Réaumur, tu arrives devant la Bourse, les flammes qui sortent du palais Brongniart sont les seules lumières dans la nuit. Adossée, pour reprendre ton souffle, à la vitrine de la brasserie Le Vaudeville, tu n’en crois pas tes yeux : « qui a mis le feu au symbole du capitalisme? Qui a osé? »
Soudain tu as la trouille, tu penses que les flics vont sûrement arriver, tu t’engages dans la rue du 4-Septembre, et, sur la place de l’Opéra, tu tombes, étonnée, sur un vrai cortège. Mais d’où peut-il bien venir ? Tu es crevée, tu en as a marre, te fondre dans la masse te rassure, tu reprends ta marche, place Vendôme, Louvre, Pont Neuf en courant, étroite rue Dauphine, ciel de lacrymogènes, manifestants serrés qui se protègent les yeux avec les linges humides jetés des fenêtres par les riverains, troupe silencieuse qui s’avance sans slogan, sans chant, un instant, tu as l’impression étrange, folle, de partir au combat, croisement du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel, tu ne distingues plus, devant et derrière toi, que des barricades, amas d’arbres abattus, de grilles, de poteaux, tu te mets aussi à passer des pavés, tantôt tu te demandes ce que tu fous là, tantôt tu te crois en train de vivre une scène des Misérables, d’être avant l’assaut final. Mais l’assaut de quoi ?
Dans l’obscurité de la rue que seules éclairent les flammes des barricades, tu ne vois rien d’autre que les trois ou quatre mètres qui sont devant toi, tu entends des bruits assourdissants, des explosions répétées, des salves de grenades offensives, tu as envie de te tirer, tu sais qu’il faut partir, tu devines que le nettoyage du quartier va être terrible. Mais comment sortir de là ? Comment trouver une issue ? Tu ne sais pas, tu reprends le parcours en sens inverse, les flics ne doivent plus y être, boulevard Saint-Germain, rue Mazarine, tu repasses sur la rive droite, tu prends les quais, la rue de Rivoli, d’autres rues, ici l’impression d’être dans une autre ville, ici pas de manif, pas de barricades, pas de flics, calme de la nuit, un silence qui te paraît étrange après le vacarme des heures écoulées.
Samedi 25 mai,
tu t’es réveillée tard, mal à la tête, mal au yeux, mal à la gorge, et encore l’odeur des lacrymos dans le nez, tu files directement à Censier sans passer par le quartier de la Sorbonne, pas envie de voir les arbres arrachés, les voitures renversées, les restes de barricades, et encore moins les innombrables badauds venus contempler le champ de bataille, et même se faire photographier devant des carcasses de bagnole, comme au lendemain de la nuit du 10 mai, ce tourisme d’après manif te dégoûte.
Donc directement Censier, l’amphi B, au lendemain de cette nuit à la fois terrible et absurde où tu t’es sentie si seule, si isolée parmi ces milliers de gens dont certains t’ont paru animés d’un goût de l’affrontement, d’un penchant pour la violence, presque d’un désir de guerre auquel tu n’as pu que rester étrangère.
A travers les récits des journaux et ce que racontent tes camarades, tu prends davantage la mesure de ce qui s’est passé et tu comprends d’où t’est venue l’impression de confusion que tu as ressentie au long de la soirée, manifestants contraints par les nombreux barrages policiers à s’engager, depuis la gare de Lyon, dans différentes directions, éclatement des cortèges, dispersion des affrontements, à la Bastille, à la Nation, à la Bourse, en plusieurs points du Quartier latin, violences policières, ratonnades dans les rues, matraquages dans les fourgons, les hôpitaux, les commissariats de police, Pierre Mendès France et l’archevêque de Paris, monseigneur Marty, venus au cœur de la nuit, à la Sorbonne, au chevet des blessés…
Dans l’amphi B, plein d’étudiants, mélange d’abattement, d’excitation, de colère, de désarroi. Que peut-on faire ? Que faut-il faire ? Vote dérisoire d’une motion pour dénoncer, condamner ces violences policières ainsi que les déclarations du ministre de l’intérieur, Christian Fouchet, « la pègre, sortie des bas-fonds de Paris, se dissimule derrière les étudiants ». Mais de qui parle-t-il ? Des jeunes ouvriers, très nombreux, qui ont participé à la manifestation ? Après les « enragés », les « provocateurs », « les éléments incontrôlés », expressions auparavant utilisées pour disqualifier les étudiants, voilà que le gouvernement, prétendant séparer le bon grain de l’ivraie, n’hésite pas à adopter un langage digne de celui des Versaillais parlant des Communards.
Plus tard, tu es avec d’autres dans un café, tu effaces peu à peu les ombres de la nuit, tu es à nouveau installée dans le moment présent, dans cette ardeur de la discussion qui vous tient tous. Quel est le sens des derniers affrontements ? Ne font-ils pas le jeu du pouvoir ? Celui-ci ne les a-t-il pas provoqués pour susciter un climat de peur ? Pourquoi le cortège est-il revenu au Quartier latin ? Est-ce délibérément ? Ou parce que la police le souhaitait ? N’a-t-on pas, hier soir, raté le coche ? Au lieu de mettre le feu à la Bourse, n’aurait-il pas été préférable de s’emparer d’un ministère, faire ainsi la preuve qu’il n’y avait plus de gouvernement effectif ? Et à quoi a servi la manifestation ? A montrer la nécessité d’affronter le pouvoir ? A affirmer l’existence d’une force d’opposition aux négociations qui s’ouvrent rue de Grenelle entre les syndicats, le patronat et le gouvernement, sous la présidence du Premier ministre, et qui visent à canaliser la grève, à la ramener à des schémas connus, à l’enfermer dans des revendications traditionnelles, à lui ôter son potentiel subversif ?
« Pourvu que les grévistes fassent échouer cette manœuvre ! », telle est votre espérance à tous.
Dimanche 26 mai,
tu déjeunes chez tes parents, la conversation roule sur les négociations de Grenelle, ton père te dit : « si on en tire une augmentation de salaire, une baisse du temps de travail et une reconnaissance du droit syndical, ça sera bien ». Tu connais la dureté de sa vie à l’usine, tu admets que « toute amélioration est bonne à prendre », c’est ce qu’il te serine, pourtant, cette modération t’agace, tu lui fais remarquer qu’avec leur grève, les ouvriers peuvent obtenir beaucoup plus, « mais quoi, demande-t-il, exactement quoi ? »
Et parce que tu es bien incapable de répondre « exactement » comme le réclame ton père, tu te lances dans un discours enfiévré, « urgence d’en finir avec une société d’injustices et d’inégalités »…« foutre en l’air un système d’exploitation où patrons et actionnaires s’enrichissent sur le dos des ouvriers »… « longtemps qu’il n’y pas eu une grève aussi importante en France, et même en Europe »… « pourquoi la brader si vite dans une négociation dont les éventuels avantages seront bien vite repris »… « pourquoi ne pas tenter d’imposer un pouvoir économique et politique des travailleurs ? »… « pourquoi ne pas remettre les usines en marche au profit des ouvriers, réaliser l’union de tous ceux qui produisent les richesses et qui sont sans cesse volés des fruits de leur travail »… « pourquoi ne pas inventer un autre système ? »… « avec une telle grève, tout est possible ! »
« T’es complètement folle, ma pauvre fille, c’est ce que ton père te rétorque, complètement folle, si on fait ce que tu dis, ils nous enverront l’armée, ils nous tireront dessus, c’est ça que tu veux, mourir pour la révolution. Et en URSS, t’as vu ce qu’elle a donné la révolution ! ». Le sempiternel argument est lâché, cent fois que tu l’as entendu, cent fois que tu as répondu que la France n’est pas la Russie tsariste, que le régime qui règne en Union soviétique n’a rien à voir avec le socialisme, qu’on peut s’y prendre autrement, que tu n’attends rien des communistes, cent fois en vain, et aujourd’hui encore tu as l’impression de te heurter à un mur, à une surdité que tu crois volontaire, qui te paraît servir d’alibi à la soumission, à la résignation. Cette résignation à l’ordre des choses, n’est-ce pas ce que tu refuses depuis que tu es adolescente?
Lundi 27 mai,
tu es encore chez tes parents, quand tu entends Pompidou l’annoncer à la radio, ce « compromis » … « caractère fécond de la négociation »… « avantages sociaux exceptionnels »… « nécessité d’une reprise rapide du travail »…
Qu’est-ce qui a été obtenu ? Une augmentation du SMIG, une augmentation des salaires de 10% mais en deux étapes, en juin et en octobre, une légère baisse du temps de travail, un projet de loi sur l’exercice du droit syndical dans les entreprises. « Deux semaines de grève générale pour aboutir à si peu de choses, j’espère bien que les ouvriers ne vont pas marcher dans cette combine ! » Tu attends une réaction de ton père. En vain. C’est sans un commentaire qu’il t’embrasse et part pour son usine.
Plus tard, à la Sorbonne, désarroi, perplexité qui se conjuguent avec l’incertitude politique, la crainte que la signature d’un compromis entre les syndicats, le patronat et le gouvernement, à l’issue des négociations de Grenelle, mette fin à la grève. Interrogation : « Les ouvriers vont-ils approuver le compromis ? »
Mais dans la matinée arrive la nouvelle qui provoque une explosion d’enthousiasme : réunis en meeting, les ouvriers de Renault Billancourt, ont refusé l’accord et ont même sifflé Georges Séguy et Benoît Frachon, les leaders de la CGT.
Alors reviennent les sourires. Alors renaît l’espérance.
Euphorie de l’AG de philo. Au fil des heures, le miracle s’est confirmé : après les ouvriers de Renault, ceux de Berliet, de Sud-Aviation, de Citroën, de la Snecma, de Rhodiacéta ont décidé aussi de poursuivre la grève. Va-t-on passer, comme le redoute le journaliste Pierre Viansson Ponté dans Le Monde de l’après-midi, « d’une grave crise nationale à une situation révolutionnaire »?
Justement, c’est ce qu’elle veut, l’AG, passer à une situation révolutionnaire ! Mais comment ? Comment aller plus loin ? Comment donner une incarnation politique au formidable potentiel que représentent les grévistes ? Comment contrer l’illusion du gouvernement populaire que commencent à proposer les communistes et les socialistes ? Est-ce le rassemblement organisé le soir même par l’UNEF au stade Charléty et où sont conviés étudiants et ouvriers qui peut offrir une autre perspective politique ? Ou bien s’agit-il juste d’une opération conduite par le syndicat étudiant, le PSU et la CFDT pour mettre en selle Pierre Mendès France, comme certains l’affirment ? Questions de l’AG, questions dans la tête de chacun.
Tu ne sais plus trop quoi penser ni quoi faire. Aller au meeting du stade Charléty a-t-il un sens ? ». « N’est-il pas une combine politique, différente de celle conduite par les communistes, mais une combine cependant ? N’est-il pas la carte ultime jouée par la partie la plus réformiste de la bourgeoisie ? Au lieu d’inciter les grévistes et tous les citoyens à s’organiser, à prendre en mains leur vie et la société, ne leur fait-on pas croire que certains savent ce qu’il convient de faire, à leur place ?
Mais quand tu vois un cortège se former, tu t’y mêles, « ce n’est qu’un début, continuons le combat » rue Monge, avenue des Gobelins, avenue d’Italie, boulevard Kellermann, la foule ne cesse de grossir, de crier, de taper dans ses mains, de chanter… Dans un mélange de drapeaux rouges et noirs, de banderoles étudiantes et de pancartes ouvrières, d’applaudissements qui saluent les délégations de Sud-Aviation, de Renault, du Crédit lyonnais, de l’ORTF, l’entrée dans le stade Charléty prend des allures de cérémonie joyeuse et fraternelle. Tu y es dans cette foule, et tu ne boudes pas ton plaisir…
« La pègre est venue nombreuse ! » Jacques Sauvageot, le vice-président de l’UNEF, ouvre le meeting, suivi d’un orateur qui exalte l’alliance des travailleurs manuels et des travailleurs intellectuels, d’un autre qui affirme que les droits sociaux ne doivent pas se négocier mais se conquérir, d’un autre encore qui appelle à la création de comités révolutionnaires de quartier, d’André Barjonet, qui vient tout juste de démissionner de la CGT et qui, qualifiant la situation de révolutionnaire, affirme « tout est possible ! »
« Tout est possible ! » les mêmes mots, exactement, que ceux que tu as lancés, la veille, à ton père.
Mardi 28 mai,
Mitterrand annonce sa candidature à la présidence de la République et l’éventuelle constitution d’un gouvernement provisoire dont la direction pourrait être assurée par Mendès France.
« Ils essaient de tirer les marrons du feu, de détourner en leur faveur ce mouvement qu’ils regardent depuis le début avec méfiance », as-tu immédiatement jugé, appréciation que partagent tes camarades. Encore avez-vous quelque estime pour Mendès, mais à l’égard de Mitterrand, ce carriériste de la quatrième République, vous n’éprouvez que du mépris. Les manifestations ont-elles eu lieu pour qu’il prenne la place de Pompidou ou de Gaulle ? Les ouvriers sont-ils en grève depuis deux semaines pour un simple changement de personnes ? Qu’attendre de ces politiciens bourgeois prêts à gérer le système tel qu’il est, comme ils l’ont déjà fait ? Rien.
Mercredi 29 mai,
disparition du Général, un vrai coup de théâtre, juste avant midi, on apprend l’annulation de l’habituel conseil des ministres du mercredi et le départ du président de la République avec sa femme pour Colombey-les-Deux-Eglises. Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’il va démissionner ? Qu’il prépare une opération de diversion ? Les interrogations s’accumulent quand un moment plus tard, c’est la disparition de de Gaulle qui est annoncée. Certes il a quitté l’Elysée, certes il est monté dans un hélicoptère à Issy-les-Moulineaux mais il n’est pas arrivé dans sa propriété de la Boisserie. Où est-il donc ? Personne ne semble le savoir. Et que dit le Premier ministre ? Et le gouvernement ? Mais y-a-t-il encore un gouvernement ?
Que va-t-il se passer ? Des élections vont-elles être organisées ? Un gouvernement provisoire va-t-il être formé ? Dirigé par qui ? Par Mendès France? Par Mitterrand ? Avec les communistes ? Sans les communistes ? Mais si le pouvoir est vacant, pourquoi des forces révolutionnaires ou en tout cas plus à gauche que les socialistes et les communistes ne s’engouffreraient-elles pas dans la brèche ainsi ouverte ? Mais quelles forces ? Qui est capable de porter politiquement la puissance des grévistes ?
Bien étrange journée, avec dans l’après-midi, la manifestation organisée par la CGT, de la Bastille à la gare Saint-Lazare, des centaines de milliers de manifestants derrière Georges Séguy, Benoît Frachon, Jacques Duclos, Etienne Fajon, mobilisation immense. « Pour rien », rabâches-tu, postée des heures sur les trottoirs du boulevard Beaumarchais, dans un mélange de colère et de tristesse, « juste pour canaliser les grévistes, empêcher qu’ils ne soient séduits par une autre perspective politique que celle offerte par les communistes, pour afficher une rhétorique radicale alors que la CGT, dans les faits, ne cherche qu’à mettre fin à la grève ».
Tu ressasses ces considérations sans en être surprise, pas étonnée en effet que les communistes montrent qu’ils ne veulent pas le pouvoir ou plutôt préfèrent sauver la mise à de Gaulle plutôt que de favoriser un gouvernement de Mitterrand ou de Mendès France, toujours la même histoire, dans des circonstances plus tragiques, même attitude du PC allemand dans les années 30, plutôt Hitler que les socialistes.
Etrange journée où l’on a vu la vacance du pouvoir, le blocage des institutions, l’évidente nullité des directions politiques et syndicales, l’inexistence d’une alternative révolutionnaire, étrange journée qui te laisse perplexe, comme le sont les étudiants et enseignants avec lesquels, en fin d’après-midi, tu es à nouveau installée à L’Escholier, ton café préféré place de la Sorbonne. Maintenant vous savez que de Gaulle est arrivé chez lui, à la Boisserie, mais nullement ce qu’il a fait pendant les heures séparant son départ de Paris et son arrivée à Colombey, et chacun de s’interroger : « n’est-on pas cet après-midi passé à côté de quelque chose ? »
Tu es persuadée qu’aujourd’hui la brèche aurait dû et pu être élargie. « Il fallait profiter de ce vide », lances-tu aux profs qui, bien qu’ils soient tous plus âgés et qu’ils aient plus de savoir et d’expérience, te paraissent aussi impuissants que toi et même davantage, à prendre l’exacte mesure de la situation. Mais qui en est capable ? Pour la première fois depuis le début du mois de mai, tu as l’impression d’un ratage et même d’une occasion historique manquée.
Jeudi 30 mai,
A l’attente pleine d’espérance des jours précédents a succédé une attente inquiète, ponctuée d’efforts faits pour se rassurer, se répéter que malgré les tentatives de division, malgré les négociations conduites secteur par secteur, les grévistes tiennent toujours, et même certains débraient à nouveau après avoir repris le travail, tels ceux de l’usine Lesieur à Dunkerque. Mais on sent bien qu’on n’a plus la main, que quelque chose nous échappe, que la scène est en passe d’être reprise par ses habituels occupants.
Journée passée à l’attendre le discours annoncé du général de Gaulle, une journée en grande partie vide, traîner, bavarder dans les couloirs et les amphis, on va au café, on revient à la fac, on écoute la radio, on commente la candidature de Mendès France à la direction d’un gouvernement provisoire…
A quatre heures et demi, on se met à écouter l’allocution du Général diffusée par la radio, voix ferme, bien plus ferme que le 24 mai : « je ne me retirerai pas » … « je ne changerai pas le premier ministre » … « je diffère la date du référendum » … « je dissous l’Assemblée nationale … « intimidation » …« intoxication » … « tyrannie »… « un parti qui est une entreprise totalitaire »… « il faut que s’organise l’action civique »… « France menacée de dictature ».. « ambition et haine de politiciens au rancart ».
Tu prends tous ces propos en pleine gueule et surtout cette manière qu’a le président de la République de nous tenir pour quantité négligeable, de disqualifier toutes nos aspirations, de nous assimiler à la menace communiste. Mais quelle menace ? Le PC n’est-il pas, depuis le début, le plus sûr allié du pouvoir en place ? N’a-t-il pas tout fait pour empêcher le développement des grèves, pour les limiter à des revendications corporatistes, traditionnelles ? Quand de Gaulle s’en prend à ceux qui empêchent les « étudiants d’étudier, les enseignants d’enseigner, les travailleurs de travailler », c’est la franche rigolade. On rit tous, mais jaune. On devine que ce discours risque bien de renverser la situation : la gauche, n’en doutons pas, va se féliciter de ces élections législatives, trop heureuse de retrouver un scénario connu et l’habituel petit jeu parlementaire, un jeu qui exclue tous ceux qui ne votent pas et d’abord cette jeunesse sans laquelle rien ne se serait passé.
Un seul espoir : que les ouvriers refusent le piège électoral comme ils ont refusé les accords de Grenelle. Après avoir compris que les avantages proposés seraient bien vite repris par les patrons, vont-ils comprendre que la prétendue sauvegarde de la République ne sert qu’à masquer celle des intérêts de la bourgeoisie ? Vont-ils admettre de perdre le pouvoir qu’ils ont conquis dans leurs usines depuis le 13 mai ? Vont-ils s’apercevoir que les partis de gauche les trahissent comme les trahissent les bureaucraties syndicales ?
Ainsi que les autres, tu te raccroches à cet espoir, plutôt tu t’efforces de t’y raccrocher, mais intimement tu n’y crois pas, tu t’en vas, tu en as assez de Censier, de la Sorbonne, du Quartier latin, tu t’y sens enfermée, prisonnière, tu as envie de savoir comment les gens réagissent aux propos du président de la République, tu décides d’aller voir tes parents pour connaître leur opinion et celle des ouvriers de la Préméca.
Dans les camions militaires, substituts des transports en commun, qui te mènent en banlieue, le soulagement des uns – « ça va enfin finir la chienlit » – se mêle à l’amertume des autres – « de Gaulle n’aime pas les ouvriers, il est du côté des patrons ».
A Colombes, tu trouves tes parents devant la télévision. « Voilà le service minimum et officiel qu’assurent les journalistes aux ordres, alors que la majorité de l’ORTF est en grève ! », tu lances cette invective en regardant le reportage sur la manifestation des gaullistes de la Concorde à l’Etoile. Il paraît qu’ils étaient un million. Un million de gaullistes ? Ou un million de froussards, de trouillards, de profiteurs, de bourges des beaux quartiers, de réactionnaires frileux encouragés par le discours de de Gaulle à redresser la tête?
C’est alors que tu vois cette image de Malraux à la télé, Malraux agrippé à Michel Debré, c’est la bousculade, élus avec leur écharpe tricolore, types en costard cravate, les uns ont le pouce levé, d’autres font le V de la victoire, ruée des photographes, ils sont sous l’Arc de Triomphe, devant le tombeau du soldat inconnu, Malraux tenant la main de Debré qui chante La Marseillaise, cette image de Malraux que tu juges grotesque.
Malraux, celui avec lequel tu étais entrée dans la littérature de ton siècle, tes premières lectures du vingtième siècle, tu étais lycéenne, tu avais quinze ou seize ans, La voie royale, La condition humaine, L’espoir, les mots de Malraux t’avaient plu, exaltée même, tu en avais inscrit quelques-uns sur le carnet de moleskine noire où tu recopiais des phrases qui t’intéressaient. Une citation de L’Espoir occupait la première page, pas une citation sur la révolution ou la fraternité ou la politique ou l’héroïsme, ou les pelotons d’exécution, ou les villes bombardées, ou une réflexion grandiloquente sur la vie et la mort, pas un exemple de l’emphase si fréquente chez Malraux, non, une simple phrase : « l’Espagne, c’était cette mitrailleuse tordue sur un cercueil d’Arabe et ces oiseaux transis qui criaient dans les gorges ». Ces quelques mots, qu’avaient-ils fait résonner en toi, quand tu avais quinze ans ? Et malgré la suite, malgré ta prise de conscience de la part de comédie et même d’imposture, en 68, tu as encore pour Malraux une sorte d’attachement, alors, ce soir, devant cette image, tu as honte pour lui, tu es en colère aussi, tu as l’impression d’être trahie, tu as envie de pleurer, sur Malraux, sur toi-même, sur la défaite qui s’annonce
« Le patron, il y est, à la Concorde », ton père aussi est en rage, « c’est pas la République qu’il veut sauver, mais son fric; tu te rends compte, il ne veut même pas appliquer les accords de Grenelle, mais on va le faire céder ». « Comment ? » « Je ne sais pas, mais on trouvera ». En tout cas, pas question, pour les ouvriers de la Préméca de reprendre le travail et cette détermination te rassure un peu. Mais ton père ne te ménage pas : « ta révolution, ma pauvre fille, elle est finie, vous vous êtes mal débrouillés, fallait prendre d’assaut l’Elysée ! ».
« Pourquoi tu l’as pas pris l’Elysée ? Pourquoi tu n’y es pas allé ? » Tu déverses sur ton père la hargne que tu contiens depuis des heures, tu sais que tu as tort de t’en prendre à lui qui, comme des millions d’autres, paye l’impasse politique, les manœuvres diverses, la force des puissants, les mensonges sans cesse faits au peuple, tu t’en prends à lui faute d’avoir en face de toi ceux que tu hais et méprises à la fois, des sentiments qui te viennent de l’enfance, car depuis toujours tu as une conscience nette, précise, de l’exploitation, de l’écrasement des uns par les autres, et des baratins pour masquer cet écrasement, de la comédie pour les dissimuler, les enrober, une conscience qui ne t’a jamais quittée.
Journées de l’après 30 mai, quand tout s’effiloche, se dilue.
Car de Gaulle a donné le signal, tout doit redevenir comme avant, donc pour ces journées d’après le 30 mai, il faut dire ce mélange d’effondrement, de tristesse, de colère, d’acharnement aussi à continuer, journées toujours faites de manifs, d’assemblées générales, de comités et même de grèves.
Ces journées de juin 68 dont les récits de Mai ne parlent presque jamais, comme si elles n’avaient pas existé, comme si tout était rentré dans l’ordre immédiatement, alors que cela a pris du temps, syndicats, partis de gauche, pouvoirs en place devant déployer manœuvres et énergie pour briser l’élan, remettre le fleuve dans son lit.
Ces journées de juin 68 où tu ne cesses de répéter « c’est trop bête, un mouvement de grève si fort pour en arriver là ! ». L’ampleur prise par le mouvement t’avait étonnée mais sa défaite te surprend encore davantage, tu es jeune, tu n’as pas une grande expérience politique, tu n’as qu’une connaissance livresque des trahisons successives de la gauche française et des manœuvres de la bourgeoisie, les vivre, c’est une épreuve triste et douloureuse, une brisure.
Vendredi 31 mai,
mais d’abord dire l’écœurement, celui que tu éprouves, quand tu lis les journaux : récit du défilé de la veille, pas dégoûtés, les gaullistes, de manifester avec les paras de l’Algérie française et des militants d’Occident, pas dégoutés des slogans : « Liberté du travail », « La France aux Français », « Les cocos au poteau », « Cohn Bendit en Allemagne », « Le rouquin à Pékin », « Vidangez la Sorbonne » et même, c’est ce qu’affirme la presse, « Cohn Bendit à Dachau ». Et Malraux, les a-t-il entendus, ces slogans du cortège ? Et qu’en pense-t-il ? Tu aimerais bien lui poser la question. Qu’il manifeste pour soutenir de Gaulle, passe encore, mais qu’il se commette avec les trouillards, les frileux, les peur pour leur fric, leur bas de laine, les fachos…
Récit de la rencontre entre de Gaulle et le général Massu à Baden-Baden, en Allemagne. Voilà donc ce que le président de la République a fabriqué pendant les quelques heures de sa « disparition » le 29 mai, aller s’assurer auprès du commandant en chef des forces françaises en Allemagne du soutien de l’armée.
Communiqué du parti communiste, rendu public immédiatement après l’intervention radiodiffusée du Général : « le P.C.F. n’avait pas attendu ce discours pour demander que la parole soit donnée au peuple dans les plus brefs délais. Il ira à cette consultation en exposant son programme de progrès social et de paix ». Bravo, de Gaulle, ton prétendu ennemi n’attendait que cela, ce détournement de la grève vers la scène électorale et parlementaire.
Annonce du remaniement du gouvernement, mais tu t’en fiches.
Samedi 1er juin,
week-end de la Pentecôte, l’essence, impossible à trouver depuis longtemps, est revenue comme par miracle, radios qui racontent les routes surchargées, les gens qui partent à la campagne ou au bord de la mer. Les gens ! Quels gens ? Ceux qui ont défilé de la Concorde à l’Etoile ? Pas ceux qui occupent toujours leurs usines ?
Tu vas à la manif de l’UNEF, de la gare Montparnasse à la gare d’Austerlitz, tu y vas sachant que c’est foutu, sans doute des ouvriers qui vont renâcler, sans doute des poches de résistance, mais les bureaucrates vont y arriver, oui ils y arriveront à les faire rentrer dans les boîtes, secteur par secteur, usine par usine, entreprise par entreprise, canaliser, endiguer, normaliser, retrouver les mots habituels, les comportements connus, les revendications traditionnelles, CGT et parti communiste savent le faire depuis toujours, déjà Thorez en 36, « il faut savoir terminer une grève ». Tu te demandes qui tu hais le plus. Le gouvernement ? Le patronat ? Les organisations syndicales ? La gauche communiste et socialiste ? Tous à la fois, tant ils te paraissent complices, soudés dans le même désir d’en finir avec les grèves, satisfaits des règles du jeu, coalisés pour conserver le monde tel qu’il est, un monde où ils ont toute leur place et qu’au fond ils ne veulent pas changer.
Alors cette manif qui va d’une gare à l’autre, c’est quoi ? Un baroud d’honneur ? L’envie de continuer, même sans espoir ? La volonté de montrer qu’on refuse de rentrer dans le rang ?
Il fait beau, place du 18 juin, il y a du monde, et des drapeaux rouges, et des drapeaux noirs, tu attends sous le soleil, avec tes camarades du comité de grève de philo, comme toi assez abattus, tu ne peux pas ne pas être là, malgré la douceur du soleil, l’éclat du ciel, tu es soudain traversée d’une grande lassitude et d’un grand désespoir, n’as-tu pas rêvé ces journées, peut-être t’es-tu laissée emporter par cet enchantement d’une autre vie, d’un autre monde…
Pourtant, avec les 40 000 qui ne sont pas partis en week-end, tu descends le boulevard du Montparnasse, tu traverses le carrefour des Gobelins, tu t’engages sur le boulevard Saint-Marcel, tu restes silencieuse, incapable de reprendre des slogans désormais dépassés. Ce n’est que boulevard de l’Hôpital, quand, regroupés derrière les grilles de la gare d’Austerlitz, les grévistes de la SNCF applaudissent les manifestants, que tu finis par joindre ta voix à celle des autres : « Etudiants solidaires des travailleurs »… « Ce n’est qu’un début continuons le combat »…« Elections, trahison! ».
Et après la gare d’Austerlitz, tu continues, tu vas à pied jusqu’à la Halle aux vins pour le meeting en faveur de la création d’un « mouvement révolutionnaire », tu es sur l’esplanade du quai Saint-Bernard, tu écoutes d’une oreille distraite les orateurs successifs, « le sommet de grenelle est une capitulation », « les directions du mouvement ouvrier renoncent à un mouvement anticapitaliste sans précédent en France », tu déambules entre les gens assis par terre, « il faut poursuivre la grève générale », « il faut constituer un pouvoir révolutionnaire pour contrôler la production et la distribution des marchandises », convaincue cependant de la vanité de ton entreprise, « il faut refuser le hochet parlementaire »…
Un appel à se rendre devant la régie Renault clôt le meeting. Alors que tu n’as jamais approuvé ces rassemblements quasi rituels d’étudiants à la porte des usines, tu te construis bien vite de petits alibis – tu décides d’y aller : « ce soir, n’est-ce pas différent ? Ne faut-il pas soutenir les ouvriers, leur donner la force de résister aux briseurs de grève, de combattre à la fois le patronat et les directions syndicales ? »
Sur l’île Seguin, là où se dresse l’imposante masse de la Régie, tel un gigantesque vaisseau qui s’avance sur la Seine, vous êtes rassemblés face à une immense porte fermée. Un échange s’esquisse entre les étudiants assis place Jules Guesde et les quelques ouvriers qui se tiennent debout au sommet de murs si hauts qu’ils ressemblent à des remparts. Bribes de questions – « que peut-on faire pour vous ? » – et de réponses – « tout ce que vous voulez » – bribes d’un impossible et absurde dialogue à la mesure de l’absurdité de la situation.
Quel sens cela a-t-il en effet d’être groupés sur cette place, à chanter L’Internationale, à crier des slogans démentis par l’évolution de la situation : « ce n’est qu’un début, continuons le combat », ou encore « vive la révolution socialiste »?
Dimanche 2 juin,
Les radios ne cessent de marteler que partout le travail reprend ou qu’il va reprendre, tandis que tu ne cesses de te dire qu’ils mentent, qu’ils manipulent, qu’ils multiplient ce genre d’informations pour pousser ceux qui tiennent encore, qui sont encore dans la grève, à renoncer. D’ailleurs, ne sont-ils pas obligés de reconnaître que les négociations se passent mal dans la métallurgie, aux PTT, dans les transports où les cheminots viennent de réoccuper les gares de Strasbourg et de Mulhouse ?
Et ceux de la Préméca, n’ont-ils pas décidé de poursuivre la grève ? Faut dire qu’ils n’avaient pas vraiment le choix, têtu le patron, buté, trop pour lui les accords de Grenelle, veut pas les appliquer dans sa boîte, comprend même pas qu’il faut céder un peu pour pas tout lâcher. Alors les ouvriers – dans la tête duquel l’idée a-t-elle surgi ? D’un seul ou de plusieurs en même temps ? Impossible à dire – quoi qu’il en soit les ouvriers ont décidé de séquestrer les pièces du train d’atterrissage du bel avion Concorde en cours de fabrication. Valent cher, très cher, ces pièces. Ton père t’explique leur projet d’un ton si enthousiaste que tu devines qu’ils sont déjà passés à l’acte, que les pièces sont déjà planquées quelque part.
Scène inhabituelle au domicile de tes parents, avec ces quelques ouvriers assis autour de la table de la salle à manger, pièce utilisée seulement pour les grandes occasions. « On est en train d’écrire au patron pour lui mettre le marché en main, on vient de faire un brouillon, on ne sait pas s’il convient, dis-nous ce que tu en penses ». Cette demande de ton père te met aussi mal à l’aise que d’aller à la porte des usines, ne pas être l’intellectuelle qui sait écrire face à des ouvriers qui doutent de leurs capacités, pourquoi saurais-tu mieux que les hommes réunis ce dimanche ce qu’il faut dire au patron d’une boîte dans laquelle ils travaillent depuis tant d’années ? « Je suis certaine qu’elle est parfaite votre lettre, dites ce que vous avez à dire, avec vos mots, votre style, ne vous souciez pas du reste! ». Mais ils insistent. Alors tu comprends que tes réserves passent davantage pour du mépris que pour du respect, tu lis la lettre, corriges quelques expressions et quelques fautes d’orthographe, mais sans rien changer sur le fond, irritée pourtant par bien des points du texte, le ton déférent, la manière qu’ils ont de s’excuser de leur hardiesse et même de leur grève, comme s’ils se sentaient en faute d’avoir transgressé leur constante résignation, leur habituelle obéissance. Mais peut être te trompes-tu, peut être charges-tu ce texte d’un contenu qu’il n’a pas. Car à les regarder rire, à les écouter imaginer la tête du patron quand il va lire cette lettre et apprendre que ses précieuses pièces, éléments du train d’atterrissage du Concorde, ont pris la poudre d’escampette, tu les sens fiers d’avoir eu cette audace et heureux de cette fierté.
Lundi 3 juin,
reprise du travail dans les banques, les charbonnages, à EDF, à la SNCF, la RATP.
Mardi 4 juin,
les restaurateurs et hôteliers de la côte normande sont satisfaits du week-end de la Pentecôte, le jugent meilleur pour leurs affaires que celui du 15 Août de l’année précédente, pensez pas une chambre de libre à trente kilomètres autour de Deauville ! A quinze kilomètres de là, à Dives-sur-Mer, aux établissements Tréfimétaux, 1100 ouvriers continuent d’occuper leur usine, mais on ignore si les restaurateurs normands leur ont porté les restes du week-end,
Mercredi 5 juin,
les voitures qui circulent à nouveau, les transports publics qui ne fonctionnent pas encore tout à fait normalement, les taxis qui sont en grève, et Paris noyé toute la journée dans des embouteillages,
Tu mets du temps à te résigner, elle t’a duré longtemps cette incapacité à accepter les choses, non fallait que tu piaffes, que tu renâcles, même lorsqu’il s’agissait d’un combat perdu d’avance.
Chaque jour, tu te replies sur la Sorbonne et sur Censier, un tenace va et vient de l’un à l’autre, à pied, empruntant généralement les mêmes rues, à l’aller, rue Victor Cousin, rue Cujas, rue Clovis, rue Descartes, rue Mouffetard, pour le retour le même chemin en sens inverse ou parfois un autre, rue de l’Arbalète, rue Lhomond, rue d’Ulm, place du Panthéon, rue Soufflot, rues à nouveau calmes, boutiques ouvertes, ordures qui ont disparu, et les gens qui ont repris leur cheminement solitaire, les gens qui ont recommencé à ne pas se parler.
Chaque jour à la Sorbonne ou à Censier, au moins là, c’est toujours la grève, toujours l’occupation, toujours les AG, les comités, les commissions, au moins là, on est ensemble.
AG qui se tient à la Sorbonne, dans l’amphi Descartes, avec une assistance qui commence à se réduire, AG sans ordre du jour, qui débat des derniers tracts, ceux qui appellent à la poursuite des occupations, qui prônent la résistance aux pressions des directions syndicales, ou d’autres qui parlent de reflux temporaire, de la préparation des luttes à venir, de la nécessité de passer désormais à l’explication politique. On se sait plus pourquoi on se réunit, pour faire semblant d’y croire encore, pour ne pas se quitter. Assemblée générale sans nécessité.
Jeudi 6 juin,
mort de Robert Kennedy, assassiné aux Etats-Unis quatre ans après son frère,
CRS et gendarmes mobiles qui ont envahi, en pleine nuit, l’usine Renault de Flins encore occupée. Combien étaient-ils ? Mille ? Trois mille ? Six mille ? Venus avec des half-tracks ? Des automitrailleuses ? Les comptes-rendus divergent, mais qu’importe, aucun doute, la répression est en marche, le pouvoir est prêt à tout pour en finir avec ceux qui résistent encore. Mais que faut-il faire ? Aller manifester le lendemain à Flins, comme le préconisent les maoïstes et le Mouvement du 22 mars ? Est-ce la meilleure manière de riposter ? N’est-ce pas tomber dans un piège tendu par le gouvernement ?
Vendredi 7 juin,
Flins toujours, des étudiants arrêtés sur le chemin de l’usine Renault, d’autres qui ont réussi à passer les barrages policiers et se sont joint aux ouvriers pour empêcher la reprise du travail, des combats, dit-on, qui opposent des étudiants et des ouvriers aux CRS et aux gendarmes mobiles, des blessés, de la population qui soutient les manifestants. Malgré ces informations et bien que tu juges les directions syndicales traîtres à la grève, tu n’envisages nullement d’aller à Flins, ces expéditions te déplaisent, tu n’apprécies pas leur côté commando, et là-bas, tu aurais l’impression de donner des leçons aux ouvriers, de te substituer à eux, de décider à leur place de ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
Samedi 8 juin,
soirée passée dans un café avec d’autres, étudiants et assistants, ressassant ce qui avait occupé l’AG de philo du même jour, non pas l’espèce de guérilla qui continue à se dérouler dans la campagne normande, ni la grève qui se poursuit ici ou là, ni l’occupation du siège du syndicat national des instituteurs par des adhérents hostiles au mot d’ordre de reprise du travail lancé par leur organisation, mais un événement qui vous a tous bouleversés bien davantage, la lettre anonyme et antisémite reçue le matin même par Janké.
Quand tu en as appris l’existence, tu as été abasourdie. Depuis que tu milites, tu n’es pas hostile aux règlements de compte politiques, à condition qu’ils se jouent autour de ce que les gens pensent et font, non sur ce qu’ils sont. C’est pourquoi les allusions antisémites faites à l’égard de Cohn Bendit, par la droite mais aussi par les communistes, t’avaient scandalisée. Mais qu’une attaque de cette nature puisse être menée contre un homme chassé de l’Université par le régime de Vichy et que, vingt-trois ans après la défaite du nazisme, après l’horreur des camps d’extermination, il puisse encore être stigmatisé pour sa judéité, cela te laisse stupéfait. A vingt ans, tu découvres, oui, pour toi, c’est une découverte, que les leçons de l’histoire ne comptent pas, pas plus que ne pèsent les condamnations morales et politiques. Janké paye-t-il, maintenant que le vent a tourné, son engagement aux côtés des étudiants, sa rupture affichée avec la plupart de ses collègues, d’une sordide missive anonyme ? Personne, dans l’AG de philo, n’en a douté. Et vous vous êtes donc retrouvés à plusieurs, à L‘Escholier, pour rédiger une motion ronronnante, sans imagination et vaine, qui condamne l’antisémitisme, affirme la solidarité de l’AG de philo avec Janké, salue son engagement dans les luttes des étudiants et des ouvriers. Geste dérisoire…
Lundi 10 juin,
alors que tu traînes à Censier, c’est à ton père que tu penses, ton père qui, ce matin, a repris le travail. La veille, au cours du déjeuner du dimanche, tu t’es encore engueulée avec lui. A la Préméca, le kidnapping des pièces a marché et le patron a fini par céder, rien de plus que la stricte application des accords de Grenelle, mais puisque au début, il les refusait, ton père estime avoir remporté une victoire.
Trois semaines de grève et qu’a-t-il gagné ? Le droit d’être syndiqué et une augmentation de salaire qui va lui permettre de ne plus travailler le samedi matin, à condition qu’il continue à faire ses onze heures quotidiennes du lundi au vendredi. A conquis aussi une sorte de dignité, dans cette lutte collective, dans ce geste inédit pour lui, de rébellion. Sans doute est-ce son gain le plus important. Cependant tu n’as pas pu t’empêcher de lui faire remarquer la maigreur du bilan. « On ne sera jamais les plus forts » a-t-il répondu. « Les plus forts, vous l’étiez, mais les syndicats vous ont trahis, ils n’ont jamais voulu de cette grève, ils ont tout fait pour qu’elle s’arrête ». « Mais qu’est-ce-que tu croyais, que ça allait être la révolution, que la classe ouvrière allait prendre le pouvoir ? De toute façon, gauche, droite, c’est pareil, ce sont toujours les mêmes qui trinquent ». « Et alors, t’en as pas marre de trinquer ? T’as pas envie que ça change? Tu crois pas que les patrons vivent de ta résignation, de cette idée qu’on ne peut pas modifier l’organisation injuste de la société, qu’il faut l’accepter. Quant à la gauche, où t’as vu que je la soutenais ? On n’a pas cessé de se battre aussi contre elle ! ».
Ton père qui a repris le travail et dont tu peux décrire la journée, tu peux la décrire heure par heure, lever à 6 heures, usine à 7, perspective de onze heures debout devant sa machine, tu le vois dans sa blouse marron, avec son béret sur la tête, hiver comme été, à l’usine, il le porte ce béret, pour se protéger de la limaille de fer qui vole de tous côtés, tu le vois dans le bruit des machines, dans les gestes mille fois répétés, dans la fatigue qui, vers trois, quatre heures de l’après-midi, va lui tordre le dos, dans l’effort qu’il doit déployer pour tenir jusqu’au soir. Qu’est-ce qui a vraiment changé pour lui ? Pour ainsi dire rien.
Tu as envie de crier, de hurler, de cogner, sentiment que tu éprouves aussi quand tu apprends par la radio la mort de Gilles Tautin. Tu n’as guère débordé d’enthousiasme pour les expéditions maoïstes à Flins, mais la fin de ce jeune lycéen de 17 ans te bouleverse. Certes, les gendarmes mobiles ne l’ont pas tué. Pas directement. Mais enfin, s’ils ne l’avaient pas poursuivi, il ne se serait pas jeté dans la Seine pour leur échapper et il ne se serait pas noyé. Pourtant tu ne bouges pas, tu te contentes de suivre à la radio le récit des échauffourées qui, jusque tard dans la nuit, opposent au Quartier latin manifestants et policiers.
Mardi 11 juin,
AG à Censier, la mort du jeune homme et la répression policière qui s’est exercée à Flins occupent les esprits, et l’analyse en est vite faite, les deux attestent de la volonté du pouvoir de liquider, par n’importe quel moyen, les grèves qui continuent dans de nombreuses usines. Après, c’est aux derniers bastions que représentent les facs qu’il s’en prendra. Et d’ailleurs, n’y prépare-t-on pas déjà l’opinion ?
Ne faut-il pas considérer l’article de Bertrand Girod de l’Ain dans Le Monde comme un appel à la répression, quand il compare la Sorbonne à un « bateau ivre », quand il décrit la fac livrée à des anciens mercenaires, à des trafics de morphine, de LSD et de hachisch ? Il faut réagir. Mais de quelle manière ? Le rassemblement que l’UNEF organise le soir même devant la gare de l’Est contre « une politique générale de répression visant les éléments les plus combatifs du mouvement, qu’ils soient travailleurs ou étudiants » est-il une riposte adéquate ? Des bruits circulent : les flics sont en train de quadriller Paris, ils arrêtent les jeunes, il sera difficile d’atteindre la gare de l’Est, il faut partir le plus tôt possible, il faut quitter les facs en cortèges… Manifestation inutile, tu le sais. Mais comment ne pas y participer ?
Tu quittes Censier avec les autres, tu marches jusqu’au Châtelet, tu remontes le boulevard Sébastopol, à l’approche de la rue Réaumur, les flics sont là, mur de casques, de boucliers, de matraques qui bloque le passage. Très vite l’info circule, impossible d’atteindre la gare de l’Est, faut se rendre à la gare Saint-Lazare. Mais par où passer ? Quel chemin prendre ? Par les petites rues, mais non, flics de tous côtés, étudiants croisés qui te racontent que la police procède à des arrestations massives, tu finis par abandonner, tu ne tentes même pas de te diriger vers Saint-Lazare, tu repars vers les grands boulevards, désorientée, tu ne sais plus ce que tu dois faire ni même pourquoi tu es là, affolée, dans les rues de Paris. Pour manifester ? Pour dénoncer la répression ?
Mercredi 12 juin,
comité d’action de philo, bilan de la nuit, manifestations ici ou là, barricades à la gare du Nord, rue des Saints Pères, à la Contrescarpe, à Montparnasse, 1 500 interpellations, « ça ne sert plus à rien, tout est fini, il faut en prendre acte », dit quelqu’un, tu sais que ce quelqu’un a raison mais tu ne veux pas l’admettre, tu rétorques que tu t’en fous, qu’il y a encore un million de grévistes, qu’après Gilles Tautin à Flins, c’est un ouvrier qui a été tué à Sochaux, qu’on ne peut tout de même pas rester sans réagir, et tant pis si tout le monde est contre eux, le gouvernement, les syndicats, la presse, la télé…
Comment accepter de perdre ce qui s’était répandu sur la France entière, en peu de jours, ce souffle qui avait rendu la vie légère, aérienne, loin des « eaux glacées du calcul égoïste », et qui refluait aussi, comme une vague qui se retire, et qui laisse la vie d’avant revenir
Jeudi 13 juin,
un à un, les théâtres parisiens ont réouvert leurs portes, le gouvernement interdit toute manifestation sur la voie publique et dissout cinq groupes gauchistes : la Fédération des étudiants révolutionnaires, la Jeunesse communiste révolutionnaire, le Mouvement du 22 mars, Voix ouvrière, l’Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes.
Le PCF peut se féliciter d’avoir été entendu, lui qui, la veille, dénonçait dans l’Humanité « les provocations des groupes ultra-gauchistes – soutenus par le PSU – se réclamant du maoïsme, de l’anarchisme ou du trotskisme », et les « aventuriers », les « personnages troubles », les « renégats » qui peuplent leurs rangs ».
A Censier, on continue. On se bat encore. Pour quoi, tu ne le sais plus. Contre quoi, tu crois le savoir. Puisque c’est foutu, autant empêcher, le plus longtemps possible, la reprise des cours, l’organisation des examens et surtout le bon fonctionnement des structures que les réformistes de tout poil mettent en place, telle cette commission centrale de coordination et d’études, la CCCE, nouvellement créée et chargée d’élaborer une réforme des structures de la faculté des lettres et des sciences.
Pour l’AG de philo, aucun doute, cette CCCE est une manœuvre du pouvoir qui, en s’appuyant sur certaines forces prétendument de gauche, vise à construire une Université moderne et technocratique. Mais comment faire échouer une telle tentative ? En boycottant la commission ou en y participant pour en freiner l’activité ?
Pour une fois, l’AG prend rapidement une décision, optant pour l’envoi de délégués chargés d’observer et surtout de ralentir les travaux de cette commission, d’en informer systématiquement les étudiants, de les alerter sur le danger de tel ou tel projet. Ces délégués, révocables à tout moment, seront élus par l’AG entière et par un seul collège.
Comme lors de la première élection du comité de grève, ce principe soulève l’opposition des enseignants. Par ailleurs la plupart sont favorables à la participation à cette commission parce qu’elle va travailler à réformer l’université. Mais toi, tu t’en fiches, de réforme de l’université française.
A ce moment-là, pour toi, l’important, c’était avant tout de contester, paralyser, renverser. Il fallait d’abord détruire avant de reconstruire, sûrement pas aménager, améliorer l’existant. Au fil des années, tu as changé, tu n’es pas devenue plus raisonnable, ni moins en révolte, attitude qui ne t’a jamais quittée, mais tu es plus soucieuse du moment présent, du fait que les gens n’avaient qu’une vie, plus consciente aussi que la destruction n’était pas forcément un préalable, qu’elle n’était pas forcément créatrice, si bien que tu étais plus attentive au sens et à l’idée de faire. Par conséquent sans doute encore plus incapable que dans ta jeunesse de supporter la différence entre les choses dites et les choses faites, de se contenter de grandes déclarations, de grands discours, mais bien au chaud, dans des colloques, des revues, des manifestations sans risque.
En 68, pour toi faire, c’était dire non. Tu as continué à penser ainsi mais tu en as tiré d’autres conséquences. Et puisque tu ne pouvais plus faire l’Histoire, même plus en avoir l’illusion, ta manière de dire non consistait désormais à faire de petites choses, infinitésimales, une goutte d’eau, mais à effet immédiat, ici et maintenant, tandis que tu étais, dans le même mouvement, passée à une vision plus concrète, plus proche de la réalité humaine.
Dans les années soixante et même après, tes engagements étaient surtout d’ordre idéologique ou au nom de grands principes, ils relevaient d’abord du choix du camp. Quand tu manifestais contre la guerre du Vietnam, par exemple, tu manifestais contre l’impérialisme, pour soutenir la lutte du peuple vietnamien, mais la souffrance de ce peuple, ce que des femmes, des hommes, des enfants vivaient, subissaient chaque jour et chaque heure, tu n’y songeais pas vraiment. Cette souffrance restait abstraite, et même cette souffrance et ces femmes, ces hommes, ces enfants, d’une certaine façon, vous les preniez en otage, vous en faisiez des enjeux de débats, de polémiques, de tribunes, de divergences, de désaccords, de campagnes électorales, de positions, tout ce qu’on voudra, mais ils demeuraient abstraits, sans corps, sans visage, sans chair.
Peu à peu, la perception de la souffrance, du malheur du monde t’est devenue plus précise, plus charnelle. Est-ce à cause de l’abondance sans cesse croissante des images ? Est-ce parce que les visages, les corps meurtris, les enfants mourant de faim ou de maladies étaient devenus des images quotidiennement ou presque diffusées par les chaines de télévision ? Ou est-ce que les déceptions idéologiques et politiques avaient ouvert un autre espace, permis une autre vision, une proximité plus grande avec les êtres et leur souffrance ? Ou est-ce tout simplement le fait que tu as vieilli ?
Comme durant ton adolescence, tu as continué pendant des années à recopier des phrases, ainsi cette citation de Vie et destin : « C’est ainsi qu’il existe, à côté de ce grand bien si terrible, la bonté humaine dans la vie de tous les jours. C’est la bonté d’une vieille, qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe, c’est la bonté d’un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé, la bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse, la bonté d’un paysan qui cache dans sa grande un vieillard juif. C’est la bonté de ces gardiens de prison, qui, risquant leur propre liberté, transmettent des lettres de détenus adressées aux femmes et aux mères. Cette bonté privée d’un individu à l’égard d’un autre individu est une bonté sans témoins, une petite bonté sans idéologie. On pourrait la qualifier de bonté sans pensée. La bonté des hommes hors du bien religieux ou social ».
De cette phrase de Vassili Grossman il y a quelques décennies, tu te serais moquée, tu aurais ironisé sur cette petite bonté sans idéologie, sans pensée, tu n’y aurais pas prêté attention, tu n’aurais même pas su la lire…
Vendredi 14 juin,
le théâtre de l’Odéon est évacué par la police, trois autres organisations révolutionnaires sont dissoutes, le Parti communiste marxiste-léniniste, le Parti communiste internationaliste, l’Organisation communiste internationaliste. Mais les chefs de l’OAS Raoul Salan, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et Antoine Argoud condamné à mort par contumace en juillet 1961 puis à la réclusion à perpétuité, sont libérés et Georges Bidault, compagnon de la libération, Grand-croix de la légion d’honneur, successeur aussi de Salan à la tête de l’OAS, est autorisé à rentrer en France.
La presse exhorte, c’est ainsi que tu la lis, le gouvernement à faire rentrer les étudiants dans le rang. Après l’article de Bertrand Girod de l’Ain dans Le Monde, c’est en effet Raymond Aron qui, dans Le Figaro, déplore que les facultés restent occupées « alors que les ouvriers ont presque tous repris le travail », c’est La Croix qui s’en prend « aux quelques centaines d’étudiants révolutionnaires qui font la loi à l’Université », c’est Paris-Presse qui appelle à la suppression « des îlots insurrectionnels dans les facultés ».
Selon toi, tous d’accord, tous ligués.
Samedi 15 juin,
tu es sur le boulevard Berthier, tu vois le cortège arriver de loin, signalé par le grand portrait du jeune homme, Gilles Tautin, qui précède le corbillard. Maintenant il est à ta hauteur et tu regardes passer la famille, puis un groupe d’ouvriers de Renault, puis les élèves du lycée Mallarmé qu’il fréquentait, tu te mêles à la foule qui s’avance sur le boulevard, emprunte l’avenue de la porte de Clichy, enfin celle, plus étroite, du cimetière des Batignolles.
Toi aussi, poing levé, tu entonnes le Chant des survivants dont on disait qu’il était le chant préféré de Lénine : « La terre ton lit de parade, Un tertre sans fleur et sans croix, Ta seule oraison camarade, Vengeance, vengeance pour toi, pour toi ».
Tu reprends le Chant des Martyrs : « Vous êtes tombés pour tous ceux qui ont faim, Tous ceux qu’on méprise et qu’on opprime, De votre pitié pour vos frères humains, Martyrs et victimes sublimes ».
Puis, comme en défi à l’hélicoptère qui bourdonne au-dessus du cimetière, c’est l’Internationale qui s’élève. Mais pour le garçon de dix-sept ans dont le cercueil, peu à peu, se recouvre de roses rouges, la lutte s’est à jamais finie dans une eau froide et boueuse, un soir de printemps.
Tu restes plantée à l’entrée du cimetière, tu prends le tract que les prochinois distribuent et qui exhorte à suivre « l’instruction du grand guide de la révolution mondiale, le camarade Mao Tsé-Toung : servir le peuple ». En toi-même tu juges que ce sont des cons dangereux mais tu n’as pas l’énergie de débattre avec eux, obsédée et abattue par la perspective annoncée, la reprise des facs par la police d’un jour à l’autre. Aujourd’hui ? Demain ?
Dimanche 16 juin,
tu es chez toi quand à trois heures, la radio annonce que les flics sont entrés à la Sorbonne. Malgré tous les indices des jours précédents, tu es atterrée. Selon le speaker, les besoins d’une enquête – un type aurait reçu, la nuit dernière, un coup de couteau dans l’enceinte de la faculté – justifieraient cette intervention policière. « Comme s’ils avaient besoin d’un prétexte », penses-tu en te précipitant au Quartier latin.
La Sorbonne, complètement encerclée par la police, est inaccessible. Un mélange de badauds et de manifestants barre le boulevard Saint-Michel. On chante L’Internationale, on crie « ce n’est qu’un début, continuons le combat! ». Soudain, un mot d’ordre se met à circuler: « il faut aller à Censier, s’y installer pour que les flics n’y viennent pas ! ».
Sous la pluie, tu reprends ton chemin habituel, tant de fois parcouru, qui te mène à Censier.
Ça ressemble à une veillée. Alertés par la radio, par le téléphone, des étudiants, des enseignants, ne cessent d’affluer. On s’assoit, on discute dans les couloirs, les amphis, on se groupe autour des transistors, on s’affole de l’arrivée imminente des flics, non c’est une fausse alerte, on part acheter des sandwichs, on revient, on bavarde, on s’ennuie, on rigole, on esquisse des tracts qu’on remet au lendemain, on fait des brouillons de motions pour les AG futures, mais on a compris : les facs vont tomber les unes après les autres.